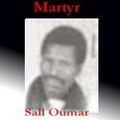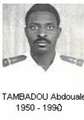Souleymane Adam, 55 ans a perdu ses champs et son bétail lors d'une attaque de miliciens djandjawid dans son village du Darfour, dans l'ouest du Soudan. Il goûte maintenant les temps amers du désoeuvrement au camp de réfugiés de Gaga, dans l'est du Tchad voisin.
C'est un jour d'août 2004, un an après le début de la guerre civile au Darfour, que sa vie, celles de sa femme et de leurs six enfants ont basculé. "Les milices djandjanwid que le gouvernement soudanais avait recrutées sont venues nous attaquer", explique-t-il.
Dans son village de Firna, 700 habitants, les cavaliers arabes ont tué sept personnes, "pris les biens et pillé les maisons", raconte-t-il d'une voix lente.
Installé près d'un auvent de paille, l'homme se remémore ses cultures qu'il n'a pas eu le temps de récolter avant de partir et, un instant, une lueur de fierté ravive son regard quand il évoque son troupeau de trente boeufs et d'une centaine de moutons.
"Les djandjawid ont tout pris, j'ai tout perdu", répète-t-il. Dans la panique, tout le village s'est dispersé. Comme les autres, il n'a pris le temps "que de mettre une couverture sur l'épaule et de partir".
Après une journée de marche, ils ont atteint Adré, localité tchadienne frontalière.
Pris en charge par une ONG, la famille de Souleymane a ensuite été orientée vers Gaga, dernier des 12 camps de l'est du Tchad où vivent 200.000 réfugiés du Darfour, ouvert en mai 2005 pour désengorger les autres.
Il y a reçu une parcelle de 100 m2 qu'il a vite clôturée de seko -des tiges de mil assemblées en palissade- et où la tente siglée UNHCR (Haut commmissariat aux réfugiés des Nations unies) des débuts a été remplacée par plusieurs cases en banco: une pour lui et sa femme, une pour les enfants, une pour l'intendance et une pour recevoir les visiteurs.
Dans son bloc (le camp de Gaga en compte 10), tous sont de la même ethnie zaghawa et il a même retrouvé des gens de son village.
Musulman comme l'ensemble des habitants du Darfour, Souleymane se lève tous les matins à 04H30 pour la première prière de la journée. Il attend ensuite le réveil des enfants et les emmène pour 07H00 à "l'école Gaga", l'une des six que compte le camp, très bien doté en infrastructures sanitaires et sociales.
En rentrant de l'école, il s'arrête chez des voisins pour discuter puis rentre chez lui, s'abriter de la chaleur et se reposer. De quoi? Souleyane se le demande aussi, il n'a "pas d'activité".
Sans leur bétail, les hommes sont privés de leurs activités traditionnelles, pendant que les tâches domestiques et les corvées quotidiennes restent dévolues aux femmes.
Les quelques semailles d'arachides pendant la saison des pluies lui ont rapporté une dizaine de sacs de graines dont il fera de l'huile ou qu'il grignotera "comme ça". Depuis, les jours s'écoulent, identiques.
"L'activité me manque, je n'ai rien à faire ici. Je ne me sens pas bien", reconnaît-il, les mains posées sur sa djellaba blanche, le regard fixé sur le sol.
Les ONG apportent le nécessaire pour vivre mais l'inactivité des hommes pose problème dans un camp de réfugiés hébergeant 17.000 personnes. Au traumatisme de l'exil s'ajoutent souvent des états dépressifs qui peuvent engendrer des comportements violents ou apathiques.
La journée de Souleymane est rythmée par les prières, seules véritables occasions de sortir de chez lui. A la mosquée, "on discute entre hommes du passé", ajoute Souleymane, les yeux dans le vague. Le retour, souhaité plus que tout, est encore trop incertain pour être évoqué.
Souvent, il dîne aussi à la mosquée, avant de "regagner le lit" vers 21H00.
Et de recommencer le lendemain.
Source: TV5
(M)
C'est un jour d'août 2004, un an après le début de la guerre civile au Darfour, que sa vie, celles de sa femme et de leurs six enfants ont basculé. "Les milices djandjanwid que le gouvernement soudanais avait recrutées sont venues nous attaquer", explique-t-il.
Dans son village de Firna, 700 habitants, les cavaliers arabes ont tué sept personnes, "pris les biens et pillé les maisons", raconte-t-il d'une voix lente.
Installé près d'un auvent de paille, l'homme se remémore ses cultures qu'il n'a pas eu le temps de récolter avant de partir et, un instant, une lueur de fierté ravive son regard quand il évoque son troupeau de trente boeufs et d'une centaine de moutons.
"Les djandjawid ont tout pris, j'ai tout perdu", répète-t-il. Dans la panique, tout le village s'est dispersé. Comme les autres, il n'a pris le temps "que de mettre une couverture sur l'épaule et de partir".
Après une journée de marche, ils ont atteint Adré, localité tchadienne frontalière.
Pris en charge par une ONG, la famille de Souleymane a ensuite été orientée vers Gaga, dernier des 12 camps de l'est du Tchad où vivent 200.000 réfugiés du Darfour, ouvert en mai 2005 pour désengorger les autres.
Il y a reçu une parcelle de 100 m2 qu'il a vite clôturée de seko -des tiges de mil assemblées en palissade- et où la tente siglée UNHCR (Haut commmissariat aux réfugiés des Nations unies) des débuts a été remplacée par plusieurs cases en banco: une pour lui et sa femme, une pour les enfants, une pour l'intendance et une pour recevoir les visiteurs.
Dans son bloc (le camp de Gaga en compte 10), tous sont de la même ethnie zaghawa et il a même retrouvé des gens de son village.
Musulman comme l'ensemble des habitants du Darfour, Souleymane se lève tous les matins à 04H30 pour la première prière de la journée. Il attend ensuite le réveil des enfants et les emmène pour 07H00 à "l'école Gaga", l'une des six que compte le camp, très bien doté en infrastructures sanitaires et sociales.
En rentrant de l'école, il s'arrête chez des voisins pour discuter puis rentre chez lui, s'abriter de la chaleur et se reposer. De quoi? Souleyane se le demande aussi, il n'a "pas d'activité".
Sans leur bétail, les hommes sont privés de leurs activités traditionnelles, pendant que les tâches domestiques et les corvées quotidiennes restent dévolues aux femmes.
Les quelques semailles d'arachides pendant la saison des pluies lui ont rapporté une dizaine de sacs de graines dont il fera de l'huile ou qu'il grignotera "comme ça". Depuis, les jours s'écoulent, identiques.
"L'activité me manque, je n'ai rien à faire ici. Je ne me sens pas bien", reconnaît-il, les mains posées sur sa djellaba blanche, le regard fixé sur le sol.
Les ONG apportent le nécessaire pour vivre mais l'inactivité des hommes pose problème dans un camp de réfugiés hébergeant 17.000 personnes. Au traumatisme de l'exil s'ajoutent souvent des états dépressifs qui peuvent engendrer des comportements violents ou apathiques.
La journée de Souleymane est rythmée par les prières, seules véritables occasions de sortir de chez lui. A la mosquée, "on discute entre hommes du passé", ajoute Souleymane, les yeux dans le vague. Le retour, souhaité plus que tout, est encore trop incertain pour être évoqué.
Souvent, il dîne aussi à la mosquée, avant de "regagner le lit" vers 21H00.
Et de recommencer le lendemain.
Source: TV5
(M)
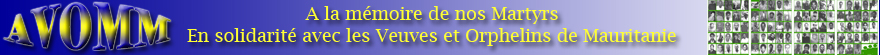
 Actualités
Actualités



















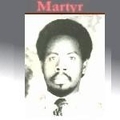
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)