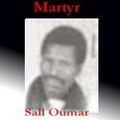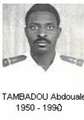Bâ Kassoum Sidiki (photo avomm)
Quand le vent se lèvera.
Usure, temps qui passe, gestes d’oubli dans le quotidien d’une banalisation n’ont fait que renforcer l’effervescence protestataire. D’Inal au Parvis des Droits de l’Homme à Paris, les voix et les marches résonnent encore d’hommage. Les consciences se sont aiguisées contre les commémorations fictives, le détournement des pardons, le déni de justice. C’est que l’hubris fut atteint, dans une stupéfaction dont nous ne sommes jamais relevés : des hommes comme offrande dans une profanation inédite des préceptes de l’Islam. Ils étaient vingt huit. Condamnés à mourir dans la nuit du 27 novembre 1990, à la veille de la fête de l’indépendance de la Mauritanie. Ils avaient la possibilité de parler, d’accuser, pour sauver leur vie mais ils se sont tus. Ils n’élevèrent aucune plainte qui puisse abdiquer leur dignité. Ils n’ont ni crié ni courtisé leurs geôliers et bourreaux. Dans le bruit de leur ombre, leur silence clamait l’extrême grandeur de leur humanité. Résistance de la victime amplifiée par la voie sacrée de l’innocence qui enragera les milices et les commis de la mort. Ils étaient simples soldats qui, dans une ultime épreuve, ont choisi la perspective : ne pas faiblir devant l’ennemi. Dans la souffrance contenue de leurs supplices, ils affirmèrent une éthique, celle qui dit non à la mécanique meurtrière d’un racisme d’Etat. Ils ne demandèrent ni pardon ni n’avouèrent, étouffant leur souffrance intérieure de ne revoir l’enfant et l’épouse, la chaleur de la maisonnée, la terre ferme. Ils étaient tels Jean Moulin qui, soumis à la torture, en proie à l’agonie, fait face, trouve cette force tranquille, transparence par elle-même de la déshumanisation du détenteur du fusil et de la baïonnette ; s’obstinant par leur attitude emprunte de retenue à la plus haute affirmation de l’idée de soi.
A tous ceux ensevelis sous-terre sans sépulture, aux corps dispersés dans les sables torrides écumant de préjugés racistes, nous ne cesserons de saluer leur substance d’homme. Devoir de mémoire que l’écrivain guinéen Thierno Monénembo, dans l’épitaphe (citant Senghor) de son dernier roman Le terroriste noir, rend touchant :
« On fleurit les tombes, on réchauffe le Soldat inconnu,
Vous mes frères obscurs, personne ne vous nomme ».
Comment alors dire l’après quand le présent nous submerge dans une continuité. La douleur est si lancinante en nous qu’elle rend la narration inaccessible, le récit infirme dans une chute impossible. Il reste alors le souvenir de vingt huit visages, le regard, témoin authentique de vingt huit bannis, quelques uns très jeunes, qui par le mépris de la mort énoncèrent une leçon de sens plus que le tribun révolutionnaire. Dans l’impératif du devoir, ils s’étaient engagés pour défendre leur patrie à la souveraineté très souvent contestée. Mais ils furent réduits à des numéros, à une quantité d’hommes à immoler. Nous les croisions dans les enceintes de nos mosquées, assis sur les mêmes tapis, dans les palabres de nos villages. Au détour des rues, dans les cours de récréation nous nous perdions avec ceux de notre génération dans des camaraderies joyeuses. Les aînés nous grommelaient par de sages conseils. Mais une ingéniosité génocidaire répartit les mauritaniens en Beydanes et Noirs, fit de la différence un absolu alors que toute diversité n’est qu’une variation de l’universel humain.
Ce que les civilisations exprimaient d’éminent, l’un et le multiple, l’addition et la somme, les chiffres et les nombres pour se repérer dans le mobilisme universel furent érigés en Mauritanie en d’innommables opérations de soustraction et de division. Déchiffrer le monde à travers l’ordre et l’organisation pour configurer les éléments, qui fit écrire à Platon devant le frontispice de l’Académie « que nul n’entre ici s’il n’est géomètre » (mathématicien) fut subverti en négations humaines. Trier, compter pour démembrer, participaient d’une action d’épuration. Le choix d’un symbole, celui de l’indépendance, pour arracher à la vie des hommes qui n’étaient coupables que d’être des Négro-Mauritaniens, de parler Peulh, Soninké, Wolof, constitua une épreuve de plus. Désormais la fête de l’indépendance est ainsi marquée du sceau négatif de ces vies brisées. D’autres exécutions suivront sans faire sourciller les membres de la hiérarchie militaire. C’est dire à quel point la négation d’autrui et de sa dignité fut entreprise comme une besogne d’état par des officiels et leurs fidèles suppôts.
L’Etat porta au paroxysme la prescription d’une identité, une citoyenneté à sens unique, refusa sa dimension plurielle par l’amputation. La Mauritanie comme entité est alors doublement niée dans ses racines africaines et arabes. La singularité des hommes et de leurs cultures devint suspecte et finit par l’assassinat. Dans un riche rappel du sens et de la promotion de la tolérance, Claude Lévi-Strauss nous enseigne dans Race et histoire : « La diversité des cultures humaines est derrière nous, autour de nous, devant nous. La seule exigence que nous puissions faire valoir à son endroit est qu’elle se réalise sous des formes dont chacune soit une contribution à la plus grande générosité des autres.»
Mais la scission l’emporta sur ce « qui scellait » la république. Derrière le carnaval de célébration la mort, dans ce qui était l’annonce d’une espérance, nous nous effondrâmes du naufrage des idées de fraternité et de communauté de destin. Dans l’idéal d’une cohésion des nationalités les forces de division n’ont jamais cessé d’être à l’œuvre. Dans ce qui fut appelé « les événements », dans un trouble saisissant de l’esprit, les plus fines plumes dont le président des maires de l’époque, se mirent à tout justifier dès les premières heures des déportations : l’esclavage, l’expropriation des terres aux habitants de la vallée, la désignation d’une communauté. Le quotidien national Horizons ancien Chaab, censé être dépositaire de la représentation nationale de tout citoyen mauritanien, se répandit dans le journalisme de crispation et d’intolérance. Dans le déchaînement des médias de la haine, les éditoriaux donnaient dans des titres à l’évocation sans équivoque. La volonté des Négro-Mauritaniens de préserver leur patrimoine, la terre, passait pour de « L’Egoïsme enragé ». Volonté qui pour un rédacteur en chef bien en vue n’était destiné qu’à « priver les Pulaars mal nés du Fouta». C’est tel philosophe, écrivain de surcroit, qui dans l’envers du précepte aristotélicien « Je suis davantage amoureux de la vérité »se fit l’interviewer glorieux à la télévision mauritanienne d’un militant de l’extrême droite française.
Ce ne fut donc ni l’œuvre d’un tyran ni de quelques illuminés mais bien d’une pensée qui trouva en Ould Taya l’arme fatale, en son régime le manifeste d’une violence acérée qui nous extorqua le rêve d’une république possible avec toutes ses originalités culturelles. La proscription délibérée de l’entité multinationale s’étalait à tous les niveaux : administration, armée, éducation et culture. Les scènes répressives se répétaient dans une phase toujours ascendante, pour finir par des exécutions extrajudiciaires. Des civilisations qui ont préservé leur personnalité historique depuis les temps anciens furent interdites d’expression.
Un totalitarisme naissant aux accents de douceur et de tromperie guette encore. L’arbitraire ne tient plus à la mitraillette mais à une omission volontaire avec la bénédiction d’en haut : tout tient dans le carnet du fonctionnaire dont les humeurs variables décident qui est mauritanien et qui ne l’est pas, avec l’encouragement du gouvernement. Aucun recours n’est possible contre de tels agissements. Apatrides de l’intérieur par un recensement qui va dépeupler la Mauritanie de sa composante africaine est l’aspect récent de la nouvelle exclusion. L’état civil présenté comme le socle de statistiques fiables, comme proposition d’objectivité, n’est en réalité qu’une fabrique d’une manipulation plus élaborée de la citoyenneté. L’Etat, dans le registre partisan qui est le sien, décide à lui seul des élus et des relégués, se ferme au débat sur une question aussi importante, instaure de fait une fracture entre citoyens d’un même Etat, use de la violence systématique pour toute forme de contestation. Ainsi une figure du Négro-Mauritanien est construite, il devient un schéma : le contraste de l’arabité. S’édifie alors une ligne intérieure, un moule idéologique jamais avoué mais qui inspire toute la politique menée jusqu’ici, à l’exception du courageux pouvoir démocratique du président Sidi Ould Cheikh Abdallahi. La discrimination s’insinue, rend toujours plus marginale la composante négro-mauritanienne. C’est une ligne directrice à laquelle les différents régimes se sont attelés. Intérioriser un non dit, celui de donner toujours plus à la communauté arabe de Mauritanie, principe d’une discrimination négative que Calliclès, dans une incompréhension de l’essence de la justice opposait à Socrate comme ce qui est « l’avantageux au plus fort ». Ould Abdel Aziz ne fait pas exception. Il inaugure même une forme de réparation et d’attention mais dans une volonté de contrôle plus efficace. Conscient que la violence ne peut parfaire une domination, il trouva en l’état civil un moyen plus neutre, plus sûr même, puisqu’accepté par les bailleurs de fond au nom de la lutte contre le terrorisme. Auto-défense d’un système qui absout les crimes par une loi d’amnistie en même temps qu’il l’associe à l’objectif noble d’unité nationale. Ruse d’unité factice quand l’exigence de justice n’est pas le rempart de l’Etat, quand l’Etat de droit fait défaut.
Ainsi c’est à la constitution, résultat d’un contrat multinational, de préserver la coexistence pacifique, inspirée d’une éthique égalitaire. La coexistence de nos différentes nationalités doit découler de leur reconnaissance sans prééminence d’un groupe sur un autre, d’une culture sur une autre. L’Etat est si mal parti qu’il faut le refonder en son caractère multinational en aménageant un dispositif de droits qui garantissent la représentation politique, la langue, la nationalité, l’emploi, une école pour tous où le prétexte d’une unité de culture et de formation ne doit pas servir d’instance ségrégative contre une communauté, notamment négro-mauritanienne. Claude Lévi-Strauss notait dans Tristes tropiques que « Le consentement est à l’origine du pouvoir, et c’est aussi le consentement qui entretient sa légitimité.»
Un tel prérequis d’une configuration dynamique de la cohésion nationale n’est pas d’actualité. Il existe même des signes alarmants d’hégémonie culturelle comme l’attestent les dernières lois sur l’audiovisuel privé où radios et télévisions privées sont obligées d’émettre majoritairement en Hassanya alors que la BBC à Londres a des éditions intégrales, de manière continue, en langues étrangères ; de même qu’aux Etats-Unis nombreux sont les organes de presse éditant uniquement en Espagnol sur le sol américain où pourtant l’Anglais est prépondérant. Ainsi le sésame démocratique n’a mis fin ni à l’esclavage, ni au racisme d’Etat, ni à la gabégie, aux grandes injustices qui gangrènent le pays.
Et Marx, dans le désordre qui caractérisait la montée de la bourgeoisie, écrivait dans une lettre en mai 1843 : « Vous ne direz pas que je me fais une trop haute idée du temps présent, et si malgré tout je ne désespère pas de lui, c’est que sa situation désespérée est précisément ce qui m’emplit d’espoir. »
Je ne pourrai mieux conclure en plaçant cet espoir dans l’engagement de deux figures de proue que sont Birane Ould Abeïd et Abdoul Birane WANE. Incarnation d’une société civile nouvelle, leurs organisations posent les questions fondamentales dont les résolutions détermineront l’avenir serein de notre pays. : rien de plus ni rien de moins qu’une citoyenneté entière pour tous, la primauté généralisée de la règle de droit, en lieu et place des conservatismes arriérés, nulle distinction autre que celle fondée sur l’utilité publique. La société civile, par sa vigilance alerte, se présente ainsi comme notre conscience de soi. Accompagner ce mouvement, comme le font l’AJD et le PLEJ, exige l’émergence d’une force de dépassement dont le nœud est l’opposition à toutes les lois iniques : lois d’amnistie, sur l’éducation nationale pérennisant l’injustice et l’exclusion. Le sens de la modernité démocratique se jaugera en fonction des droits culturels et sociaux effectifs et réels, dans une garantie de la préservation et de l’expression de la culture de chacune de nos nationalités. C’est donc dans une large autonomie du Sud au sein d’une dynamique fédérale que se trouvent les chances d’un ancrage démocratique. En somme il n’ ya de monde que par le territoire. Et c’est quand les hommes et les femmes contrôleront au sein de leur territoire, là où ils vivent, les moyens de production et d’échange, qu’ils pourront avoir le sentiment de la maîtrise de leur existence. Ce jour où l’administration des choses se substituera au gouvernement des hommes où des citoyens décident dans une libre association l’institution du vivre-ensemble, le vent de liberté se lèvera alors à partir de l’Eden matinal de nos souffrances affranchies.
Erratum: au lieu de lire l'hybris, il faudrait lire l'hubris; et au lieu de lire Monembo il faudrait plutôt lire Monénembo comme s'écrit le nom de l'écrivain guinéen cité.
BÂ Kassoum Sidiki
Pour avomm.com
Usure, temps qui passe, gestes d’oubli dans le quotidien d’une banalisation n’ont fait que renforcer l’effervescence protestataire. D’Inal au Parvis des Droits de l’Homme à Paris, les voix et les marches résonnent encore d’hommage. Les consciences se sont aiguisées contre les commémorations fictives, le détournement des pardons, le déni de justice. C’est que l’hubris fut atteint, dans une stupéfaction dont nous ne sommes jamais relevés : des hommes comme offrande dans une profanation inédite des préceptes de l’Islam. Ils étaient vingt huit. Condamnés à mourir dans la nuit du 27 novembre 1990, à la veille de la fête de l’indépendance de la Mauritanie. Ils avaient la possibilité de parler, d’accuser, pour sauver leur vie mais ils se sont tus. Ils n’élevèrent aucune plainte qui puisse abdiquer leur dignité. Ils n’ont ni crié ni courtisé leurs geôliers et bourreaux. Dans le bruit de leur ombre, leur silence clamait l’extrême grandeur de leur humanité. Résistance de la victime amplifiée par la voie sacrée de l’innocence qui enragera les milices et les commis de la mort. Ils étaient simples soldats qui, dans une ultime épreuve, ont choisi la perspective : ne pas faiblir devant l’ennemi. Dans la souffrance contenue de leurs supplices, ils affirmèrent une éthique, celle qui dit non à la mécanique meurtrière d’un racisme d’Etat. Ils ne demandèrent ni pardon ni n’avouèrent, étouffant leur souffrance intérieure de ne revoir l’enfant et l’épouse, la chaleur de la maisonnée, la terre ferme. Ils étaient tels Jean Moulin qui, soumis à la torture, en proie à l’agonie, fait face, trouve cette force tranquille, transparence par elle-même de la déshumanisation du détenteur du fusil et de la baïonnette ; s’obstinant par leur attitude emprunte de retenue à la plus haute affirmation de l’idée de soi.
A tous ceux ensevelis sous-terre sans sépulture, aux corps dispersés dans les sables torrides écumant de préjugés racistes, nous ne cesserons de saluer leur substance d’homme. Devoir de mémoire que l’écrivain guinéen Thierno Monénembo, dans l’épitaphe (citant Senghor) de son dernier roman Le terroriste noir, rend touchant :
« On fleurit les tombes, on réchauffe le Soldat inconnu,
Vous mes frères obscurs, personne ne vous nomme ».
Comment alors dire l’après quand le présent nous submerge dans une continuité. La douleur est si lancinante en nous qu’elle rend la narration inaccessible, le récit infirme dans une chute impossible. Il reste alors le souvenir de vingt huit visages, le regard, témoin authentique de vingt huit bannis, quelques uns très jeunes, qui par le mépris de la mort énoncèrent une leçon de sens plus que le tribun révolutionnaire. Dans l’impératif du devoir, ils s’étaient engagés pour défendre leur patrie à la souveraineté très souvent contestée. Mais ils furent réduits à des numéros, à une quantité d’hommes à immoler. Nous les croisions dans les enceintes de nos mosquées, assis sur les mêmes tapis, dans les palabres de nos villages. Au détour des rues, dans les cours de récréation nous nous perdions avec ceux de notre génération dans des camaraderies joyeuses. Les aînés nous grommelaient par de sages conseils. Mais une ingéniosité génocidaire répartit les mauritaniens en Beydanes et Noirs, fit de la différence un absolu alors que toute diversité n’est qu’une variation de l’universel humain.
Ce que les civilisations exprimaient d’éminent, l’un et le multiple, l’addition et la somme, les chiffres et les nombres pour se repérer dans le mobilisme universel furent érigés en Mauritanie en d’innommables opérations de soustraction et de division. Déchiffrer le monde à travers l’ordre et l’organisation pour configurer les éléments, qui fit écrire à Platon devant le frontispice de l’Académie « que nul n’entre ici s’il n’est géomètre » (mathématicien) fut subverti en négations humaines. Trier, compter pour démembrer, participaient d’une action d’épuration. Le choix d’un symbole, celui de l’indépendance, pour arracher à la vie des hommes qui n’étaient coupables que d’être des Négro-Mauritaniens, de parler Peulh, Soninké, Wolof, constitua une épreuve de plus. Désormais la fête de l’indépendance est ainsi marquée du sceau négatif de ces vies brisées. D’autres exécutions suivront sans faire sourciller les membres de la hiérarchie militaire. C’est dire à quel point la négation d’autrui et de sa dignité fut entreprise comme une besogne d’état par des officiels et leurs fidèles suppôts.
L’Etat porta au paroxysme la prescription d’une identité, une citoyenneté à sens unique, refusa sa dimension plurielle par l’amputation. La Mauritanie comme entité est alors doublement niée dans ses racines africaines et arabes. La singularité des hommes et de leurs cultures devint suspecte et finit par l’assassinat. Dans un riche rappel du sens et de la promotion de la tolérance, Claude Lévi-Strauss nous enseigne dans Race et histoire : « La diversité des cultures humaines est derrière nous, autour de nous, devant nous. La seule exigence que nous puissions faire valoir à son endroit est qu’elle se réalise sous des formes dont chacune soit une contribution à la plus grande générosité des autres.»
Mais la scission l’emporta sur ce « qui scellait » la république. Derrière le carnaval de célébration la mort, dans ce qui était l’annonce d’une espérance, nous nous effondrâmes du naufrage des idées de fraternité et de communauté de destin. Dans l’idéal d’une cohésion des nationalités les forces de division n’ont jamais cessé d’être à l’œuvre. Dans ce qui fut appelé « les événements », dans un trouble saisissant de l’esprit, les plus fines plumes dont le président des maires de l’époque, se mirent à tout justifier dès les premières heures des déportations : l’esclavage, l’expropriation des terres aux habitants de la vallée, la désignation d’une communauté. Le quotidien national Horizons ancien Chaab, censé être dépositaire de la représentation nationale de tout citoyen mauritanien, se répandit dans le journalisme de crispation et d’intolérance. Dans le déchaînement des médias de la haine, les éditoriaux donnaient dans des titres à l’évocation sans équivoque. La volonté des Négro-Mauritaniens de préserver leur patrimoine, la terre, passait pour de « L’Egoïsme enragé ». Volonté qui pour un rédacteur en chef bien en vue n’était destiné qu’à « priver les Pulaars mal nés du Fouta». C’est tel philosophe, écrivain de surcroit, qui dans l’envers du précepte aristotélicien « Je suis davantage amoureux de la vérité »se fit l’interviewer glorieux à la télévision mauritanienne d’un militant de l’extrême droite française.
Ce ne fut donc ni l’œuvre d’un tyran ni de quelques illuminés mais bien d’une pensée qui trouva en Ould Taya l’arme fatale, en son régime le manifeste d’une violence acérée qui nous extorqua le rêve d’une république possible avec toutes ses originalités culturelles. La proscription délibérée de l’entité multinationale s’étalait à tous les niveaux : administration, armée, éducation et culture. Les scènes répressives se répétaient dans une phase toujours ascendante, pour finir par des exécutions extrajudiciaires. Des civilisations qui ont préservé leur personnalité historique depuis les temps anciens furent interdites d’expression.
Un totalitarisme naissant aux accents de douceur et de tromperie guette encore. L’arbitraire ne tient plus à la mitraillette mais à une omission volontaire avec la bénédiction d’en haut : tout tient dans le carnet du fonctionnaire dont les humeurs variables décident qui est mauritanien et qui ne l’est pas, avec l’encouragement du gouvernement. Aucun recours n’est possible contre de tels agissements. Apatrides de l’intérieur par un recensement qui va dépeupler la Mauritanie de sa composante africaine est l’aspect récent de la nouvelle exclusion. L’état civil présenté comme le socle de statistiques fiables, comme proposition d’objectivité, n’est en réalité qu’une fabrique d’une manipulation plus élaborée de la citoyenneté. L’Etat, dans le registre partisan qui est le sien, décide à lui seul des élus et des relégués, se ferme au débat sur une question aussi importante, instaure de fait une fracture entre citoyens d’un même Etat, use de la violence systématique pour toute forme de contestation. Ainsi une figure du Négro-Mauritanien est construite, il devient un schéma : le contraste de l’arabité. S’édifie alors une ligne intérieure, un moule idéologique jamais avoué mais qui inspire toute la politique menée jusqu’ici, à l’exception du courageux pouvoir démocratique du président Sidi Ould Cheikh Abdallahi. La discrimination s’insinue, rend toujours plus marginale la composante négro-mauritanienne. C’est une ligne directrice à laquelle les différents régimes se sont attelés. Intérioriser un non dit, celui de donner toujours plus à la communauté arabe de Mauritanie, principe d’une discrimination négative que Calliclès, dans une incompréhension de l’essence de la justice opposait à Socrate comme ce qui est « l’avantageux au plus fort ». Ould Abdel Aziz ne fait pas exception. Il inaugure même une forme de réparation et d’attention mais dans une volonté de contrôle plus efficace. Conscient que la violence ne peut parfaire une domination, il trouva en l’état civil un moyen plus neutre, plus sûr même, puisqu’accepté par les bailleurs de fond au nom de la lutte contre le terrorisme. Auto-défense d’un système qui absout les crimes par une loi d’amnistie en même temps qu’il l’associe à l’objectif noble d’unité nationale. Ruse d’unité factice quand l’exigence de justice n’est pas le rempart de l’Etat, quand l’Etat de droit fait défaut.
Ainsi c’est à la constitution, résultat d’un contrat multinational, de préserver la coexistence pacifique, inspirée d’une éthique égalitaire. La coexistence de nos différentes nationalités doit découler de leur reconnaissance sans prééminence d’un groupe sur un autre, d’une culture sur une autre. L’Etat est si mal parti qu’il faut le refonder en son caractère multinational en aménageant un dispositif de droits qui garantissent la représentation politique, la langue, la nationalité, l’emploi, une école pour tous où le prétexte d’une unité de culture et de formation ne doit pas servir d’instance ségrégative contre une communauté, notamment négro-mauritanienne. Claude Lévi-Strauss notait dans Tristes tropiques que « Le consentement est à l’origine du pouvoir, et c’est aussi le consentement qui entretient sa légitimité.»
Un tel prérequis d’une configuration dynamique de la cohésion nationale n’est pas d’actualité. Il existe même des signes alarmants d’hégémonie culturelle comme l’attestent les dernières lois sur l’audiovisuel privé où radios et télévisions privées sont obligées d’émettre majoritairement en Hassanya alors que la BBC à Londres a des éditions intégrales, de manière continue, en langues étrangères ; de même qu’aux Etats-Unis nombreux sont les organes de presse éditant uniquement en Espagnol sur le sol américain où pourtant l’Anglais est prépondérant. Ainsi le sésame démocratique n’a mis fin ni à l’esclavage, ni au racisme d’Etat, ni à la gabégie, aux grandes injustices qui gangrènent le pays.
Et Marx, dans le désordre qui caractérisait la montée de la bourgeoisie, écrivait dans une lettre en mai 1843 : « Vous ne direz pas que je me fais une trop haute idée du temps présent, et si malgré tout je ne désespère pas de lui, c’est que sa situation désespérée est précisément ce qui m’emplit d’espoir. »
Je ne pourrai mieux conclure en plaçant cet espoir dans l’engagement de deux figures de proue que sont Birane Ould Abeïd et Abdoul Birane WANE. Incarnation d’une société civile nouvelle, leurs organisations posent les questions fondamentales dont les résolutions détermineront l’avenir serein de notre pays. : rien de plus ni rien de moins qu’une citoyenneté entière pour tous, la primauté généralisée de la règle de droit, en lieu et place des conservatismes arriérés, nulle distinction autre que celle fondée sur l’utilité publique. La société civile, par sa vigilance alerte, se présente ainsi comme notre conscience de soi. Accompagner ce mouvement, comme le font l’AJD et le PLEJ, exige l’émergence d’une force de dépassement dont le nœud est l’opposition à toutes les lois iniques : lois d’amnistie, sur l’éducation nationale pérennisant l’injustice et l’exclusion. Le sens de la modernité démocratique se jaugera en fonction des droits culturels et sociaux effectifs et réels, dans une garantie de la préservation et de l’expression de la culture de chacune de nos nationalités. C’est donc dans une large autonomie du Sud au sein d’une dynamique fédérale que se trouvent les chances d’un ancrage démocratique. En somme il n’ ya de monde que par le territoire. Et c’est quand les hommes et les femmes contrôleront au sein de leur territoire, là où ils vivent, les moyens de production et d’échange, qu’ils pourront avoir le sentiment de la maîtrise de leur existence. Ce jour où l’administration des choses se substituera au gouvernement des hommes où des citoyens décident dans une libre association l’institution du vivre-ensemble, le vent de liberté se lèvera alors à partir de l’Eden matinal de nos souffrances affranchies.
Erratum: au lieu de lire l'hybris, il faudrait lire l'hubris; et au lieu de lire Monembo il faudrait plutôt lire Monénembo comme s'écrit le nom de l'écrivain guinéen cité.
BÂ Kassoum Sidiki
Pour avomm.com
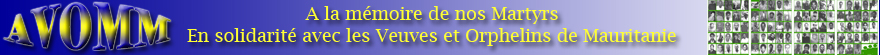
 Actualités
Actualités



















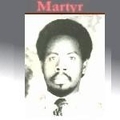
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)