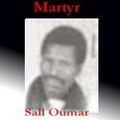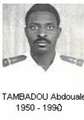Dans une perspective diachronique, l’Afrique en tant qu’objet d’étude n’a été investie que très récemment par la science politique.
Il est commun aujourd’hui de rappeler que dans la division du travail académique entre disciplines des sciences sociales, c’est l’anthropologie (pensons à Evans Pritchard ou plus près de nous à Balandier), qui a hérité des objets considérés comme exotiques.
Parmi ceux-ci bien évidemment, l’Afrique occupe encore une place charnière peu enviable, dans la mesure où elle en rend l’intérêt académiquement moins légitime dans la science politique dominante.
C’est ainsi qu’un auteur qui travaille sur la question de la démocratisation en Amérique latine est un transitologue, c’est à dire un politiste travaillant sur les transitions, alors que son collègue travaillant sur l’Afrique est un africaniste.
Il ne s’agit pas là simplement de nommer, mais aussi d’apposer un label, beaucoup de chercheurs croyant à tort qu’un africaniste est familier avec l’Afrique et les faits, mais étranger aux autres objets et aux questions théoriques.
Pendant longtemps, c’est tout au plus la perspective historique qui a contribué à épauler les perspectives anthropologiques en cherchant à mieux connaître les structures et formations politiques précoloniales et coloniales ainsi qu’on peut le voir dans les travaux d’auteurs africains comme Elikia Mbokolo, Joseph Ki Zerbo ou Cheikh Anta Diop.
Un bon archétype de travail historique débordant sur le politique est entre autres l’ouvrage de Crawford Young consacré dans une perspective comparative, à l’État colonial et à sa reproduction dans les États post coloniaux en Afrique (1994).
Cette quasi absence de travaux de science politique (et donc de recherches en politique comparée) dans les premières recherches sur l’Afrique a ensuite reçu des réponses différentes selon que l’on se place à l’intérieur ou à l’extérieur du continent.
De l’extérieur, les indépendances et l’émergence de nouveaux États ont donné naissance à des études comparatives et des concepts nouveaux (Harbeson et Rothchild, 1995). Ce renouvellement tient beaucoup aux théories du développement et de la modernisation politique ainsi que nous le verrons plus loin.
De l’intérieur, le vide n’a pas été comblé de manière brutale et massive même avec les indépendances comme on aurait pu s’y attendre.
(.....)
Le premier obstacle au développement de la politique comparée en Afrique tient à l’atrophie du cadre institutionnel de la science politique.
Comme on le sait, toute discipline acquiert son autonomie en créant son champ et en se donnant de la visibilité à travers la médiation d’infrastructures distinctes de celles des autres disciplines ainsi d’une communauté savante organisée.
Dans le cas de l’Afrique, la première condition fait cruellement défaut en ce qui concerne la science politique en partie parce que cette discipline ne constitue pas une priorité dans les politiques d’éducation lorsque celles-ci existent.
Comme la sociologie, la science politique a souffert tout au long des trois premières décennies post indépendances dominées par les autoritarismes, du préjugé selon lequel elle n’est rien d’autre qu’une discipline spéculative et subversive.
L’État détenant les cordons de la bourse en matière de financement de l’éducation, les élites dirigeantes ne pouvaient alors favoriser le développement de la recherche dans un domaine potentiellement contestataire (Zeleza, 1997 : chap. 3).
En Afrique de l’Ouest, le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont aujourd’hui encore, les rares pays, avec les pays anglophones (Nigeria et Ghana), à disposer de départements de science politique et/ou d’associations de science politique vraiment fonctionnelles.
La situation du Cameroun fait même franchement figure de bonne ‘‘anomalie’’ dans l’espace francophone puisque ce pays dispose de six universités au sein desquelles la science politique gagne progressivement son autonomie.
Dans d’autres pays francophones en effet, l’atrophie du cadre institutionnel universitaire est telle qu’il existe au mieux, un cours de science politique dispensé dans les facultés de droit, parfois par des juristes de formation.
Cette situation doit beaucoup à l’histoire du contrôle des relations avec les universités du Sud, exercé moins par les politologues que par les juristes français, souvent peu enthousiasmés par l’idée d’une science politique autonome et concurrente du Droit.
La conséquence immédiate de cette faiblesse institutionnelle c’est la faiblesse de la communauté des chercheurs et d’enseignants qui, il faut le relever cependant, s’est accrue de manière appréciable et continue à s’accroître ces dernières années.
D’énormes disparités demeurent cependant entre les pays. Au Niger par exemple, il y a seulement une demi douzaine de docteurs en science politique et bien évidemment, aucune structure académique consacrée à la discipline.
Mamoudou GAZIBO
Université de Montréal
Source: ressources-africaines
Il est commun aujourd’hui de rappeler que dans la division du travail académique entre disciplines des sciences sociales, c’est l’anthropologie (pensons à Evans Pritchard ou plus près de nous à Balandier), qui a hérité des objets considérés comme exotiques.
Parmi ceux-ci bien évidemment, l’Afrique occupe encore une place charnière peu enviable, dans la mesure où elle en rend l’intérêt académiquement moins légitime dans la science politique dominante.
C’est ainsi qu’un auteur qui travaille sur la question de la démocratisation en Amérique latine est un transitologue, c’est à dire un politiste travaillant sur les transitions, alors que son collègue travaillant sur l’Afrique est un africaniste.
Il ne s’agit pas là simplement de nommer, mais aussi d’apposer un label, beaucoup de chercheurs croyant à tort qu’un africaniste est familier avec l’Afrique et les faits, mais étranger aux autres objets et aux questions théoriques.
Pendant longtemps, c’est tout au plus la perspective historique qui a contribué à épauler les perspectives anthropologiques en cherchant à mieux connaître les structures et formations politiques précoloniales et coloniales ainsi qu’on peut le voir dans les travaux d’auteurs africains comme Elikia Mbokolo, Joseph Ki Zerbo ou Cheikh Anta Diop.
Un bon archétype de travail historique débordant sur le politique est entre autres l’ouvrage de Crawford Young consacré dans une perspective comparative, à l’État colonial et à sa reproduction dans les États post coloniaux en Afrique (1994).
Cette quasi absence de travaux de science politique (et donc de recherches en politique comparée) dans les premières recherches sur l’Afrique a ensuite reçu des réponses différentes selon que l’on se place à l’intérieur ou à l’extérieur du continent.
De l’extérieur, les indépendances et l’émergence de nouveaux États ont donné naissance à des études comparatives et des concepts nouveaux (Harbeson et Rothchild, 1995). Ce renouvellement tient beaucoup aux théories du développement et de la modernisation politique ainsi que nous le verrons plus loin.
De l’intérieur, le vide n’a pas été comblé de manière brutale et massive même avec les indépendances comme on aurait pu s’y attendre.
(.....)
Le premier obstacle au développement de la politique comparée en Afrique tient à l’atrophie du cadre institutionnel de la science politique.
Comme on le sait, toute discipline acquiert son autonomie en créant son champ et en se donnant de la visibilité à travers la médiation d’infrastructures distinctes de celles des autres disciplines ainsi d’une communauté savante organisée.
Dans le cas de l’Afrique, la première condition fait cruellement défaut en ce qui concerne la science politique en partie parce que cette discipline ne constitue pas une priorité dans les politiques d’éducation lorsque celles-ci existent.
Comme la sociologie, la science politique a souffert tout au long des trois premières décennies post indépendances dominées par les autoritarismes, du préjugé selon lequel elle n’est rien d’autre qu’une discipline spéculative et subversive.
L’État détenant les cordons de la bourse en matière de financement de l’éducation, les élites dirigeantes ne pouvaient alors favoriser le développement de la recherche dans un domaine potentiellement contestataire (Zeleza, 1997 : chap. 3).
En Afrique de l’Ouest, le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont aujourd’hui encore, les rares pays, avec les pays anglophones (Nigeria et Ghana), à disposer de départements de science politique et/ou d’associations de science politique vraiment fonctionnelles.
La situation du Cameroun fait même franchement figure de bonne ‘‘anomalie’’ dans l’espace francophone puisque ce pays dispose de six universités au sein desquelles la science politique gagne progressivement son autonomie.
Dans d’autres pays francophones en effet, l’atrophie du cadre institutionnel universitaire est telle qu’il existe au mieux, un cours de science politique dispensé dans les facultés de droit, parfois par des juristes de formation.
Cette situation doit beaucoup à l’histoire du contrôle des relations avec les universités du Sud, exercé moins par les politologues que par les juristes français, souvent peu enthousiasmés par l’idée d’une science politique autonome et concurrente du Droit.
La conséquence immédiate de cette faiblesse institutionnelle c’est la faiblesse de la communauté des chercheurs et d’enseignants qui, il faut le relever cependant, s’est accrue de manière appréciable et continue à s’accroître ces dernières années.
D’énormes disparités demeurent cependant entre les pays. Au Niger par exemple, il y a seulement une demi douzaine de docteurs en science politique et bien évidemment, aucune structure académique consacrée à la discipline.
Mamoudou GAZIBO
Université de Montréal
Source: ressources-africaines
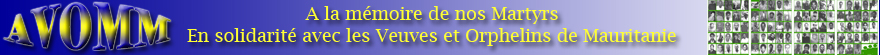
 Actualités
Actualités





















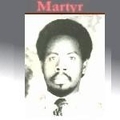
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)