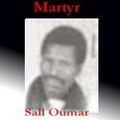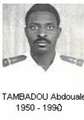Les enseignants que « Le Monde » a interrogés observent les violences urbaines avec d’autant plus d’affliction qu’une large partie des émeutiers sont en âge d’être leurs élèves. Ils décrivent l’amertume et l’humiliation de ceux à qui ils tentent de transmettre les valeurs républicaines.
Le vertige du pressentiment a rapidement succédé à l’effroi des images. Il était environ midi, mardi 27 juin lorsque Claire (les enseignants cités par leur prénom ont souhaité rester anonymes) a appris la mort de Nahel M., 17 ans, tué par un policier à Nanterre. « J’ai eu l’impression d’un jet de flammes sur un baril de poudre », relate l’enseignante d’histoire-géographie au lycée Joliot-Curie de la préfecture des Hauts-de-Seine, chez qui l’inquiétude monte vite quant au risque d’embrasement. Elle sait qu’une bonne partie des élèves de l’établissement vit dans les tours de la cité Pablo-Picasso, et apprend qu’ils sont très nombreux à connaître Nahel. Elle connaît aussi la tension permanente entre ces jeunes et la police. « Dans notre travail, on sent du désespoir et de la colère chez nos élèves et anciens élèves, qui peuvent les pousser à une forme de nihilisme », explique la professeure, en poste à Nanterre depuis 2009.
Comme elle, tous les enseignants de banlieues que Le Monde a interrogés observent les violences qui ont émaillé les nuits et certaines journées de centaines de communes françaises depuis mercredi avec d’autant plus d’affliction qu’une large partie des émeutiers sont en âge d’être leurs élèves : un tiers des 2 000 personnes interpellées depuis le début des troubles ont moins de 18 ans, certains sont même âgés de 12 ans. En dépit du choc, chez eux domine le fatalisme de ceux qui constatent au quotidien que la crise est profonde.
« C’était une Cocotte-Minute, déplore Chiraz, enseignante de physique-chimie dans un collège de Garges-lès-Gonesse, où la mairie a été incendiée et où des appels à s’en prendre au collège ont circulé sur les réseaux sociaux. Tous les éléments étaient réunis pour que ça tourne mal. » A commencer par la fracture entre la police et les adolescents, que la vidéo de la mort de Nahel est venue creuser un peu plus. Chiraz qui, à 35 ans, n’a « jamais eu affaire à la police que pour demander [son] chemin », travaille avec des élèves, notamment des garçons, qui, dès 11 ou 12 ans, témoignent de contrôles, de fouilles, d’invectives, de courses-poursuites avec les forces de l’ordre, voire d’altercations violentes. « Les violences policières font partie de leur vie, ils ne voient pas la police comme une protection », observe la professeure, à qui ses collègues font tous échos pour décrire un profond sentiment « d’arbitraire ».
« La violence fait partie de leur vie »
A Montreuil, Benjamin Marol entend aussi cette « peur de la police » que partagent beaucoup de ses collégiens de REP +. L’enseignant d’histoire-géographie est parfois amené à aborder les émeutes de 2005 en 3e et a face à lui certains élèves qui, bien que beaucoup trop jeunes pour avoir connu les événements, connaissent l’histoire de Zyed Benna et Bouna Traoré, morts électrocutés à Clichy-sous-Bois en 2005 en essayant de fuir un contrôle de police. Il constate surtout chez tous, ou presque, la même réaction : « Je sais qu’une partie des gens se demanderaient pourquoi ces jeunes courent s’ils n’ont rien à se reprocher mais, moi, mes élèves disent que, “évidemment”, ils partent en courant quand ils voient la police. »
Au-delà de cette défiance que les années ancrent chez leurs élèves, la communauté éducative de ces « quartiers sensibles », dont la géographie épouse celle de la précarité et de la ségrégation sociospatiale, voit aussi dans l’explosion de violences le fruit d’un sentiment de relégation contre lequel l’école, service public pourtant présent dans tous les territoires, a du mal à lutter.
« On leur transmet et on essaye de faire vivre les valeurs républicaines de “liberté, égalité, fraternité”, mais les élèves nous disent qu’ils ne vivent aucun de ces trois mots », constate Gundo Diawara, conseillère principale d’éducation en collège à Garges-lès-Gonesse et secrétaire nationale du Front de mères. Dans cette ville, le taux de pauvreté approche les 40 %. « Nos élèves habitent à 15 minutes de Paris gare du Nord et vivent dans une profonde précarité, la violence fait partie de leur vie, ils manquent de services publics et ils ont l’impression d’être abandonnés face à tout ça », abonde Chiraz, l’enseignante de physique-chimie. L’an dernier, dans l’engrenage des guerres de gangs, un adolescent a été poignardé dans le lycée de secteur, que beaucoup de ses élèves de 3e cherchent désormais à fuir. « Ils ont demandé des dérogations pour l’éviter, mais aucune n’a été acceptée. Les élèves ont peur d’y aller, mais on n’a rien d’autre à leur proposer », se désole l’enseignante.
Le poids de l’ancrage social
S’ajoute une lente détérioration des services publics qui ne fait qu’accentuer les difficultés. « On manque d’infirmières scolaires, d’assistantes sociales, de profs, on a trop peu de médiateurs, de centres sociaux…, liste Abdel Mesbahi, parent d’élève FCPE dans les Hauts-de-Seine, qui rappelle que « la sonnette d’alarme est tirée depuis des années ».
« Nous connaissons de grandes réussites dans les quartiers, les élèves réalisent de belles choses, mais l’école ne peut pas lutter contre tous les maux sociaux. Nous les formons à une citoyenneté dans laquelle ils ne se retrouvent souvent pas dans leur quotidien », analyse Mohand-Kamel Chabane, professeur d’histoire-géographie à Paris et coauteur de Parce que chaque élève compte (éditions de l’Atelier).
Ces enseignants le savent, le poids de l’ancrage social entache la promesse de l’école de la République pour leurs élèves. Presque 95 % des collèges d’éducation prioritaire renforcée (REP +) se situent parmi le quart des établissements ayant les plus faibles moyennes à l’écrit du brevet. Près des trois quarts des élèves de 6e de ces établissements ont des parents ouvriers ou inactifs, deux fois plus que dans le reste de l’enseignement public, quatre fois plus que dans le privé sous contrat. Les élèves les plus fragiles socialement et scolairement sont surreprésentés en lycée professionnel, où un tiers des élèves décrochent, et à l’issue duquel seule la moitié des bacheliers a un emploi au bout d’an, tandis que seuls 53 % de ceux qui poursuivent leurs études obtiennent leur BTS en deux ou trois ans.
Sentiment d’impuissance
« Ce sont des populations stigmatisées, précarisées et ghettoïsées où l’amertume et l’humiliation laissent place à la colère et la rage viscérale », se désespère un directeur d’école de Creil, dans l’Oise, qui a requis l’anonymat. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un groupe de jeunes adolescents a tenté de s’en prendre à l’établissement après avoir incendié des voitures et des commerces. Le gardien, présent, est parvenu et les en dissuader, rappelant que l’école était celle de « leur petits frères et sœurs ». « Ces gamins étaient dans mes classes il y a quelques années…, se désole cet homme de 50 ans face à ce cercle vicieux. Ce sont des décennies de travail dans nos quartiers qui partent en fumée. »
Depuis des jours, les enseignants des quartiers s’interrogent. Dans quelle mesure leurs élèves sont-ils impliqués dans les actes de violence et les dégradations, que toute la communauté éducative condamne ? Même s’ils ne le sont pas, comment vivent-ils ce moment ? « L’effet de groupe et les réseaux sociaux sont de nature à entraîner de nombreux adolescents, même ceux qui ne revendiquent rien », estime Arthur, professeur d’éducation physique et sportive dans un collège de Seine-et-Marne. Dans ses classes, il « voi[t] très bien quels gamins risquent de s’engouffrer » et « espère surtout que, si ça dérape, ils ne seront pas là ».
Ils partagent aussi le même sentiment d’impuissance et la même appréhension pour les jours à venir, alors que les cours ont pris fin dans les collèges et lycées. « Il n’y a plus moyen d’échanger, de mettre des mots, de réfléchir avec eux à ce qu’il se passe, de prendre du recul », regrette Séverine, professeure dans un lycée de la proche banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Comme ses collègues, elle ignore si ses élèves sont dans la rue, mais sait que, quoi qu’il en soit, « l’école ne pourra pas faire tampon ».
Eléa Pommiers
Source : Le Monde
Le vertige du pressentiment a rapidement succédé à l’effroi des images. Il était environ midi, mardi 27 juin lorsque Claire (les enseignants cités par leur prénom ont souhaité rester anonymes) a appris la mort de Nahel M., 17 ans, tué par un policier à Nanterre. « J’ai eu l’impression d’un jet de flammes sur un baril de poudre », relate l’enseignante d’histoire-géographie au lycée Joliot-Curie de la préfecture des Hauts-de-Seine, chez qui l’inquiétude monte vite quant au risque d’embrasement. Elle sait qu’une bonne partie des élèves de l’établissement vit dans les tours de la cité Pablo-Picasso, et apprend qu’ils sont très nombreux à connaître Nahel. Elle connaît aussi la tension permanente entre ces jeunes et la police. « Dans notre travail, on sent du désespoir et de la colère chez nos élèves et anciens élèves, qui peuvent les pousser à une forme de nihilisme », explique la professeure, en poste à Nanterre depuis 2009.
Comme elle, tous les enseignants de banlieues que Le Monde a interrogés observent les violences qui ont émaillé les nuits et certaines journées de centaines de communes françaises depuis mercredi avec d’autant plus d’affliction qu’une large partie des émeutiers sont en âge d’être leurs élèves : un tiers des 2 000 personnes interpellées depuis le début des troubles ont moins de 18 ans, certains sont même âgés de 12 ans. En dépit du choc, chez eux domine le fatalisme de ceux qui constatent au quotidien que la crise est profonde.
« C’était une Cocotte-Minute, déplore Chiraz, enseignante de physique-chimie dans un collège de Garges-lès-Gonesse, où la mairie a été incendiée et où des appels à s’en prendre au collège ont circulé sur les réseaux sociaux. Tous les éléments étaient réunis pour que ça tourne mal. » A commencer par la fracture entre la police et les adolescents, que la vidéo de la mort de Nahel est venue creuser un peu plus. Chiraz qui, à 35 ans, n’a « jamais eu affaire à la police que pour demander [son] chemin », travaille avec des élèves, notamment des garçons, qui, dès 11 ou 12 ans, témoignent de contrôles, de fouilles, d’invectives, de courses-poursuites avec les forces de l’ordre, voire d’altercations violentes. « Les violences policières font partie de leur vie, ils ne voient pas la police comme une protection », observe la professeure, à qui ses collègues font tous échos pour décrire un profond sentiment « d’arbitraire ».
« La violence fait partie de leur vie »
A Montreuil, Benjamin Marol entend aussi cette « peur de la police » que partagent beaucoup de ses collégiens de REP +. L’enseignant d’histoire-géographie est parfois amené à aborder les émeutes de 2005 en 3e et a face à lui certains élèves qui, bien que beaucoup trop jeunes pour avoir connu les événements, connaissent l’histoire de Zyed Benna et Bouna Traoré, morts électrocutés à Clichy-sous-Bois en 2005 en essayant de fuir un contrôle de police. Il constate surtout chez tous, ou presque, la même réaction : « Je sais qu’une partie des gens se demanderaient pourquoi ces jeunes courent s’ils n’ont rien à se reprocher mais, moi, mes élèves disent que, “évidemment”, ils partent en courant quand ils voient la police. »
Au-delà de cette défiance que les années ancrent chez leurs élèves, la communauté éducative de ces « quartiers sensibles », dont la géographie épouse celle de la précarité et de la ségrégation sociospatiale, voit aussi dans l’explosion de violences le fruit d’un sentiment de relégation contre lequel l’école, service public pourtant présent dans tous les territoires, a du mal à lutter.
« On leur transmet et on essaye de faire vivre les valeurs républicaines de “liberté, égalité, fraternité”, mais les élèves nous disent qu’ils ne vivent aucun de ces trois mots », constate Gundo Diawara, conseillère principale d’éducation en collège à Garges-lès-Gonesse et secrétaire nationale du Front de mères. Dans cette ville, le taux de pauvreté approche les 40 %. « Nos élèves habitent à 15 minutes de Paris gare du Nord et vivent dans une profonde précarité, la violence fait partie de leur vie, ils manquent de services publics et ils ont l’impression d’être abandonnés face à tout ça », abonde Chiraz, l’enseignante de physique-chimie. L’an dernier, dans l’engrenage des guerres de gangs, un adolescent a été poignardé dans le lycée de secteur, que beaucoup de ses élèves de 3e cherchent désormais à fuir. « Ils ont demandé des dérogations pour l’éviter, mais aucune n’a été acceptée. Les élèves ont peur d’y aller, mais on n’a rien d’autre à leur proposer », se désole l’enseignante.
Le poids de l’ancrage social
S’ajoute une lente détérioration des services publics qui ne fait qu’accentuer les difficultés. « On manque d’infirmières scolaires, d’assistantes sociales, de profs, on a trop peu de médiateurs, de centres sociaux…, liste Abdel Mesbahi, parent d’élève FCPE dans les Hauts-de-Seine, qui rappelle que « la sonnette d’alarme est tirée depuis des années ».
« Nous connaissons de grandes réussites dans les quartiers, les élèves réalisent de belles choses, mais l’école ne peut pas lutter contre tous les maux sociaux. Nous les formons à une citoyenneté dans laquelle ils ne se retrouvent souvent pas dans leur quotidien », analyse Mohand-Kamel Chabane, professeur d’histoire-géographie à Paris et coauteur de Parce que chaque élève compte (éditions de l’Atelier).
Ces enseignants le savent, le poids de l’ancrage social entache la promesse de l’école de la République pour leurs élèves. Presque 95 % des collèges d’éducation prioritaire renforcée (REP +) se situent parmi le quart des établissements ayant les plus faibles moyennes à l’écrit du brevet. Près des trois quarts des élèves de 6e de ces établissements ont des parents ouvriers ou inactifs, deux fois plus que dans le reste de l’enseignement public, quatre fois plus que dans le privé sous contrat. Les élèves les plus fragiles socialement et scolairement sont surreprésentés en lycée professionnel, où un tiers des élèves décrochent, et à l’issue duquel seule la moitié des bacheliers a un emploi au bout d’an, tandis que seuls 53 % de ceux qui poursuivent leurs études obtiennent leur BTS en deux ou trois ans.
Sentiment d’impuissance
« Ce sont des populations stigmatisées, précarisées et ghettoïsées où l’amertume et l’humiliation laissent place à la colère et la rage viscérale », se désespère un directeur d’école de Creil, dans l’Oise, qui a requis l’anonymat. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un groupe de jeunes adolescents a tenté de s’en prendre à l’établissement après avoir incendié des voitures et des commerces. Le gardien, présent, est parvenu et les en dissuader, rappelant que l’école était celle de « leur petits frères et sœurs ». « Ces gamins étaient dans mes classes il y a quelques années…, se désole cet homme de 50 ans face à ce cercle vicieux. Ce sont des décennies de travail dans nos quartiers qui partent en fumée. »
Depuis des jours, les enseignants des quartiers s’interrogent. Dans quelle mesure leurs élèves sont-ils impliqués dans les actes de violence et les dégradations, que toute la communauté éducative condamne ? Même s’ils ne le sont pas, comment vivent-ils ce moment ? « L’effet de groupe et les réseaux sociaux sont de nature à entraîner de nombreux adolescents, même ceux qui ne revendiquent rien », estime Arthur, professeur d’éducation physique et sportive dans un collège de Seine-et-Marne. Dans ses classes, il « voi[t] très bien quels gamins risquent de s’engouffrer » et « espère surtout que, si ça dérape, ils ne seront pas là ».
Ils partagent aussi le même sentiment d’impuissance et la même appréhension pour les jours à venir, alors que les cours ont pris fin dans les collèges et lycées. « Il n’y a plus moyen d’échanger, de mettre des mots, de réfléchir avec eux à ce qu’il se passe, de prendre du recul », regrette Séverine, professeure dans un lycée de la proche banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Comme ses collègues, elle ignore si ses élèves sont dans la rue, mais sait que, quoi qu’il en soit, « l’école ne pourra pas faire tampon ».
Eléa Pommiers
Source : Le Monde
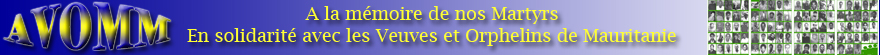
 Actualités
Actualités





















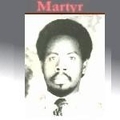
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)