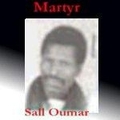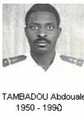C’est mon grand frère Saidou KANE (paix à son âme) qui le disait : « la violence, c’est l’échec de la politique ». Nous y ajouterons, c’est tout simplement l’échec de l’homme. Après les violences universitaires de ces derniers jours, prions pour la paix. Mais la meilleure des prières, c’est un débat franc. Un débat sans haine ni rancune. Un débat qui mettrait en avant l’intérêt de la Mauritanie au lieu des intérêts égoïstes des uns et des autres. Un débat qui nous permettra de montrer au monde que nous avons suffisamment de cervelle pour résoudre nos différends par le verbe et non par l’épée. Un débat qui peut aussi démontrer que la violence ne servira aucun des camps en présence, alors qu’au contraire, elle ne fera que retarder voire ramener notre processus de développement aux années de l’ignorance et de la misère. La violence est le lit de la misère et la mamelle de la haine. Les problèmes du monde n'ont jamais été résolu durablement par les pôles extrêmes. Les extrêmes n'ont de tout temps suscité que souffrances et désolation. Les mauritaniens en connaissent quelque chose. Les années Taya sont là pour en témoigner.
Nous comprenons tout de même les passions suscitées ça et là. C’est que la question linguistique et culturelle constitue l’épine dorsale de la question nationale en Mauritanie. Elle suscite passion de part et d’autre des lignes de démarcations idéologiques et ethniques des mauritaniens. Par sa position sur la question linguistique, le mauritanien nous affirme son « camp » : celui d’une Mauritanie entièrement arabe ou à arabiser, celui d’une Mauritanie multinationale et multiculturelle, ou celui d’une Mauritanie « gangarienne » nostalgique d’un passé dont les fouilles accouchent avec difficulté la fierté d’une civilisation enfouie dans les décombres de l’Histoire. C’est que la langue et la culture ont de tout temps constitué les principaux attributs par lesquels les peuples déterminent leur identité et se valorisent face aux autres. C’est aussi des attributs pour lesquels l’autre est admiré, l’autre est méprisé, l’autre est accepté, l’autre est refusé. Quelqu’un disait que « la langue est l’âme d’un peuple ». L’âme, ce n’est pas seulement ce qui donne la fierté d’être et d’exister, c’est ce qui permet d’exister, c’est ce qui fait vivre. C’est pourquoi l’âme exige de tout temps respect et considération. Sans âme l’humain ne vit point, n’existe point. Ainsi, les conflits culturels et linguistiques deviennent des conflits pour l’existence, pour la vie. Le Beydane, d’origine arabe et berbère, tient aujourd’hui à son arabité face à une culture négro-africaine qui l’entoure de toutes parts et qu’il a épousée depuis des siècles. N’en déplaise aux « négationnistes », le Beydane est aujourd’hui l’addition de langues arabe et berbère à une culture négro-africaine. Ses castes, sa musique, son organisation sociale, ne relèvent en rien de l’arabité, mais d’une négritude que la Mauritanie doit apprendre à assumer. De l’autre côté, le Négro-africain, conscient de sa faiblesse institutionnelle et économique face au Nationaliste Beydane qui lutte, non seulement pour un retour aux sources de l’arabité de sa composante ethnico-culturelle, mais aussi pour une assimilation culturelle et linguistique de toutes les communautés nationales, exige la reconnaissance de ses valeurs pour la survie de son âme. Au milieu, le Hartaani, ancien esclave ou nègre oublié au fond des oasis par ses parents repliés vers le sud, tient à sa spécificité. Spécificité qui n’est non seulement linguistique et culturelle, mais aussi raciale. Car, pour faire la différence, il faut faire appel à la différence. Face au Négro-africain, le Hartaani exige la reconnaissance d’une culture désormais hybride, d’une histoire désormais singulière et d’une condition sociale particulière. Face au Beydane, la couleur de la peau et la condition sociale sont mises en avant. Le Beydane doit accepter et reconnaître la FAUTE. Si on n’exige pas de lui le pardon, il doit s’engager dans la réparation qui devra constituer la reconnaissance implicite de ses tords, prélude à toute forme de réconciliation. Le Négro-africain est prié de ne pas jouer le jeu égoïste de ses propres intérêts en voulant, au nom des liens de sang et de couleur, assimiler à sa personne les préoccupations particulières des esclaves et des anciens esclaves. Il est prié d’accepter les conséquences de l’Histoire qui a façonné une autre communauté, même si comme Hawwaa créée à partir des cotes d’Aadama, elle a été créée de sa chair et de son sang. Le Hartaani est singulier, le Hartaani se veut différent. La Mauritanie doit apprendre à en tenir compte.
L’originalité de la question mauritanienne réside dans le fait que le pays constitue le seul état au monde où blancs et noirs sont appelés à vivre ensemble, non pas de leur propre volonté, mais de celle du colonisateur. Aujourd’hui, force est de constater que les peuples, face à cette situation, ont acquis une certaine maturité dans la cohabitation. Ce qui manque, c’est la mise en service de cette maturité au service d’un idéal, pas républicain, mais humaniste. Si les émirats maures et berbères ont de tout temps coexisté avec les empires et les républiques d’Afrique noire voisines, ont noué des alliances, ont favorisé des mariages interethniques entre leurs leaders, jamais il n’a existé de projet officiel, ne serait-ce que napoléonien, de fusion de leurs états à l’image du projet français de rattachement de la rive droite du fleuve Sénégal à la colonie dite mauritanienne. Ce rattachement, même s’il a été fait dans l’injustice et le mépris des communautés noires, doit pouvoir aujourd’hui servir à la matérialisation de cet idéal humaniste. Le propre des sociétés modernes, avec toute la légitimité des préoccupations républicaines, c’est de mettre l’état, la nation, la frontière, au devant de tout, quitte à oublier l’homme, quitte à sacrifier la femme. C’est au nom de cet idéal républicain que le jacobinisme français a massacré la grande majorité des langues et cultures du territoire pour créer son état nation. C’est au nom de cet idéal aussi que les idéologues arabes baathistes ou nasséristes prônent la panarabisme. C’est au nom de cet idéal que les Kurdes sont massacrés en Irak, dominés en Turquie, ignorés en Syrie et en Iran, que les berbères sont priés de se taire en Algérie et au Maroc, que les tchetchènes sont martyrisés, que les tutsis sont tués, que le Darfour est brûlé et que les négro-mauritaniens sont déportés. Pour une fois, nous, mauritaniens, pourrons arriver à mettre l’humain au devant. A savoir que ce n’est ni la république, ni l’état, ni la nation qui créent notre volonté de vivre en commun, mais que c’est d’abord nous, en tant qu’humains, qui sommes le moteur de l’état, de la république, de la nation, et de notre volonté de cohabitation dans l’harmonie, la paix, la justice et l’égalité. L’humanisme c’est par rapport à l’autre. C’est cette posture et cette capacité à accepter l’autre comme étant moi. C’est cette capacité à voir la couleur de l’autre comme non pas la couleur d’une race, mais une couleur de l’humain. C’est cette posture du donner et du recevoir, comme le disait Khrisnamurti. C’est le fait d’accepter que ce qui lui appartient est à moi, et que ce qui me revient est à lui. Cette vision de la vie n’est assimilable ni au jacobinisme réducteur et assassin, ni au multiculturalisme diviseur et égoïste. Depuis mai 1968, les élites dites révolutionnaires de gauche, n’ont trouvé comme paravent face à la politique assimilationniste de la France que le droit à la différence. Malheureusement, ce droit à la différence a tout de suite été interprété comme un projet, un devoir, une obligation à la différence. En Mauritanie, l’opposition Noire (négro-africaine et haratine) a revendiqué la différence culturelle et/ou linguistique. Ce qu’on ne voit pas, c’est que le multiculturalisme, s’il peut être revendiqué, n’est pas un projet en soi, il est un fait. On peut tout au plus revendiquer son respect. Et encore. Il n’existe nulle part dans le monde un état monolingue ou monoculturel. Le multiculturalisme et le droit à la différence étaient des préoccupations de minorités occidentales face aux républiques « culturivores » qui ravageaient tout sur leur passage. En Afrique, la langue dominante institutionnellement parlant, était encore celle du colon. C’est pourquoi il nous semblait prématuré de parler de droit à la différence là où il n’y avait encore droit à l’existence pour aucune langue du pays. Les gauchistes africains ne l’avaient pas encore compris. Et cet état d’esprit fait encore des ravages dans de nombreux pays comme le Sénégal où le combat des minorités est plus dirigé contre le wolof que contre le français dont la position de langue officielle et d’éducation est plus qu’illégitime, inappropriée, et inacceptable. Cheikh Anta Diop était l’un des rares intellectuels africains à avoir compris cette situation en revendiquant l’éducation, l’administration et la formation dans les langues africaines. Il était le seul intellectuel qui liait indépendance politique et indépendance culturelle. Mais nous remarquerons que lui aussi était tombé dans le piège de l’idéal républicain jacobiniste. En proposant la wolofisation de la société sénégalaise, Cheikh Anta n’allait encore que creuser plus profondément la blessure des inégalités ethniques et culturelles qui polluent le paysage sénégalais. En Mauritanie, la situation peut sembler un peu différente. Depuis la colonisation, l’arabe résiste tant soit peu face au français. Mais l’arabe n’est jamais arrivé à supplanter le français à l’image de certains pays comme la Libye ou les pays du Golfe. C’est pourquoi le droit à la différence comme crédo politique peut sembler prématuré voire insensé pour certaines couches de la population. Mais si l’intellectuel ou l’opposant Noir revendique ce droit, c’est par conscience du projet des Nationalistes Beydanes qui voudrait, non seulement une Mauritanie débarrassée de la tutelle de la langue française, ce qui est légitime en soi, mais aussi et surtout une Mauritanie entièrement arabisée. Ce qui diviserait les Nationalistes arabes, ce n’est pas le projet en soi, mais les stratégies et les moyens à mettre en œuvre pour arriver à ses fins. Si pour les Nassériens l’assimilation à la française est légitimée par le fait que tous les mauritaniens sont musulmans, les Baathistes eux, prônent la solution radicale d’une purge par déportations voire d’un holocauste « humanisé ». C’est ce qu’ils ont tenté de mettre en œuvre depuis le conflit de 1989 en massacrant et en déportant des centaines de milliers de Noirs vers le Mali et le Sénégal, en purgeant l’armée par des massacres injustifiés, et en procédant à des licenciements massifs de l’armée, de la police, de la garde nationale, de la fonction publique et des sociétés d’état.
Le droit à la différence a eu comme effet de creuser le fossé entre l’intellectuel opposant Noir et sa base populaire. Même si la guerre civile de 1966 et le manifeste des 19 ont sonné la cloche de l’alerte, la base populaire mauritanienne à l’instar d’ailleurs de beaucoup de cadres, n’a véritablement pas vu arriver le feu qui menace encore de brûler la maison. Notre combat linguistique et culturel en tant qu’opposition crédible et digne de la confiance de notre peuple est double : c’est d’abord un combat commun contre la prééminence et la domination de la langue française, et un combat pour un projet de société dans laquelle tous se reconnaîtront mauritaniens à part entière. Pour cela, il faut oser.
Le droit à la différence a eu aussi comme principale conséquence, la vision essentiellement statistique des relations interethniques en Mauritanie. Dans le Manifeste du Négro-mauritanien Opprimé, les Forces de Libération Africaines de Mauritanie, démontraient à l’appui de statistiques irréfutables, comment culturellement et linguistiquement les noirs étaient dominés dans le pays. Mais cette analyse ne fait pas état de l’aspect qualitatif des relations interculturelles. Si à la radio et à la télévision nationales la visibilité d’une telle domination ne nécessite aucune étude statistique, une étude qualitative quant à elle s’impose pour le mauritanien moyen. C’est la négritude senghorienne qui louait le sens dans la culture négro-africaine en qualifiant la raison d’hellène. Encore aujourd’hui, dans une certaine élite et chez la majorité des populations africaines, le développement reste lié aux langues et cultures européennes. C’est cette conception de la langue qui est transposée dans nos quotidiens culturels, à la radio, et à la télévision. Tout ce qui est moderne, musique ou information scientifique ou politique, est donné dans la langue française. On ne peut même pas « demander un disque des auditeurs » en pulaar, wolof, ou sooninké si le morceau choisi relève de la musique moderne. On n’a le droit d’écouter Bob Marley ou Michael Jakson que si on parle et comprend français. Les informations ne sont données entièrement qu’en français et en arabe. En Pulaar par exemple, le journal parlé est presque entièrement consacré au Tagge (avis de décès) de Amadou Tidiane BAL. C’est la même situation pour le wolof et le soninké. Cette situation est justifiée par le fait que même chez l’opposition ou certains « militants » de la promotion des langues nationales, le français doit rester cette Langue « d’Ouverture ». Mais comment peut-elle assumer son statut de Langue d’Ouverture si à cause d’elle Mr Diallo ou Mr Kane qui ne comprend pas français, ne sait pas que la mondialisation est entrain de l’achever à petits feux. La véritable Ouverture, c’est la promotion d’émissions culturelles et scientifiques dans nos langues nationales. Des émissions qui permettent à nos concitoyens d’être au courant et au diapason de la marche de la modernité, des émissions qui leur permettent de connaître d’autres modes de vies, d’autres peuples, d’autres civilisations et d’autres cultures. Ceci ne peut se faire que dans leurs langues qu’ils comprennent. La Langue d’Ouverture, c’est d’abord et avant tout notre propre langue maternelle. Ce ci ne veut pas dire que nous ne devons pas apprendre le français. Au contraire. Le français est désormais partie prenante de notre richesse culturelle. C’est un moyen de communication internationale très précieux. Nous devons apprendre toutes les langues possibles en cette période de mondialisation. Aujourd’hui, en Europe, même dans cette France culturellement très hautaine, les politiques ont compris la nécessité pour le monde d’aujourd’hui de s’enrichir avec les langues des autres. Le chinois est aujourd’hui à la mode, sans parler de l’anglais qui s’impose partout. En France, les enfants commencent l’anglais à l’école primaire. Le pulaar et le bambara sont admis comme seconde langue aux épreuves du baccalauréat français. Mais nous devons aussi comprendre que ce ne sont pas les langues étrangères qui éduqueront nos enfants et formeront adéquatement nos cadres de demain. Leur apprentissage constituera tout au plus « un métier » comme tout autre, un métier qui contribuera à notre ouverture sur le monde par le biais de la communication et des formations internationales, mais qui n’assurera jamais à lui tout seul cette ouverture, comme nous l’avons déjà démontré plus haut. Il faut aussi que l’élite arrête d’insulter le peuple en donnant des discours politiques en français. La démocratie politique, c’est un choix de société. Quand on choisit un modèle de société pour des humains, le minimum de respect voudrait qu’ils comprennent ce qu’on leur propose. Par la culture, par les débats politiques, par l’information dans nos langues nationales à la radio et à la télévision, on peut créer une autre société. Une société dans laquelle chacun donnera ce qu’il a aux autres. Une société dans laquelle chacun acceptera les présents des autres. Une société mauritanienne ouverte aux valeurs des autres nations, comme celles de la démocratie, de la paix, de l’égalité et du développement économique. Pourquoi encore les émissions en pulaar ne passent pas de la musique maure ? Pourquoi les émissions arabes ne passent pas de la musique sooninké ? Voilà le véritable problème de la construction de cette nation en devenir. On veut que chacun reste de son côté, dans son petit coin, au moment où la mondialisation culturelle court à la vitesse de la lumière. Notre seul salut réside dans l’interculturel. Il n’est ni dans le jacobinisme, ni dans le droit à la différence, encore moins dans le droit à la déportation et aux purges. Oui au « muynan am mi muynan maa 1». Le droit à la différence est légitime dans l’objectif intermédiaire de la « culture des cultures non cultivées ». C’est d’ailleurs un des principes fondamentaux de l’interculturel, mais il ne peut et ne doit en aucun cas être perçu comme un projet politique. C’est une simple étape. Pour une véritable politique interculturelle, il faut une égalité des cultures en présence. C’est en ce sens que le développement des cultures dominées demeure un préalable fondamental. C’est en ce sens aussi que la reconnaissance mutuelle est une condition sine qua non. C’est pourquoi la situation culturelle et linguistique mauritanienne peut nécessiter une discrimination positive, qui ne doit pas être perçue comme un objectif en soi, mais comme un préalable à l’égalité des chances de nos langues et de nos valeurs.
Nous nous sommes beaucoup appesantis sur la dimension politique et culturelle de la langue, peut être au risque d’être lu et entendu comme porteur d’une simple revendication identitaire. D’ailleurs c’est cette arme anti-identitaire qui est toujours brandie face aux défenseurs de la promotion et de l’égalité culturelles et linguistiques en Afrique. On les accuse de favoriser un « communautarisme » et un anti républicanisme, si ce n’est du racisme. Peut-être que la politique du droit à la différence en est pour quelque chose. Mais si nous reconnaissons la légitimité de la dimension culturelle dans la construction de nos états, ce n’est pas pour ignorer la dimension du développement dans le combat linguistique en Afrique. Nous savons que la sensibilité culturelle est trop forte dans le combat que nous menons. Mais à force de la mettre exclusivement en avant dans le prisme du droit à la différence, nous avons perdu des soutiens précieux et nous nous sommes peut-être créés des ennemis qui ne devraient pas exister. Murtudo nous a toujours dit que « Demngal ko fittaandu lenyol, Demngal ko daabaa pinal » (la langue est l’âme d’un peuple, la langue est le véhicule de la culture). Nous dirons maintenant que la langue est le moteur du développement. De l’oralité à l’écriture, la langue a permis aux grandes civilisations de consigner et de développer les acquis scientifiques. Le savoir ne se transmet que par la communication. Et la meilleure des communications est encore l’écrite. Aujourd’hui encore, il n’est pas connu de grande puissance même émergeante qui s’est développée à partir d’une langue étrangère. Si les pays asiatiques récemment décolonisés comme nous en Afrique se lancent dans la course au développement alors que nous pataugeons dans les boues de la misère, osons reconnaître que leurs politiques linguistiques en sont largement pour quelque chose. Aucun de ses pays asiatiques n’a ignoré sa langue à l’école au profit de celle du colonisateur. Certains me rétorqueront que oui, leurs langues étaient écrites. Je leur répondrai alors que toute chose a un commencement. D’autres, à force de ne pouvoir démontrer le contraire du rôle fondamental de la langue maternelle dans le développement cognitif et intellectuel de l’enfant, me chanteront cette musique qu’on a l’habitude d’entendre distillée par les artistes de la francophonie. Excusez moi, de la « francofolie ». Les « francofolies » nous ont toujours chanté que nos ethnies étaient nombreuses, que l’école dans vingt langues coûtait trop cher, que nous risquions des guerres civiles, etc. L’Inde a plus de 300 langues étudiées à l’école et il n’existe pas de guerre ethnico-linguistique dans ce pays. Le premier pays qui s’est officiellement déclaré multiculturel et qui a favorisé la scolarisation dans toutes les langues du pays, c’est les Etats-Unis où, même les langues des communautés immigrées ont droit de cité au même titre (officiellement) que l’anglais dans les écoles, même si cette dernière s’impose dans les faits. Ce pays ne connaît pas aujourd’hui de guerre ethnique. Paradoxalement, ce sont ceux qui chantent sous nos toits officiels les risques courus par la multiplicité des langues à l’école qui connaissent des conflits ethniques dans leurs pays, du fait notamment de la négation de leurs composantes nationales. Ce sont les basques, les bretons et les corses en France. Ce sont les berbères et les Kurdes dans le monde arabe. Ce sont les communautés noires du Soudan. Et demain, ce seront les communautés noires de Mauritanie si rien n’est fait d’ici là.
Aujourd’hui que constatons-nous dans le débat suscité actuellement par les propos du Premier Ministre et de la Ministre de la Culture ? Une guerre des tranchées dans laquelle chacun se défend en oubliant très souvent de défendre le peuple mauritanien. C’est de la provocation ! Me rétorqueront certains. Eh bien, je l’assume. En focalisant le débat sur l’arabe ou le français comme langue de travail, les élites mauritaniennes ne pensent égoïstement qu’à elles-mêmes. On entend que ceux-ci sont formés en arabe, que ceux là sont formés en français. Donc, il faut selon la position et l’intérêt, travailler en arabe ou en français. Comme si le fait que les formations soient acquises dans ces langues justifiait à lui seul le choix de la ou des langues de travail dans le pays. Aujourd’hui toutes les institutions internationales en matière de développement sont unanimes sur le rôle fondamental de la langue et de l’écriture dans le développement d’une nation. Le fonctionnaire, l’éducateur, le formateur sont tous des intermédiaires vecteurs du développement. Pourront-ils à jamais assurer pleinement ce rôle en ne travaillant qu’avec leurs langues de formations ? Non, il faut aller vers le peuple, disait quelqu’un. Ce n’est pas au peuple d’aller vers les fonctionnaires de l’Etat. Ce la veut dire tout simplement que pour développer un peuple, on doit obligatoirement parler le langage du peuple, langage qui ne peut être correctement véhiculé et compris que dans la langue du peuple et non celle de la formation des élites postcoloniales. Quel est le pourcentage de mauritaniens parlant français ou arabe classique ? Malheureusement, nos pouvoirs, nos élites, nos cadres ont trop souvent la manie de voir du rouge et d’affirmer à qui veut l’entendre que c’est du vert. La Vérité est qu’il y a depuis les indépendances un complexe de supériorité de nos intellos et de nos cadres. Alors que la Réalité est que nous avons des cadres inadaptés parce que tout simplement incompétents pour la transposition de leurs connaissances dans les langues des populations qu’ils sont sensés servir. D’où l’exigence fondamentale de leur formation dans les langues du pays (y compris le hassania que je différencie de l’arabe classique). Et aussi l’exigence fondamentale de l’officialisation de ces langues (y compris le hassania) en tant que langue de travail et d’éducation au même titre que l’arabe classique.
L’autre facette de la médaille, est que le fait de travailler, d’éduquer et de former dans l’oralité exclusive, parce que tout simplement faisant face à des populations analphabètes, est comme disent les haalpulaaren, verser de l’eau dans un canari troué. Elle n’y restera jamais. L’alphabétisation dans nos langues nationales doit être au cœur du projet de développement de notre pays. Il est tout simplement aberrant de constater que la direction de l’alphabétisation est toujours rattachée au Ministère des affaires islamiques. Dans les pays comme le Sénégal ou le Mali, qui ont avant nous compris le rôle central de l’alphabétisation dans le développement d’une nation, ce sont des ministères à part entière ou des Secrétariats d’état chargés de la promotion des langues nationales, ou de l’éducation de base et de l’alphabétisation qui ont été mis en place. A défaut de tout cela, il faut au moins qu’en Mauritanie, l’alphabétisation des adultes et les systèmes alternatifs à l’éducation pour les jeunes non scolarisés et déscolarisés, soient rattachés à l’Education nationale avec le même intérêt et le même poids que la scolarisation ou la formation professionnelle. Nous avons des acquis, nous avons des cadres.
La sociologie actuelle de l’école distingue différents effets dans la scolarisation de l’enfant. La sociologie française parle notamment de l’effet école, de l’effet enseignant, et de l’effet classe. Même si un nouveau courant sociologique parle aujourd’hui du rapport au savoir ou du rapport à l’école, nulle part dans cette sociologie il n’est fait état de l’effet langue ou du rapport à la langue d’enseignement. C’est que pour ces sociologues il est déjà acquis que tous les enfants sont scolarisés dans leur langue maternelle au point de ne traiter la question des enfants immigrés que sous l’angle purement sociologique. Cette sociologie ne peut nullement résoudre les problèmes liés à l’école africaine, du fait notamment de la prééminence de l’effet langue dans nos rapports à l’école. Quel est le sociologue ou le pédagogue africain qui a tenté de mesurer le niveau de l’effet langue dans les déperditions scolaires en Afrique ? On fait des analyses purement sociologiques de classes ou de territoires, alors que le premier problème de l’enfant réside dans le fait que dès la première seconde de son entrée dans l’enceinte de l’école, il a été coupé de sa communauté d’origine et de sa culture par la langue de l’enseignement. On a tué en lui son âme. On a complètement ignoré ses acquis antérieurs. Aujourd’hui, la grande majorité des enfants africains qui quittent l’école avant le collège, le font principalement à cause des difficultés liées à la compréhension de la langue française. Pourtant, le plus ignorant d’entre nous sait que beaucoup de ses enfants auraient pu être récupérés et devenir ne serait-ce que des ouvriers qualifiés si leur éducation et leur formation avaient été données en wolof ou en sooninké. Chacun d’entre nous sait que dans sa classe il y a eu des élèves brillants en français qui étaient mauvais en mathématiques et vice versa. Pourquoi alors l’école s’arrogerait-elle le droit de renvoyer chez lui un enfant qui ne maîtrise pas bien le français alors qu’il aurait bien pu être un grand Einschtein physicien s’il avait appris les mathématiques en pulaar ? Voilà la question de la justice sociale et de l’égalité des chances qui se pose en termes crus. Voilà un combat qui mérite la mobilisation de tous, ne serait-ce que pour former un peu plus d’ouvriers qualifiés, ne serait-ce que pour avoir une main d’œuvre qualifiée qui peut attirer les délocalisations des entreprises européennes qui ne se dirigent que vers les pays d’Europe de l’Est et de l’Asie à main d’œuvre hautement qualifiée. C’est pourquoi il faut que l’Institut des Langues Nationales soit réhabilité pour la promotion du wolof, du hassaniya, du pulaar et du sooninke. Il y va de notre intérêt et de notre existence.
Le coût de l’école ne doit être mesuré que par son taux d’efficience, c'est-à-dire par le rapport qualité prix. Amusez-vous à calculer l’argent perdu dans les dépenses allouées aux enfants en échec scolaire. Calculez ensuite la part de responsabilité de la langue française dans ces échecs et cet argent perdu. Vous saurez que seules l’éducation et la formation dans la langue maternelle coûtent moins cher. De toutes façons, quelque soit le nombre de langues d’enseignement, nous n’aurons à payer que le même nombre de professeurs, le même nombre de cahiers, le même nombre de livres et le même nombre de crayons. Là où nous dépenserons plus en traduction et adaptation des manuels, nous gagnerons beaucoup plus en efficience qui nous évitera d’autres dépenses ultérieures en programmes d’alphabétisation d’adultes et autres dépenses sociales liées à l’analphabétisme et à l’ignorance. Eviter une double dépense. Voilà un pari que nous devons gagner. Pour le bien de nos maigres ressources.
Nous ne devons pas confondre apprendre le bambara et apprendre dans le bambara. Il faut apprendre le français, il faut apprendre le chinois, mais il faut apprendre dans le pulaar, apprendre dans le soninké, dans wolof et dans l’arabe. Ce que nous préconisons ne doit pas être une politique de poudre aux yeux. La linguistique et la pédagogie sont unanimes : il n’y a pas de langue supérieure à une autre. Toutes les langues se valent. N’importe quelle science peut être véhiculée par n’importe quelle langue. C’est pourquoi, il ne doit y avoir de hiérarchisation entre les langues. Toutes nos langues doivent être des médiums d’enseignement. C’est une question de démocratie, d’égalité des chances entre les citoyens, et de développement national. Ceci est possible. Ce qui manque, c’est un engagement politique et une planification réfléchie. L’Ecole comme l’a dit le grand frère Oumar Moussa BA, est le creuset de la nation. Comme la radio et la télévision, elle doit respecter le droit à la différence tout en promouvant l’interculturel. Chaque enfant aura le droit de s’épanouir dans sa langue tout en s’ouvrant à l’apprentissage des langues et des valeurs culturelles des autres communautés nationales. L’expérience de l’institut des langues nationales est porteuse. Elle a été saluée par la communauté scientifique nationale et internationale. Au de là de ses aspects scientifiques, elle commençait à jouer un rôle catalyseur dans le sens de la décrispation des tensions interethniques dans notre pays. Mais l’aveuglement et l’extrémisme barbare de Taya sont venus tout remettre en cause. Il est bien vrai que cette expérience avait ces lacunes, surtout en matière de démocratie et d’égalité des élèves et des citoyens face à nos langues et nos cultures. Je ne suis jamais arrivé à comprendre pourquoi au sein de cette expérience, le petit Beydane avait le droit d’apprendre une seconde langue nationale de son choix, alors que mon fils Haalpulaar métissé, n’aurait aucune chance d’apprendre le soninké, une autre langue de ses ancêtres. De toute façon, cette expérience vaut mieux que rien, vaut mieux que beaucoup de choses en Afrique et surtout du statut quo actuel dans notre pays.
La question linguistique est aussi une question d’organisation politique. Les spécialistes distinguent deux types d’organisations linguistiques qui reflètent souvent les conceptions de la nation que se font leurs partisans. Il y a l’organisation verticale qui hiérarchise les langues et les cultures. Elle est prisée par les pays qui se font un devoir d’assimiler à terme les composantes nationales par une seule langue et une seule culture. Mais il y a aussi l’organisation horizontale qui peut traiter toutes les langues à égalité comme en Suisse, mais qui peut aussi renfermer une dose d’hiérarchisation territorialisée comme en Espagne. Cette dernière forme de territorialisation de la politique linguistique peut-être vue comme une position intermédiaire entre une hiérarchisation verticale non souhaitée et une égalité horizontale très difficile à mettre en œuvre. En Mauritanie nous avons la chance d’avoir des espaces territoriaux qui correspondent pratiquement à une dominante linguistique. C’est sur cette base que nous pourrons proposer un schéma respectueux de nos différences, mais aussi de notre volonté interculturelle et de lutte pour un développement harmonieux et harmonisé de notre chère patrie.
Amadou Alpha BAH
Mantes La Jolie, le 19/02/2005
Revu le 20 avril 2010
A Gretz Armainvilliers
77220 France
1 Extraits d’un poème de Abdoul Aziz BA dit TAZI. Qui veut dire littéralement « bois de mon lait, je boirai du
Nous comprenons tout de même les passions suscitées ça et là. C’est que la question linguistique et culturelle constitue l’épine dorsale de la question nationale en Mauritanie. Elle suscite passion de part et d’autre des lignes de démarcations idéologiques et ethniques des mauritaniens. Par sa position sur la question linguistique, le mauritanien nous affirme son « camp » : celui d’une Mauritanie entièrement arabe ou à arabiser, celui d’une Mauritanie multinationale et multiculturelle, ou celui d’une Mauritanie « gangarienne » nostalgique d’un passé dont les fouilles accouchent avec difficulté la fierté d’une civilisation enfouie dans les décombres de l’Histoire. C’est que la langue et la culture ont de tout temps constitué les principaux attributs par lesquels les peuples déterminent leur identité et se valorisent face aux autres. C’est aussi des attributs pour lesquels l’autre est admiré, l’autre est méprisé, l’autre est accepté, l’autre est refusé. Quelqu’un disait que « la langue est l’âme d’un peuple ». L’âme, ce n’est pas seulement ce qui donne la fierté d’être et d’exister, c’est ce qui permet d’exister, c’est ce qui fait vivre. C’est pourquoi l’âme exige de tout temps respect et considération. Sans âme l’humain ne vit point, n’existe point. Ainsi, les conflits culturels et linguistiques deviennent des conflits pour l’existence, pour la vie. Le Beydane, d’origine arabe et berbère, tient aujourd’hui à son arabité face à une culture négro-africaine qui l’entoure de toutes parts et qu’il a épousée depuis des siècles. N’en déplaise aux « négationnistes », le Beydane est aujourd’hui l’addition de langues arabe et berbère à une culture négro-africaine. Ses castes, sa musique, son organisation sociale, ne relèvent en rien de l’arabité, mais d’une négritude que la Mauritanie doit apprendre à assumer. De l’autre côté, le Négro-africain, conscient de sa faiblesse institutionnelle et économique face au Nationaliste Beydane qui lutte, non seulement pour un retour aux sources de l’arabité de sa composante ethnico-culturelle, mais aussi pour une assimilation culturelle et linguistique de toutes les communautés nationales, exige la reconnaissance de ses valeurs pour la survie de son âme. Au milieu, le Hartaani, ancien esclave ou nègre oublié au fond des oasis par ses parents repliés vers le sud, tient à sa spécificité. Spécificité qui n’est non seulement linguistique et culturelle, mais aussi raciale. Car, pour faire la différence, il faut faire appel à la différence. Face au Négro-africain, le Hartaani exige la reconnaissance d’une culture désormais hybride, d’une histoire désormais singulière et d’une condition sociale particulière. Face au Beydane, la couleur de la peau et la condition sociale sont mises en avant. Le Beydane doit accepter et reconnaître la FAUTE. Si on n’exige pas de lui le pardon, il doit s’engager dans la réparation qui devra constituer la reconnaissance implicite de ses tords, prélude à toute forme de réconciliation. Le Négro-africain est prié de ne pas jouer le jeu égoïste de ses propres intérêts en voulant, au nom des liens de sang et de couleur, assimiler à sa personne les préoccupations particulières des esclaves et des anciens esclaves. Il est prié d’accepter les conséquences de l’Histoire qui a façonné une autre communauté, même si comme Hawwaa créée à partir des cotes d’Aadama, elle a été créée de sa chair et de son sang. Le Hartaani est singulier, le Hartaani se veut différent. La Mauritanie doit apprendre à en tenir compte.
L’originalité de la question mauritanienne réside dans le fait que le pays constitue le seul état au monde où blancs et noirs sont appelés à vivre ensemble, non pas de leur propre volonté, mais de celle du colonisateur. Aujourd’hui, force est de constater que les peuples, face à cette situation, ont acquis une certaine maturité dans la cohabitation. Ce qui manque, c’est la mise en service de cette maturité au service d’un idéal, pas républicain, mais humaniste. Si les émirats maures et berbères ont de tout temps coexisté avec les empires et les républiques d’Afrique noire voisines, ont noué des alliances, ont favorisé des mariages interethniques entre leurs leaders, jamais il n’a existé de projet officiel, ne serait-ce que napoléonien, de fusion de leurs états à l’image du projet français de rattachement de la rive droite du fleuve Sénégal à la colonie dite mauritanienne. Ce rattachement, même s’il a été fait dans l’injustice et le mépris des communautés noires, doit pouvoir aujourd’hui servir à la matérialisation de cet idéal humaniste. Le propre des sociétés modernes, avec toute la légitimité des préoccupations républicaines, c’est de mettre l’état, la nation, la frontière, au devant de tout, quitte à oublier l’homme, quitte à sacrifier la femme. C’est au nom de cet idéal républicain que le jacobinisme français a massacré la grande majorité des langues et cultures du territoire pour créer son état nation. C’est au nom de cet idéal aussi que les idéologues arabes baathistes ou nasséristes prônent la panarabisme. C’est au nom de cet idéal que les Kurdes sont massacrés en Irak, dominés en Turquie, ignorés en Syrie et en Iran, que les berbères sont priés de se taire en Algérie et au Maroc, que les tchetchènes sont martyrisés, que les tutsis sont tués, que le Darfour est brûlé et que les négro-mauritaniens sont déportés. Pour une fois, nous, mauritaniens, pourrons arriver à mettre l’humain au devant. A savoir que ce n’est ni la république, ni l’état, ni la nation qui créent notre volonté de vivre en commun, mais que c’est d’abord nous, en tant qu’humains, qui sommes le moteur de l’état, de la république, de la nation, et de notre volonté de cohabitation dans l’harmonie, la paix, la justice et l’égalité. L’humanisme c’est par rapport à l’autre. C’est cette posture et cette capacité à accepter l’autre comme étant moi. C’est cette capacité à voir la couleur de l’autre comme non pas la couleur d’une race, mais une couleur de l’humain. C’est cette posture du donner et du recevoir, comme le disait Khrisnamurti. C’est le fait d’accepter que ce qui lui appartient est à moi, et que ce qui me revient est à lui. Cette vision de la vie n’est assimilable ni au jacobinisme réducteur et assassin, ni au multiculturalisme diviseur et égoïste. Depuis mai 1968, les élites dites révolutionnaires de gauche, n’ont trouvé comme paravent face à la politique assimilationniste de la France que le droit à la différence. Malheureusement, ce droit à la différence a tout de suite été interprété comme un projet, un devoir, une obligation à la différence. En Mauritanie, l’opposition Noire (négro-africaine et haratine) a revendiqué la différence culturelle et/ou linguistique. Ce qu’on ne voit pas, c’est que le multiculturalisme, s’il peut être revendiqué, n’est pas un projet en soi, il est un fait. On peut tout au plus revendiquer son respect. Et encore. Il n’existe nulle part dans le monde un état monolingue ou monoculturel. Le multiculturalisme et le droit à la différence étaient des préoccupations de minorités occidentales face aux républiques « culturivores » qui ravageaient tout sur leur passage. En Afrique, la langue dominante institutionnellement parlant, était encore celle du colon. C’est pourquoi il nous semblait prématuré de parler de droit à la différence là où il n’y avait encore droit à l’existence pour aucune langue du pays. Les gauchistes africains ne l’avaient pas encore compris. Et cet état d’esprit fait encore des ravages dans de nombreux pays comme le Sénégal où le combat des minorités est plus dirigé contre le wolof que contre le français dont la position de langue officielle et d’éducation est plus qu’illégitime, inappropriée, et inacceptable. Cheikh Anta Diop était l’un des rares intellectuels africains à avoir compris cette situation en revendiquant l’éducation, l’administration et la formation dans les langues africaines. Il était le seul intellectuel qui liait indépendance politique et indépendance culturelle. Mais nous remarquerons que lui aussi était tombé dans le piège de l’idéal républicain jacobiniste. En proposant la wolofisation de la société sénégalaise, Cheikh Anta n’allait encore que creuser plus profondément la blessure des inégalités ethniques et culturelles qui polluent le paysage sénégalais. En Mauritanie, la situation peut sembler un peu différente. Depuis la colonisation, l’arabe résiste tant soit peu face au français. Mais l’arabe n’est jamais arrivé à supplanter le français à l’image de certains pays comme la Libye ou les pays du Golfe. C’est pourquoi le droit à la différence comme crédo politique peut sembler prématuré voire insensé pour certaines couches de la population. Mais si l’intellectuel ou l’opposant Noir revendique ce droit, c’est par conscience du projet des Nationalistes Beydanes qui voudrait, non seulement une Mauritanie débarrassée de la tutelle de la langue française, ce qui est légitime en soi, mais aussi et surtout une Mauritanie entièrement arabisée. Ce qui diviserait les Nationalistes arabes, ce n’est pas le projet en soi, mais les stratégies et les moyens à mettre en œuvre pour arriver à ses fins. Si pour les Nassériens l’assimilation à la française est légitimée par le fait que tous les mauritaniens sont musulmans, les Baathistes eux, prônent la solution radicale d’une purge par déportations voire d’un holocauste « humanisé ». C’est ce qu’ils ont tenté de mettre en œuvre depuis le conflit de 1989 en massacrant et en déportant des centaines de milliers de Noirs vers le Mali et le Sénégal, en purgeant l’armée par des massacres injustifiés, et en procédant à des licenciements massifs de l’armée, de la police, de la garde nationale, de la fonction publique et des sociétés d’état.
Le droit à la différence a eu comme effet de creuser le fossé entre l’intellectuel opposant Noir et sa base populaire. Même si la guerre civile de 1966 et le manifeste des 19 ont sonné la cloche de l’alerte, la base populaire mauritanienne à l’instar d’ailleurs de beaucoup de cadres, n’a véritablement pas vu arriver le feu qui menace encore de brûler la maison. Notre combat linguistique et culturel en tant qu’opposition crédible et digne de la confiance de notre peuple est double : c’est d’abord un combat commun contre la prééminence et la domination de la langue française, et un combat pour un projet de société dans laquelle tous se reconnaîtront mauritaniens à part entière. Pour cela, il faut oser.
Le droit à la différence a eu aussi comme principale conséquence, la vision essentiellement statistique des relations interethniques en Mauritanie. Dans le Manifeste du Négro-mauritanien Opprimé, les Forces de Libération Africaines de Mauritanie, démontraient à l’appui de statistiques irréfutables, comment culturellement et linguistiquement les noirs étaient dominés dans le pays. Mais cette analyse ne fait pas état de l’aspect qualitatif des relations interculturelles. Si à la radio et à la télévision nationales la visibilité d’une telle domination ne nécessite aucune étude statistique, une étude qualitative quant à elle s’impose pour le mauritanien moyen. C’est la négritude senghorienne qui louait le sens dans la culture négro-africaine en qualifiant la raison d’hellène. Encore aujourd’hui, dans une certaine élite et chez la majorité des populations africaines, le développement reste lié aux langues et cultures européennes. C’est cette conception de la langue qui est transposée dans nos quotidiens culturels, à la radio, et à la télévision. Tout ce qui est moderne, musique ou information scientifique ou politique, est donné dans la langue française. On ne peut même pas « demander un disque des auditeurs » en pulaar, wolof, ou sooninké si le morceau choisi relève de la musique moderne. On n’a le droit d’écouter Bob Marley ou Michael Jakson que si on parle et comprend français. Les informations ne sont données entièrement qu’en français et en arabe. En Pulaar par exemple, le journal parlé est presque entièrement consacré au Tagge (avis de décès) de Amadou Tidiane BAL. C’est la même situation pour le wolof et le soninké. Cette situation est justifiée par le fait que même chez l’opposition ou certains « militants » de la promotion des langues nationales, le français doit rester cette Langue « d’Ouverture ». Mais comment peut-elle assumer son statut de Langue d’Ouverture si à cause d’elle Mr Diallo ou Mr Kane qui ne comprend pas français, ne sait pas que la mondialisation est entrain de l’achever à petits feux. La véritable Ouverture, c’est la promotion d’émissions culturelles et scientifiques dans nos langues nationales. Des émissions qui permettent à nos concitoyens d’être au courant et au diapason de la marche de la modernité, des émissions qui leur permettent de connaître d’autres modes de vies, d’autres peuples, d’autres civilisations et d’autres cultures. Ceci ne peut se faire que dans leurs langues qu’ils comprennent. La Langue d’Ouverture, c’est d’abord et avant tout notre propre langue maternelle. Ce ci ne veut pas dire que nous ne devons pas apprendre le français. Au contraire. Le français est désormais partie prenante de notre richesse culturelle. C’est un moyen de communication internationale très précieux. Nous devons apprendre toutes les langues possibles en cette période de mondialisation. Aujourd’hui, en Europe, même dans cette France culturellement très hautaine, les politiques ont compris la nécessité pour le monde d’aujourd’hui de s’enrichir avec les langues des autres. Le chinois est aujourd’hui à la mode, sans parler de l’anglais qui s’impose partout. En France, les enfants commencent l’anglais à l’école primaire. Le pulaar et le bambara sont admis comme seconde langue aux épreuves du baccalauréat français. Mais nous devons aussi comprendre que ce ne sont pas les langues étrangères qui éduqueront nos enfants et formeront adéquatement nos cadres de demain. Leur apprentissage constituera tout au plus « un métier » comme tout autre, un métier qui contribuera à notre ouverture sur le monde par le biais de la communication et des formations internationales, mais qui n’assurera jamais à lui tout seul cette ouverture, comme nous l’avons déjà démontré plus haut. Il faut aussi que l’élite arrête d’insulter le peuple en donnant des discours politiques en français. La démocratie politique, c’est un choix de société. Quand on choisit un modèle de société pour des humains, le minimum de respect voudrait qu’ils comprennent ce qu’on leur propose. Par la culture, par les débats politiques, par l’information dans nos langues nationales à la radio et à la télévision, on peut créer une autre société. Une société dans laquelle chacun donnera ce qu’il a aux autres. Une société dans laquelle chacun acceptera les présents des autres. Une société mauritanienne ouverte aux valeurs des autres nations, comme celles de la démocratie, de la paix, de l’égalité et du développement économique. Pourquoi encore les émissions en pulaar ne passent pas de la musique maure ? Pourquoi les émissions arabes ne passent pas de la musique sooninké ? Voilà le véritable problème de la construction de cette nation en devenir. On veut que chacun reste de son côté, dans son petit coin, au moment où la mondialisation culturelle court à la vitesse de la lumière. Notre seul salut réside dans l’interculturel. Il n’est ni dans le jacobinisme, ni dans le droit à la différence, encore moins dans le droit à la déportation et aux purges. Oui au « muynan am mi muynan maa 1». Le droit à la différence est légitime dans l’objectif intermédiaire de la « culture des cultures non cultivées ». C’est d’ailleurs un des principes fondamentaux de l’interculturel, mais il ne peut et ne doit en aucun cas être perçu comme un projet politique. C’est une simple étape. Pour une véritable politique interculturelle, il faut une égalité des cultures en présence. C’est en ce sens que le développement des cultures dominées demeure un préalable fondamental. C’est en ce sens aussi que la reconnaissance mutuelle est une condition sine qua non. C’est pourquoi la situation culturelle et linguistique mauritanienne peut nécessiter une discrimination positive, qui ne doit pas être perçue comme un objectif en soi, mais comme un préalable à l’égalité des chances de nos langues et de nos valeurs.
Nous nous sommes beaucoup appesantis sur la dimension politique et culturelle de la langue, peut être au risque d’être lu et entendu comme porteur d’une simple revendication identitaire. D’ailleurs c’est cette arme anti-identitaire qui est toujours brandie face aux défenseurs de la promotion et de l’égalité culturelles et linguistiques en Afrique. On les accuse de favoriser un « communautarisme » et un anti républicanisme, si ce n’est du racisme. Peut-être que la politique du droit à la différence en est pour quelque chose. Mais si nous reconnaissons la légitimité de la dimension culturelle dans la construction de nos états, ce n’est pas pour ignorer la dimension du développement dans le combat linguistique en Afrique. Nous savons que la sensibilité culturelle est trop forte dans le combat que nous menons. Mais à force de la mettre exclusivement en avant dans le prisme du droit à la différence, nous avons perdu des soutiens précieux et nous nous sommes peut-être créés des ennemis qui ne devraient pas exister. Murtudo nous a toujours dit que « Demngal ko fittaandu lenyol, Demngal ko daabaa pinal » (la langue est l’âme d’un peuple, la langue est le véhicule de la culture). Nous dirons maintenant que la langue est le moteur du développement. De l’oralité à l’écriture, la langue a permis aux grandes civilisations de consigner et de développer les acquis scientifiques. Le savoir ne se transmet que par la communication. Et la meilleure des communications est encore l’écrite. Aujourd’hui encore, il n’est pas connu de grande puissance même émergeante qui s’est développée à partir d’une langue étrangère. Si les pays asiatiques récemment décolonisés comme nous en Afrique se lancent dans la course au développement alors que nous pataugeons dans les boues de la misère, osons reconnaître que leurs politiques linguistiques en sont largement pour quelque chose. Aucun de ses pays asiatiques n’a ignoré sa langue à l’école au profit de celle du colonisateur. Certains me rétorqueront que oui, leurs langues étaient écrites. Je leur répondrai alors que toute chose a un commencement. D’autres, à force de ne pouvoir démontrer le contraire du rôle fondamental de la langue maternelle dans le développement cognitif et intellectuel de l’enfant, me chanteront cette musique qu’on a l’habitude d’entendre distillée par les artistes de la francophonie. Excusez moi, de la « francofolie ». Les « francofolies » nous ont toujours chanté que nos ethnies étaient nombreuses, que l’école dans vingt langues coûtait trop cher, que nous risquions des guerres civiles, etc. L’Inde a plus de 300 langues étudiées à l’école et il n’existe pas de guerre ethnico-linguistique dans ce pays. Le premier pays qui s’est officiellement déclaré multiculturel et qui a favorisé la scolarisation dans toutes les langues du pays, c’est les Etats-Unis où, même les langues des communautés immigrées ont droit de cité au même titre (officiellement) que l’anglais dans les écoles, même si cette dernière s’impose dans les faits. Ce pays ne connaît pas aujourd’hui de guerre ethnique. Paradoxalement, ce sont ceux qui chantent sous nos toits officiels les risques courus par la multiplicité des langues à l’école qui connaissent des conflits ethniques dans leurs pays, du fait notamment de la négation de leurs composantes nationales. Ce sont les basques, les bretons et les corses en France. Ce sont les berbères et les Kurdes dans le monde arabe. Ce sont les communautés noires du Soudan. Et demain, ce seront les communautés noires de Mauritanie si rien n’est fait d’ici là.
Aujourd’hui que constatons-nous dans le débat suscité actuellement par les propos du Premier Ministre et de la Ministre de la Culture ? Une guerre des tranchées dans laquelle chacun se défend en oubliant très souvent de défendre le peuple mauritanien. C’est de la provocation ! Me rétorqueront certains. Eh bien, je l’assume. En focalisant le débat sur l’arabe ou le français comme langue de travail, les élites mauritaniennes ne pensent égoïstement qu’à elles-mêmes. On entend que ceux-ci sont formés en arabe, que ceux là sont formés en français. Donc, il faut selon la position et l’intérêt, travailler en arabe ou en français. Comme si le fait que les formations soient acquises dans ces langues justifiait à lui seul le choix de la ou des langues de travail dans le pays. Aujourd’hui toutes les institutions internationales en matière de développement sont unanimes sur le rôle fondamental de la langue et de l’écriture dans le développement d’une nation. Le fonctionnaire, l’éducateur, le formateur sont tous des intermédiaires vecteurs du développement. Pourront-ils à jamais assurer pleinement ce rôle en ne travaillant qu’avec leurs langues de formations ? Non, il faut aller vers le peuple, disait quelqu’un. Ce n’est pas au peuple d’aller vers les fonctionnaires de l’Etat. Ce la veut dire tout simplement que pour développer un peuple, on doit obligatoirement parler le langage du peuple, langage qui ne peut être correctement véhiculé et compris que dans la langue du peuple et non celle de la formation des élites postcoloniales. Quel est le pourcentage de mauritaniens parlant français ou arabe classique ? Malheureusement, nos pouvoirs, nos élites, nos cadres ont trop souvent la manie de voir du rouge et d’affirmer à qui veut l’entendre que c’est du vert. La Vérité est qu’il y a depuis les indépendances un complexe de supériorité de nos intellos et de nos cadres. Alors que la Réalité est que nous avons des cadres inadaptés parce que tout simplement incompétents pour la transposition de leurs connaissances dans les langues des populations qu’ils sont sensés servir. D’où l’exigence fondamentale de leur formation dans les langues du pays (y compris le hassania que je différencie de l’arabe classique). Et aussi l’exigence fondamentale de l’officialisation de ces langues (y compris le hassania) en tant que langue de travail et d’éducation au même titre que l’arabe classique.
L’autre facette de la médaille, est que le fait de travailler, d’éduquer et de former dans l’oralité exclusive, parce que tout simplement faisant face à des populations analphabètes, est comme disent les haalpulaaren, verser de l’eau dans un canari troué. Elle n’y restera jamais. L’alphabétisation dans nos langues nationales doit être au cœur du projet de développement de notre pays. Il est tout simplement aberrant de constater que la direction de l’alphabétisation est toujours rattachée au Ministère des affaires islamiques. Dans les pays comme le Sénégal ou le Mali, qui ont avant nous compris le rôle central de l’alphabétisation dans le développement d’une nation, ce sont des ministères à part entière ou des Secrétariats d’état chargés de la promotion des langues nationales, ou de l’éducation de base et de l’alphabétisation qui ont été mis en place. A défaut de tout cela, il faut au moins qu’en Mauritanie, l’alphabétisation des adultes et les systèmes alternatifs à l’éducation pour les jeunes non scolarisés et déscolarisés, soient rattachés à l’Education nationale avec le même intérêt et le même poids que la scolarisation ou la formation professionnelle. Nous avons des acquis, nous avons des cadres.
La sociologie actuelle de l’école distingue différents effets dans la scolarisation de l’enfant. La sociologie française parle notamment de l’effet école, de l’effet enseignant, et de l’effet classe. Même si un nouveau courant sociologique parle aujourd’hui du rapport au savoir ou du rapport à l’école, nulle part dans cette sociologie il n’est fait état de l’effet langue ou du rapport à la langue d’enseignement. C’est que pour ces sociologues il est déjà acquis que tous les enfants sont scolarisés dans leur langue maternelle au point de ne traiter la question des enfants immigrés que sous l’angle purement sociologique. Cette sociologie ne peut nullement résoudre les problèmes liés à l’école africaine, du fait notamment de la prééminence de l’effet langue dans nos rapports à l’école. Quel est le sociologue ou le pédagogue africain qui a tenté de mesurer le niveau de l’effet langue dans les déperditions scolaires en Afrique ? On fait des analyses purement sociologiques de classes ou de territoires, alors que le premier problème de l’enfant réside dans le fait que dès la première seconde de son entrée dans l’enceinte de l’école, il a été coupé de sa communauté d’origine et de sa culture par la langue de l’enseignement. On a tué en lui son âme. On a complètement ignoré ses acquis antérieurs. Aujourd’hui, la grande majorité des enfants africains qui quittent l’école avant le collège, le font principalement à cause des difficultés liées à la compréhension de la langue française. Pourtant, le plus ignorant d’entre nous sait que beaucoup de ses enfants auraient pu être récupérés et devenir ne serait-ce que des ouvriers qualifiés si leur éducation et leur formation avaient été données en wolof ou en sooninké. Chacun d’entre nous sait que dans sa classe il y a eu des élèves brillants en français qui étaient mauvais en mathématiques et vice versa. Pourquoi alors l’école s’arrogerait-elle le droit de renvoyer chez lui un enfant qui ne maîtrise pas bien le français alors qu’il aurait bien pu être un grand Einschtein physicien s’il avait appris les mathématiques en pulaar ? Voilà la question de la justice sociale et de l’égalité des chances qui se pose en termes crus. Voilà un combat qui mérite la mobilisation de tous, ne serait-ce que pour former un peu plus d’ouvriers qualifiés, ne serait-ce que pour avoir une main d’œuvre qualifiée qui peut attirer les délocalisations des entreprises européennes qui ne se dirigent que vers les pays d’Europe de l’Est et de l’Asie à main d’œuvre hautement qualifiée. C’est pourquoi il faut que l’Institut des Langues Nationales soit réhabilité pour la promotion du wolof, du hassaniya, du pulaar et du sooninke. Il y va de notre intérêt et de notre existence.
Le coût de l’école ne doit être mesuré que par son taux d’efficience, c'est-à-dire par le rapport qualité prix. Amusez-vous à calculer l’argent perdu dans les dépenses allouées aux enfants en échec scolaire. Calculez ensuite la part de responsabilité de la langue française dans ces échecs et cet argent perdu. Vous saurez que seules l’éducation et la formation dans la langue maternelle coûtent moins cher. De toutes façons, quelque soit le nombre de langues d’enseignement, nous n’aurons à payer que le même nombre de professeurs, le même nombre de cahiers, le même nombre de livres et le même nombre de crayons. Là où nous dépenserons plus en traduction et adaptation des manuels, nous gagnerons beaucoup plus en efficience qui nous évitera d’autres dépenses ultérieures en programmes d’alphabétisation d’adultes et autres dépenses sociales liées à l’analphabétisme et à l’ignorance. Eviter une double dépense. Voilà un pari que nous devons gagner. Pour le bien de nos maigres ressources.
Nous ne devons pas confondre apprendre le bambara et apprendre dans le bambara. Il faut apprendre le français, il faut apprendre le chinois, mais il faut apprendre dans le pulaar, apprendre dans le soninké, dans wolof et dans l’arabe. Ce que nous préconisons ne doit pas être une politique de poudre aux yeux. La linguistique et la pédagogie sont unanimes : il n’y a pas de langue supérieure à une autre. Toutes les langues se valent. N’importe quelle science peut être véhiculée par n’importe quelle langue. C’est pourquoi, il ne doit y avoir de hiérarchisation entre les langues. Toutes nos langues doivent être des médiums d’enseignement. C’est une question de démocratie, d’égalité des chances entre les citoyens, et de développement national. Ceci est possible. Ce qui manque, c’est un engagement politique et une planification réfléchie. L’Ecole comme l’a dit le grand frère Oumar Moussa BA, est le creuset de la nation. Comme la radio et la télévision, elle doit respecter le droit à la différence tout en promouvant l’interculturel. Chaque enfant aura le droit de s’épanouir dans sa langue tout en s’ouvrant à l’apprentissage des langues et des valeurs culturelles des autres communautés nationales. L’expérience de l’institut des langues nationales est porteuse. Elle a été saluée par la communauté scientifique nationale et internationale. Au de là de ses aspects scientifiques, elle commençait à jouer un rôle catalyseur dans le sens de la décrispation des tensions interethniques dans notre pays. Mais l’aveuglement et l’extrémisme barbare de Taya sont venus tout remettre en cause. Il est bien vrai que cette expérience avait ces lacunes, surtout en matière de démocratie et d’égalité des élèves et des citoyens face à nos langues et nos cultures. Je ne suis jamais arrivé à comprendre pourquoi au sein de cette expérience, le petit Beydane avait le droit d’apprendre une seconde langue nationale de son choix, alors que mon fils Haalpulaar métissé, n’aurait aucune chance d’apprendre le soninké, une autre langue de ses ancêtres. De toute façon, cette expérience vaut mieux que rien, vaut mieux que beaucoup de choses en Afrique et surtout du statut quo actuel dans notre pays.
La question linguistique est aussi une question d’organisation politique. Les spécialistes distinguent deux types d’organisations linguistiques qui reflètent souvent les conceptions de la nation que se font leurs partisans. Il y a l’organisation verticale qui hiérarchise les langues et les cultures. Elle est prisée par les pays qui se font un devoir d’assimiler à terme les composantes nationales par une seule langue et une seule culture. Mais il y a aussi l’organisation horizontale qui peut traiter toutes les langues à égalité comme en Suisse, mais qui peut aussi renfermer une dose d’hiérarchisation territorialisée comme en Espagne. Cette dernière forme de territorialisation de la politique linguistique peut-être vue comme une position intermédiaire entre une hiérarchisation verticale non souhaitée et une égalité horizontale très difficile à mettre en œuvre. En Mauritanie nous avons la chance d’avoir des espaces territoriaux qui correspondent pratiquement à une dominante linguistique. C’est sur cette base que nous pourrons proposer un schéma respectueux de nos différences, mais aussi de notre volonté interculturelle et de lutte pour un développement harmonieux et harmonisé de notre chère patrie.
Amadou Alpha BAH
Mantes La Jolie, le 19/02/2005
Revu le 20 avril 2010
A Gretz Armainvilliers
77220 France
1 Extraits d’un poème de Abdoul Aziz BA dit TAZI. Qui veut dire littéralement « bois de mon lait, je boirai du
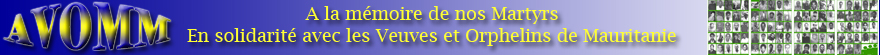
 Actualités
Actualités



















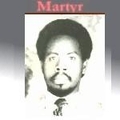
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)