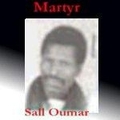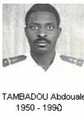L’écrivain francophone et wolophone est l’une des grandes figures littéraires du Sénégal. Une stature acquise grâce à une œuvre tournée vers le souvenir de l’histoire et des êtres passés. Ainsi d’« Un tombeau pour Kinne Gaajo », grand roman du naufrage du « Joola », en 2002 – près de 2 000 victimes.
Si c’était à refaire, il commencerait par là : écrire dans sa langue maternelle. Ainsi se conclut notre conversation avec Boubacar Boris Diop. Le romancier et essayiste sénégalais, né en 1946 à Dakar, a attendu 2003 avant de publier son premier roman en wolof, Doomi Golo (Papyrus, Dakar), traduit en français par ses soins six ans plus tard (Les Petits de la guenon, éd. Philippe Rey). Depuis, l’auteur a choisi d’écrire son œuvre de fiction uniquement en wolof.
La question de la langue est au centre de l’œuvre de l’ex-journaliste qui, depuis sa politique-fiction Le Temps de Tamango (L’Harmattan, 1981), interroge la mémoire du Sénégal, à travers sa littérature, ses mythes et son actualité. Dans Un tombeau pour Kinne Gaajo, son nouveau roman, une écrivaine fictive meurt dans le naufrage du ferry Joola, en 2002.
Comme souvent chez Boubacar Boris Diop, on y croise des « cinglés », une femme forte et énigmatique, des politiciens frappés du complexe du sauveur, d’appétissants plats sénégalais (baasi-salte, ñeleñ, ndambe et mbaxalu-saalum), des expressions en wolof et une cartographie de Dakar, « ville-pagaille » ; ainsi que les proverbes du « malicieux et quasi imparable » Njaajaann Njaay, le mythique ancêtre fondateur de la nation wolof.
Quatre « mots de passe » pour arpenter une œuvre prolifique, récompensée en 2022 par le prestigieux prix international de littérature Neustadt.
« Léebóon »
« Léebóon », « il était une fois » en wolof, résonne dans la plupart des romans que Boubacar Boris Diop situe au Sénégal, prononcé par le narrateur ou des personnages secondaires. « Une histoire ne vaut que racontée par la langue de qui l’a vécue », dit un proverbe sénégalais, repris de livre en livre. Souvent, la personne à qui est adressé le conte intervient, et les histoires s’enchâssent. Un tombeau pour Kinne Gaajoo ne déroge pas à la règle.
Le roman est divisé en deux grands récits – celui de Njéeme Pay, qui tente une biographie de son amie Kinne, puis celui de cette écrivaine et prostituée. L’omniprésence de la fable chez Boubacar Boris Diop reflète son « panthéon littéraire », dominé par une conteuse en wolof : sa mère. « J’étais un enfant impressionnable et donc persuadé que tout ce qu’elle disait était vrai, se souvient-il. J’ai très tôt compris la puissance des mots – proférés ou imprimés –, mais aussi que le monde réel et le monde imaginaire peuvent n’en faire qu’un. »
Les auteurs français du XIXe siècle, mythifiés par son père, un intendant né « la même année que Léopold Sédar Senghor [1906-2001] », ont également influencé l’écrivain. Dans un premier roman jamais publié, écrit à 15 ans, résonnait « un lyrisme extraordinaire » issu de Lamartine ou de Rimbaud. « Je n’avais pas d’intérêt pour ce qui se passait dans la société, juge-t-il. Quand je faisais de belles phrases, j’étais content. Puis, j’ai compris que ce n’était pas de la littérature. »
Journalisme
La révélation se produit au contact de Jean-Paul Sartre (1905-1980), dont l’étudiant en philosophie et en lettres lit toute l’œuvre romanesque (son deuxième prénom, Boris, qu’il prend à 20 ans, est inspiré d’un personnage des Chemins de la liberté, Gallimard, 1945-1949), en même temps que celles d’auteurs africains, tels Mongo Beti (1932-2001) et Ousmane Sembène (1923-2007), ou latino-américains, comme Ernesto Sabato (1911-2011) et Juan Rulfo (1917-1986). Puis, l’enseignant devient journaliste. Son écriture se fait « plus nerveuse ». Surtout, il « reste au contact de la société sénégalaise ».
Les romans de Boubacar Boris Diop témoignent, en particulier, du vif intérêt de son peuple pour la vie politique. Ainsi des coups de sang du tyran Dibi-Dibi dans Les Petits de la guenon ; des crimes du Français Pierre Castaneda, le véritable maître du pays dans Kaveena (éd. Philippe Rey, 2006) ; ou encore des ambitions du frère boiteux de Kinne Gaajo, prêt à se lancer dans l’arène. Comme ses concitoyens, la « comédie » jouée par les politiciens passionne l’écrivain. Dans son cas, cela remonte à Mai 68. « Maoïstes, trotskistes, social-impérialistes, partisans d’Enver Hoxha [le dictateur albanais, 1908-1985] : c’était bouillonnant à Dakar », se souvient-il.
Cette proximité avec le peuple sénégalais passe aussi par la langue. Dans Un tombeau pour Kinne Gaajo, Njéeme Pay convainc un rédacteur en chef plutôt moqueur d’offrir une chronique en wolof à Kinne Gaajo. Clin d’œil sans doute aux deux créations de Diop : EJO, une maison d’édition dakaroise en langues locales et DefuWaxu.com, l’unique quotidien wolof en ligne.
Violences
C’est en tant que journaliste qu’il accepte de participer en 1998 à la résidence « Rwanda : écrire par devoir de mémoire ». Dans sa nouvelle postface à Murambi, le livre des ossements (Zulma, 2011), Boubacar Boris Diop raconte comment il se rend alors compte qu’il n’a rien compris au génocide des Tutsi du Rwanda par les Hutu. « Je pensais qu’ils s’étaient entretués. » La faute aux médias, suppose-t-il, en se rappelant un proverbe de Njaajaann Njaay : « Si tu empruntes à quelqu’un ses yeux, ne t’étonne pas, l’ami, d’être obligé, quoi que tu fasses, de ne voir que ce que lui-même voit. »
Au mémorial du génocide érigé à Murambi, dans le sud du Rwanda, Boubacar Boris Diop voit de ses propres yeux les cadavres momifiés exhumés des fosses communes. La violence et l’aliénation deviennent des sujets entêtants de sa fiction – telle la guerre civile entre Twis et Mwas dépeinte dans Le Cavalier et son ombre (Stock, 1997 ; rééd. Philippe Rey, 2009) – comme de ses essais (notamment La Gloire des imposteurs. Lettres sur le Mali et l’Afrique, avec Aminata Dramane Traoré, éd. Philippe Rey, 2014).
C’est au Rwanda que l’auteur décide d’écrire dans sa langue maternelle. L’envie était déjà là, nourrie par la lecture de l’historien sénégalais Cheikh Anta Diop (1923-1986) et visible dans Le Cavalier et son ombre. L’héroïne, Khadidja, est payée pour raconter des fables à un riche client dont elle ne peut voir le visage. Elle incarne la figure de l’écrivain africain : elle parle sans savoir si on l’écoute, quand lui écrit sans qu’on le lise dans son pays.
A Murambi, Diop estime que le français « a eu son poids de sang terrible au Rwanda », la France s’étant compromise avec le régime génocidaire hutu. « J’en suis sorti meurtri, se souvient-il. Ce dégoût que j’ai éprouvé pour une langue qui s’est avérée meurtrière au Rwanda m’a donné le courage d’essayer d’écrire en wolof. Et j’ai réalisé qu’en fait c’est par là que j’aurais dû commencer, à 15 ans. »
Amnésie
« La chose essentielle, c’est savoir se souvenir. M’entends-tu, Njéeme ? Savoir se souvenir. Notre peuple le dit d’ailleurs de manière très imagée. Quand la mémoire va ramasser du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît », dit Kinne Gaajo. L’œuvre de Boubacar Boris Diop est hantée par la crainte de l’amnésie collective. Une crainte qui s’exprime par la forme même de ses romans – des contes de vivants consacrés à des disparus ; des paroles de disparus ressuscités par les vivants. Dans Le Cavalier et son ombre, Khadidja pense que l’histoire du Sénégal telle qu’elle est racontée aujourd’hui n’est qu’un tissu de mensonges.
Mythes et figures oubliés revivent dans les fictions de Diop : le philosophe Kocc Barma Fall (XVIe-XVIIe siècle) et Siidiya Lewon Joob (XIXe siècle), un prince du Waalo, comme le sacrifice des femmes du village Nder qui, en 1819, s’immolèrent par le feu pour éviter l’esclavage. Dans Les Petits de la guenon, les carnets laissés par un vieil homme à son petit-fils initient le jeune exilé à l’héritage des anciens royaumes du Waalo et du Cayor (nord-ouest du Sénégal actuel).
Les auteurs classiques wolof (Sërin Musaa Ka, 1890-1965 ; Sërin Mbay Jaxate, 1874-1954) constituent le socle des romans de Diop. « Je les ai beaucoup plus écoutés que lus puisque leur production, appelée “wolofal”, est en caractères arabes, explique l’écrivain. Ces poèmes sont souvent repris par les diseurs professionnels, et des fragments en reviennent tout le temps dans la conversation quotidienne. » En les inscrivant dans un roman, en wolof et en français, Boubacar Boris Diop les préserve un peu de l’oubli.
Critique
La couleur d’un crime
« Un tombeau pour Kinne Gaajo » (Bàmmeelu Kocc Barma), de Boubacar Boris Diop, traduit du wolof par l’auteur, éd. Philippe Rey, 346 p., 23 €, numérique 17 €.
Le 26 septembre 2002, le ferry reliant Ziguinchor à Dakar se retournait au large de la Gambie, « comme une calebasse ». Popularisée à l’époque, la métaphore n’a pas sa place dans Un tombeau pour Kinne Gaajo, le nouveau roman de Boubacar Boris Diop. Il lui substitue l’image vraie de la coque rouge sang du Joola. La couleur d’un crime : celui de l’oubli, si rapide, des près de 2 000 passagers morts et de l’ignorance de ce qui a été perdu pour le pays avec leur disparition. Qu’auraient pu devenir ces hommes, femmes et enfants ? Qu’auraient-ils pu changer ?
A Dakar, la journaliste Njéeme Pay se rend dans le village d’origine de Kinne Gaajo pour écrire la biographie de sa « plus-que-sœur », victime du naufrage. Son récit, ainsi que le livre qu’elle écrit, se découvre dans un enchâssement de contes et de récits, dont l’écrivain sénégalais a le secret. Puis, la défunte prend la parole dans une deuxième partie.
Ni hommage ni biographie, Diop signe un texte aux nombreuses métamorphoses, afin de saisir une présence. Qui était Kinne Gaajo, avec ses cigarettes et ses nuits blanches, sa voix rauque et son compagnon aussi « cinglé » qu’elle ? Une prostituée ? Une défenseuse de la langue wolof ? Tout cela, mais peut-être incarnait-elle d’abord le pays, sa langue et son histoire mêmes, qu’elle a tenté de transmettre.
Tandis que l’opprobre guette, médias et politiques poursuivent leur comédie. Reliant le destin de son héroïne à celui du Joola, ainsi qu’aux faits et figures oubliés de l’histoire du Sénégal, Un tombeau pour Kinne Gaajo rend la menace d’une amnésie collective aussi effrayante que réelle.
Signalons, du même auteur, chez le même éditeur, collection « Fugues », la parution en poche de « Kaveena », 300 p., 11,90 € ; du « Cavalier et son ombre », 240 p., 11,90 € ; des « Petits de la guenon », 442 p., 11,90 €.
Gladys Marivat(Collaboratrice du « Monde des livres »)
Source : Le Monde
Si c’était à refaire, il commencerait par là : écrire dans sa langue maternelle. Ainsi se conclut notre conversation avec Boubacar Boris Diop. Le romancier et essayiste sénégalais, né en 1946 à Dakar, a attendu 2003 avant de publier son premier roman en wolof, Doomi Golo (Papyrus, Dakar), traduit en français par ses soins six ans plus tard (Les Petits de la guenon, éd. Philippe Rey). Depuis, l’auteur a choisi d’écrire son œuvre de fiction uniquement en wolof.
La question de la langue est au centre de l’œuvre de l’ex-journaliste qui, depuis sa politique-fiction Le Temps de Tamango (L’Harmattan, 1981), interroge la mémoire du Sénégal, à travers sa littérature, ses mythes et son actualité. Dans Un tombeau pour Kinne Gaajo, son nouveau roman, une écrivaine fictive meurt dans le naufrage du ferry Joola, en 2002.
Comme souvent chez Boubacar Boris Diop, on y croise des « cinglés », une femme forte et énigmatique, des politiciens frappés du complexe du sauveur, d’appétissants plats sénégalais (baasi-salte, ñeleñ, ndambe et mbaxalu-saalum), des expressions en wolof et une cartographie de Dakar, « ville-pagaille » ; ainsi que les proverbes du « malicieux et quasi imparable » Njaajaann Njaay, le mythique ancêtre fondateur de la nation wolof.
Quatre « mots de passe » pour arpenter une œuvre prolifique, récompensée en 2022 par le prestigieux prix international de littérature Neustadt.
« Léebóon »
« Léebóon », « il était une fois » en wolof, résonne dans la plupart des romans que Boubacar Boris Diop situe au Sénégal, prononcé par le narrateur ou des personnages secondaires. « Une histoire ne vaut que racontée par la langue de qui l’a vécue », dit un proverbe sénégalais, repris de livre en livre. Souvent, la personne à qui est adressé le conte intervient, et les histoires s’enchâssent. Un tombeau pour Kinne Gaajoo ne déroge pas à la règle.
Le roman est divisé en deux grands récits – celui de Njéeme Pay, qui tente une biographie de son amie Kinne, puis celui de cette écrivaine et prostituée. L’omniprésence de la fable chez Boubacar Boris Diop reflète son « panthéon littéraire », dominé par une conteuse en wolof : sa mère. « J’étais un enfant impressionnable et donc persuadé que tout ce qu’elle disait était vrai, se souvient-il. J’ai très tôt compris la puissance des mots – proférés ou imprimés –, mais aussi que le monde réel et le monde imaginaire peuvent n’en faire qu’un. »
Les auteurs français du XIXe siècle, mythifiés par son père, un intendant né « la même année que Léopold Sédar Senghor [1906-2001] », ont également influencé l’écrivain. Dans un premier roman jamais publié, écrit à 15 ans, résonnait « un lyrisme extraordinaire » issu de Lamartine ou de Rimbaud. « Je n’avais pas d’intérêt pour ce qui se passait dans la société, juge-t-il. Quand je faisais de belles phrases, j’étais content. Puis, j’ai compris que ce n’était pas de la littérature. »
Journalisme
La révélation se produit au contact de Jean-Paul Sartre (1905-1980), dont l’étudiant en philosophie et en lettres lit toute l’œuvre romanesque (son deuxième prénom, Boris, qu’il prend à 20 ans, est inspiré d’un personnage des Chemins de la liberté, Gallimard, 1945-1949), en même temps que celles d’auteurs africains, tels Mongo Beti (1932-2001) et Ousmane Sembène (1923-2007), ou latino-américains, comme Ernesto Sabato (1911-2011) et Juan Rulfo (1917-1986). Puis, l’enseignant devient journaliste. Son écriture se fait « plus nerveuse ». Surtout, il « reste au contact de la société sénégalaise ».
Les romans de Boubacar Boris Diop témoignent, en particulier, du vif intérêt de son peuple pour la vie politique. Ainsi des coups de sang du tyran Dibi-Dibi dans Les Petits de la guenon ; des crimes du Français Pierre Castaneda, le véritable maître du pays dans Kaveena (éd. Philippe Rey, 2006) ; ou encore des ambitions du frère boiteux de Kinne Gaajo, prêt à se lancer dans l’arène. Comme ses concitoyens, la « comédie » jouée par les politiciens passionne l’écrivain. Dans son cas, cela remonte à Mai 68. « Maoïstes, trotskistes, social-impérialistes, partisans d’Enver Hoxha [le dictateur albanais, 1908-1985] : c’était bouillonnant à Dakar », se souvient-il.
Cette proximité avec le peuple sénégalais passe aussi par la langue. Dans Un tombeau pour Kinne Gaajo, Njéeme Pay convainc un rédacteur en chef plutôt moqueur d’offrir une chronique en wolof à Kinne Gaajo. Clin d’œil sans doute aux deux créations de Diop : EJO, une maison d’édition dakaroise en langues locales et DefuWaxu.com, l’unique quotidien wolof en ligne.
Violences
C’est en tant que journaliste qu’il accepte de participer en 1998 à la résidence « Rwanda : écrire par devoir de mémoire ». Dans sa nouvelle postface à Murambi, le livre des ossements (Zulma, 2011), Boubacar Boris Diop raconte comment il se rend alors compte qu’il n’a rien compris au génocide des Tutsi du Rwanda par les Hutu. « Je pensais qu’ils s’étaient entretués. » La faute aux médias, suppose-t-il, en se rappelant un proverbe de Njaajaann Njaay : « Si tu empruntes à quelqu’un ses yeux, ne t’étonne pas, l’ami, d’être obligé, quoi que tu fasses, de ne voir que ce que lui-même voit. »
Au mémorial du génocide érigé à Murambi, dans le sud du Rwanda, Boubacar Boris Diop voit de ses propres yeux les cadavres momifiés exhumés des fosses communes. La violence et l’aliénation deviennent des sujets entêtants de sa fiction – telle la guerre civile entre Twis et Mwas dépeinte dans Le Cavalier et son ombre (Stock, 1997 ; rééd. Philippe Rey, 2009) – comme de ses essais (notamment La Gloire des imposteurs. Lettres sur le Mali et l’Afrique, avec Aminata Dramane Traoré, éd. Philippe Rey, 2014).
C’est au Rwanda que l’auteur décide d’écrire dans sa langue maternelle. L’envie était déjà là, nourrie par la lecture de l’historien sénégalais Cheikh Anta Diop (1923-1986) et visible dans Le Cavalier et son ombre. L’héroïne, Khadidja, est payée pour raconter des fables à un riche client dont elle ne peut voir le visage. Elle incarne la figure de l’écrivain africain : elle parle sans savoir si on l’écoute, quand lui écrit sans qu’on le lise dans son pays.
A Murambi, Diop estime que le français « a eu son poids de sang terrible au Rwanda », la France s’étant compromise avec le régime génocidaire hutu. « J’en suis sorti meurtri, se souvient-il. Ce dégoût que j’ai éprouvé pour une langue qui s’est avérée meurtrière au Rwanda m’a donné le courage d’essayer d’écrire en wolof. Et j’ai réalisé qu’en fait c’est par là que j’aurais dû commencer, à 15 ans. »
Amnésie
« La chose essentielle, c’est savoir se souvenir. M’entends-tu, Njéeme ? Savoir se souvenir. Notre peuple le dit d’ailleurs de manière très imagée. Quand la mémoire va ramasser du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît », dit Kinne Gaajo. L’œuvre de Boubacar Boris Diop est hantée par la crainte de l’amnésie collective. Une crainte qui s’exprime par la forme même de ses romans – des contes de vivants consacrés à des disparus ; des paroles de disparus ressuscités par les vivants. Dans Le Cavalier et son ombre, Khadidja pense que l’histoire du Sénégal telle qu’elle est racontée aujourd’hui n’est qu’un tissu de mensonges.
Mythes et figures oubliés revivent dans les fictions de Diop : le philosophe Kocc Barma Fall (XVIe-XVIIe siècle) et Siidiya Lewon Joob (XIXe siècle), un prince du Waalo, comme le sacrifice des femmes du village Nder qui, en 1819, s’immolèrent par le feu pour éviter l’esclavage. Dans Les Petits de la guenon, les carnets laissés par un vieil homme à son petit-fils initient le jeune exilé à l’héritage des anciens royaumes du Waalo et du Cayor (nord-ouest du Sénégal actuel).
Les auteurs classiques wolof (Sërin Musaa Ka, 1890-1965 ; Sërin Mbay Jaxate, 1874-1954) constituent le socle des romans de Diop. « Je les ai beaucoup plus écoutés que lus puisque leur production, appelée “wolofal”, est en caractères arabes, explique l’écrivain. Ces poèmes sont souvent repris par les diseurs professionnels, et des fragments en reviennent tout le temps dans la conversation quotidienne. » En les inscrivant dans un roman, en wolof et en français, Boubacar Boris Diop les préserve un peu de l’oubli.
Critique
La couleur d’un crime
« Un tombeau pour Kinne Gaajo » (Bàmmeelu Kocc Barma), de Boubacar Boris Diop, traduit du wolof par l’auteur, éd. Philippe Rey, 346 p., 23 €, numérique 17 €.
Le 26 septembre 2002, le ferry reliant Ziguinchor à Dakar se retournait au large de la Gambie, « comme une calebasse ». Popularisée à l’époque, la métaphore n’a pas sa place dans Un tombeau pour Kinne Gaajo, le nouveau roman de Boubacar Boris Diop. Il lui substitue l’image vraie de la coque rouge sang du Joola. La couleur d’un crime : celui de l’oubli, si rapide, des près de 2 000 passagers morts et de l’ignorance de ce qui a été perdu pour le pays avec leur disparition. Qu’auraient pu devenir ces hommes, femmes et enfants ? Qu’auraient-ils pu changer ?
A Dakar, la journaliste Njéeme Pay se rend dans le village d’origine de Kinne Gaajo pour écrire la biographie de sa « plus-que-sœur », victime du naufrage. Son récit, ainsi que le livre qu’elle écrit, se découvre dans un enchâssement de contes et de récits, dont l’écrivain sénégalais a le secret. Puis, la défunte prend la parole dans une deuxième partie.
Ni hommage ni biographie, Diop signe un texte aux nombreuses métamorphoses, afin de saisir une présence. Qui était Kinne Gaajo, avec ses cigarettes et ses nuits blanches, sa voix rauque et son compagnon aussi « cinglé » qu’elle ? Une prostituée ? Une défenseuse de la langue wolof ? Tout cela, mais peut-être incarnait-elle d’abord le pays, sa langue et son histoire mêmes, qu’elle a tenté de transmettre.
Tandis que l’opprobre guette, médias et politiques poursuivent leur comédie. Reliant le destin de son héroïne à celui du Joola, ainsi qu’aux faits et figures oubliés de l’histoire du Sénégal, Un tombeau pour Kinne Gaajo rend la menace d’une amnésie collective aussi effrayante que réelle.
Signalons, du même auteur, chez le même éditeur, collection « Fugues », la parution en poche de « Kaveena », 300 p., 11,90 € ; du « Cavalier et son ombre », 240 p., 11,90 € ; des « Petits de la guenon », 442 p., 11,90 €.
Gladys Marivat(Collaboratrice du « Monde des livres »)
Source : Le Monde
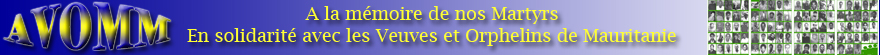
 Actualités
Actualités





















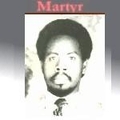
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)