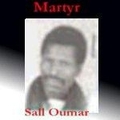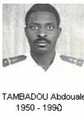J’ai longtemps cru que c’était le terrorisme qui m’avait engendré. J’aimerais pouvoir le dire autrement, mais s’il faut remonter à ma source, les faits sont là, inéluctables: ce sont les Frères musulmans, tristes pionniers des organisations terroristes islamistes, qui ont fait en sorte que ma famille a quitté l’Égypte. Chrétiens d’Orient, Juifs d’Orient, minorités réprouvées: les migrants de 1952 ont connu le grand incendie du Caire, ont vu leurs voisins se lancer de leur balcon avec leurs enfants pour échapper aux flammes, mais ils n’ont pas connu la guerre. Et c’est pour que leurs enfants ne la connaissent jamais qu’ils sont partis, le cœur déchiré, la peur au ventre, les valises vides. Mon grand-père a emmené son fils devant les pyramides le jour de leur départ, le 1er octobre 1952. «Regarde-les bien car tu ne les reverras plus jamais». Charles Kemeid savait que ce départ était sans retour, qu’ils ne reviendraient pas sur le sol natal.
Soixante-trois ans plus tard, mon père n’y est toujours pas retourné. Pourtant, pas un jour ne passe sans qu’il évoque l’Égypte, devenue synonyme de son enfance arrachée. En 1968, alors que la jeunesse française découvrait la plage sous les pavés, il s’est acheté une moto à Marseille afin de longer la rive nord de la Méditerranée, celle-là même que mon grand-père m’avait pointé du doigt quand j’avais trois ans, en me disant: «Regarde la mer, Olivier!» «La mère de qui?» avais-je demandé. «De nous. Notre mère à nous tous.» Gil Kemeid a roulé pendant six mois sur les routes de ce bassin de l’humanité, vaste creuset des civilisations, jusqu’à Istanbul, où il s’est arrêté. Fin du périple. Il y a quelques années, je lui ai demandé pourquoi il avait suivi cet itinéraire. «Pour me rendre jusqu’aux confins de l’Europe, m’a-t-il répondu, et aux portes de l’Orient. De là, je n’ai pas été capable de poursuivre. Mais tout au long de mon voyage, je pouvais regarder, sur ma droite, par-delà notre mer, l’Égypte.» Il aurait pu dire tout autant l’enfance, ce pays où l’on ne retourne jamais.
Aujourd’hui, la guerre a atteint notre sol. Ceux qui sont venus trouver refuge à Paris, à Londres, à Madrid retrouvent la terreur à laquelle ils ont tenté d’échapper. Je pense à ceux qui sont tombés parce que par une belle nuit d’automne, ils avaient décidé de danser. De chanter. De boire. D’être sur une terrasse à Paris avec des amis chers, l’un des bonheurs que cette Terre damnée peut offrir. Je pense à mes cousins libanais, subissant l’attentat éternel à Beyrouth. Je pense aussi, toujours, à mes frères et sœurs syriens qui, comme ma famille en 1952, tentent de fuir ces mêmes horreurs pour survivre. Ces frères et sœurs que l’on confond parfois avec leurs bourreaux. «L’Histoire est un cauchemar dont je cherche à m’éveiller» écrit James Joyce.
Moi, né d’une union entre deux personnes, l’une, née en Égypte, l’autre, au Québec, issues de régions du monde dont les cultures seraient en choc de civilisation, moi qui ai longtemps cru que la terreur qui a poussé ma famille à s’exiler était en grande partie responsable de ma naissance, sais aujourd’hui, et m’y raccroche comme on s’accroche à une planche de salut dans cet océan d’horreur, que c’est l’amour et tout ce qui peut nous rapprocher comme êtres humains, par-delà nos différences culturelles, qui m’a fait naître. Puisse cette union perdurer malgré les années sombres dans lesquelles nous sommes plongés; puissent nos sangs se mêler par alliance, et non par les armes.
Olivier Kemeid
Source: journallemetro
Soixante-trois ans plus tard, mon père n’y est toujours pas retourné. Pourtant, pas un jour ne passe sans qu’il évoque l’Égypte, devenue synonyme de son enfance arrachée. En 1968, alors que la jeunesse française découvrait la plage sous les pavés, il s’est acheté une moto à Marseille afin de longer la rive nord de la Méditerranée, celle-là même que mon grand-père m’avait pointé du doigt quand j’avais trois ans, en me disant: «Regarde la mer, Olivier!» «La mère de qui?» avais-je demandé. «De nous. Notre mère à nous tous.» Gil Kemeid a roulé pendant six mois sur les routes de ce bassin de l’humanité, vaste creuset des civilisations, jusqu’à Istanbul, où il s’est arrêté. Fin du périple. Il y a quelques années, je lui ai demandé pourquoi il avait suivi cet itinéraire. «Pour me rendre jusqu’aux confins de l’Europe, m’a-t-il répondu, et aux portes de l’Orient. De là, je n’ai pas été capable de poursuivre. Mais tout au long de mon voyage, je pouvais regarder, sur ma droite, par-delà notre mer, l’Égypte.» Il aurait pu dire tout autant l’enfance, ce pays où l’on ne retourne jamais.
Aujourd’hui, la guerre a atteint notre sol. Ceux qui sont venus trouver refuge à Paris, à Londres, à Madrid retrouvent la terreur à laquelle ils ont tenté d’échapper. Je pense à ceux qui sont tombés parce que par une belle nuit d’automne, ils avaient décidé de danser. De chanter. De boire. D’être sur une terrasse à Paris avec des amis chers, l’un des bonheurs que cette Terre damnée peut offrir. Je pense à mes cousins libanais, subissant l’attentat éternel à Beyrouth. Je pense aussi, toujours, à mes frères et sœurs syriens qui, comme ma famille en 1952, tentent de fuir ces mêmes horreurs pour survivre. Ces frères et sœurs que l’on confond parfois avec leurs bourreaux. «L’Histoire est un cauchemar dont je cherche à m’éveiller» écrit James Joyce.
Moi, né d’une union entre deux personnes, l’une, née en Égypte, l’autre, au Québec, issues de régions du monde dont les cultures seraient en choc de civilisation, moi qui ai longtemps cru que la terreur qui a poussé ma famille à s’exiler était en grande partie responsable de ma naissance, sais aujourd’hui, et m’y raccroche comme on s’accroche à une planche de salut dans cet océan d’horreur, que c’est l’amour et tout ce qui peut nous rapprocher comme êtres humains, par-delà nos différences culturelles, qui m’a fait naître. Puisse cette union perdurer malgré les années sombres dans lesquelles nous sommes plongés; puissent nos sangs se mêler par alliance, et non par les armes.
Olivier Kemeid
Source: journallemetro
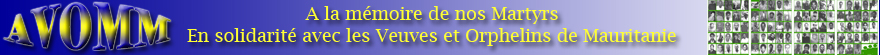
 Actualités
Actualités





















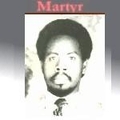
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)