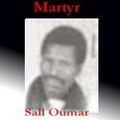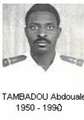Veuve de l’ancien chef de l’État burkinabè
La veuve de l’ancien chef de l’État burkinabè était attendue le 15 octobre à Ouagadougou où elle n’est pas retournée depuis juin 1988. Elle ne cherche pas à rentrer définitivement. Pour l’heure, elle entend rester à Montpellier, en France, avec ses deux fils. Mais pour le vingtième anniversaire de la mort de son mari, elle veut s’incliner sur sa tombe et témoigner. Surtout, elle veut savoir.
Jeune Afrique : Quel est le message que lègue votre mari ?
Mariam Sankara : Thomas a su montrer à son peuple qu’il pouvait devenir digne et fier avec de la volonté, du courage, de la probité et du travail.
Il a permis à son pays de rompre avec l’ordre colonial. Ce qui reste avant tout de mon mari, c’est son intégrité. Je pense aussi à tout ce qu’il a fait pour l’émancipation de la femme. Et puis, je retiens cette phrase, quand il a démissionné du gouvernement Saye Zerbo : « Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple ! »
A-t-il commis une erreur ?
Oui, je pense qu’il a trop fait confiance. Il croyait que toutes les personnes qui l’entouraient partageaient le même idéal que lui et mettaient la révolution au-dessus de leurs propres intérêts.
Est-ce pour cela qu’il est mort ?
Oui. Il a fait confiance à quelqu’un.
À Compaoré ?
Oui, c’est sûr, puisqu’il était son ami. Et quand les gens lui disaient que Blaise n’était pas fiable, il disait : « Non, ce que nous partageons est plus important. »
Pourquoi dites-vous quelquefois : « Je suis l’héritière d’un destin qui me dépasse » ?
Je ne savais pas quand j’ai épousé Thomas, en 1979, qu’il aurait ce destin. À l’époque, il était lieutenant. Il ne pouvait pas faire ouvertement de la politique. Mais quand j’ai commencé à le fréquenter, j’ai compris qu’il en était passionné, qu’il voyait beaucoup de syndicalistes et d’étudiants. J’étais alors étudiante, et j’avais une tout autre idée des militaires. Pour moi, c’était la répression. Donc j’hésitais. Mais un de mes camarades m’a dit : « Ah non, celui-ci, c’est un militaire pas comme les autres ! » Et, avec le temps, j’ai appris à le connaître. J’aimais bien ses idées. D’ailleurs, quand il le pouvait, il ne portait pas son uniforme. En tout cas, pas avec moi.
Le sankarisme est-il encore une force ?
C’est un modèle de société. Beaucoup de gens regrettent Sankara et se disent que, s’il était là, les choses iraient mieux. En ce moment, il y a une montée sankariste avec des partis et des associations. D’ailleurs, cela gêne le pouvoir. Il veut l’empêcher par tous les moyens. À la dernière élection présidentielle, en 2005, j’ai soutenu la candidature de Me Bénéwendé Sankara [lire aussi p. 56, NDLR]. C’est mon avocat et c’est un camarade déterminé, malgré tous les problèmes qu’on lui crée. Il est arrivé deuxième derrière Compaoré. Bien sûr, 5 % des voix, ce n’est pas grand-chose, mais dans le système du Burkina, c’est déjà bien.
Quand Compaoré affirme que le Burkina d’aujourd’hui est plus « démocratique » et plus « stable » que celui d’il y a vingt ans (voir J.A. n° 2439), comment réagissez-vous ?
Pour moi, ce n’est que de la façade. On sait bien que la corruption, l’intimidation et l’impunité sont institutionnalisées. Et puis, Compaoré use de tous les moyens pour rester au pouvoir. La démocratie dans mon pays, je n’y crois pas. C’est de la « démocrature », comme disent les gens.
Et quand il annonce la construction d’un monument à la mémoire de tous les anciens présidents ?
Moi, je dirais que c’est de la comédie. Il n’y a pas une volonté réelle de réhabiliter la mémoire de mon époux parce que, chaque fois qu’il y a une décision à prendre, Thomas est noyé dans un groupe.
Et quand Compaoré dit, à propos de l’assassinat de votre mari, que « le Burkina n’est pas le seul pays à connaître des affaires non élucidées » ?
Oui, mais, le 15 octobre 1987, même s’il dormait, comme il dit, il s’est bien réveillé pour savoir ce qui s’était passé. En fait, comme toujours, c’est une façon de mépriser tout ce qui concerne Thomas. Un jour, à la suite de la plainte contre X que j’ai déposée et qui n’a pas été jugée recevable par les tribunaux civils, il a dit que le ministre de la Défense n’était pas là pour s’occuper des affaires de justice. Or la loi stipule que c’est ce ministre qui peut donner l’ordre de poursuivre devant les tribunaux militaires. Donc, il sait qu’il y a quelque chose ! De toute façon, les acteurs du 15 octobre sont encore en vie, et un jour on saura. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a demandé aux autorités burkinabè de me donner accès à la justice.
Qui a tué votre mari ?
Moi, je ne peux pas le dire, j’ai porté plainte. J’attends que l’enquête se fasse. Mais si Blaise veut se déculpabiliser, il n’a qu’à permettre l’instruction !
Pensez-vous que c’est lui qui a donné l’ordre ?
En tout cas, c’est lui qui a profité.
Soupçonnez-vous la Côte d’Ivoire d’Houphouët-Boigny d’avoir trempé dans ce complot ?
On a parlé de la Côte d’Ivoire, mais aussi de la France. C’est vrai que Thomas dérangeait. Notamment Houphouët. Et je me dis que c’est bien possible. J’attends l’enquête.
Pensez-vous que ceux qui l’ont tué voulaient seulement l’arrêter et n’ont tiré que parce qu’il a résisté ?
Non. Ils voulaient le tuer, parce qu’ils pouvaient l’arrêter à tout moment et partout, même chez lui.
N’avait-il pas des gardes du corps ?
Peut-être, mais si ceux qui l’ont tué sont arrivés jusqu’à lui, cela veut dire qu’ils avaient accès partout. Ils pouvaient donc l’arrêter. Et c’est pourquoi je me révolte. Je n’accepte pas sa mort.
N’est-ce pas difficile de vivre dans le souvenir de son mari ?
Certaines personnes me le reprochent, mais c’est comme si cela venait de se passer. C’est quelque chose que je vis au quotidien. Chaque jour, il y a quelque chose qui me rappelle ce qui s’est passé, et je ne l’ai pas encore accepté. Vous savez, c’est difficile. Vous quittez une personne comme ça, et puis vous n’avez jamais vu le corps… C’est dur. Très dur.
Jeune Afrique
La veuve de l’ancien chef de l’État burkinabè était attendue le 15 octobre à Ouagadougou où elle n’est pas retournée depuis juin 1988. Elle ne cherche pas à rentrer définitivement. Pour l’heure, elle entend rester à Montpellier, en France, avec ses deux fils. Mais pour le vingtième anniversaire de la mort de son mari, elle veut s’incliner sur sa tombe et témoigner. Surtout, elle veut savoir.
Jeune Afrique : Quel est le message que lègue votre mari ?
Mariam Sankara : Thomas a su montrer à son peuple qu’il pouvait devenir digne et fier avec de la volonté, du courage, de la probité et du travail.
Il a permis à son pays de rompre avec l’ordre colonial. Ce qui reste avant tout de mon mari, c’est son intégrité. Je pense aussi à tout ce qu’il a fait pour l’émancipation de la femme. Et puis, je retiens cette phrase, quand il a démissionné du gouvernement Saye Zerbo : « Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple ! »
A-t-il commis une erreur ?
Oui, je pense qu’il a trop fait confiance. Il croyait que toutes les personnes qui l’entouraient partageaient le même idéal que lui et mettaient la révolution au-dessus de leurs propres intérêts.
Est-ce pour cela qu’il est mort ?
Oui. Il a fait confiance à quelqu’un.
À Compaoré ?
Oui, c’est sûr, puisqu’il était son ami. Et quand les gens lui disaient que Blaise n’était pas fiable, il disait : « Non, ce que nous partageons est plus important. »
Pourquoi dites-vous quelquefois : « Je suis l’héritière d’un destin qui me dépasse » ?
Je ne savais pas quand j’ai épousé Thomas, en 1979, qu’il aurait ce destin. À l’époque, il était lieutenant. Il ne pouvait pas faire ouvertement de la politique. Mais quand j’ai commencé à le fréquenter, j’ai compris qu’il en était passionné, qu’il voyait beaucoup de syndicalistes et d’étudiants. J’étais alors étudiante, et j’avais une tout autre idée des militaires. Pour moi, c’était la répression. Donc j’hésitais. Mais un de mes camarades m’a dit : « Ah non, celui-ci, c’est un militaire pas comme les autres ! » Et, avec le temps, j’ai appris à le connaître. J’aimais bien ses idées. D’ailleurs, quand il le pouvait, il ne portait pas son uniforme. En tout cas, pas avec moi.
Le sankarisme est-il encore une force ?
C’est un modèle de société. Beaucoup de gens regrettent Sankara et se disent que, s’il était là, les choses iraient mieux. En ce moment, il y a une montée sankariste avec des partis et des associations. D’ailleurs, cela gêne le pouvoir. Il veut l’empêcher par tous les moyens. À la dernière élection présidentielle, en 2005, j’ai soutenu la candidature de Me Bénéwendé Sankara [lire aussi p. 56, NDLR]. C’est mon avocat et c’est un camarade déterminé, malgré tous les problèmes qu’on lui crée. Il est arrivé deuxième derrière Compaoré. Bien sûr, 5 % des voix, ce n’est pas grand-chose, mais dans le système du Burkina, c’est déjà bien.
Quand Compaoré affirme que le Burkina d’aujourd’hui est plus « démocratique » et plus « stable » que celui d’il y a vingt ans (voir J.A. n° 2439), comment réagissez-vous ?
Pour moi, ce n’est que de la façade. On sait bien que la corruption, l’intimidation et l’impunité sont institutionnalisées. Et puis, Compaoré use de tous les moyens pour rester au pouvoir. La démocratie dans mon pays, je n’y crois pas. C’est de la « démocrature », comme disent les gens.
Et quand il annonce la construction d’un monument à la mémoire de tous les anciens présidents ?
Moi, je dirais que c’est de la comédie. Il n’y a pas une volonté réelle de réhabiliter la mémoire de mon époux parce que, chaque fois qu’il y a une décision à prendre, Thomas est noyé dans un groupe.
Et quand Compaoré dit, à propos de l’assassinat de votre mari, que « le Burkina n’est pas le seul pays à connaître des affaires non élucidées » ?
Oui, mais, le 15 octobre 1987, même s’il dormait, comme il dit, il s’est bien réveillé pour savoir ce qui s’était passé. En fait, comme toujours, c’est une façon de mépriser tout ce qui concerne Thomas. Un jour, à la suite de la plainte contre X que j’ai déposée et qui n’a pas été jugée recevable par les tribunaux civils, il a dit que le ministre de la Défense n’était pas là pour s’occuper des affaires de justice. Or la loi stipule que c’est ce ministre qui peut donner l’ordre de poursuivre devant les tribunaux militaires. Donc, il sait qu’il y a quelque chose ! De toute façon, les acteurs du 15 octobre sont encore en vie, et un jour on saura. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a demandé aux autorités burkinabè de me donner accès à la justice.
Qui a tué votre mari ?
Moi, je ne peux pas le dire, j’ai porté plainte. J’attends que l’enquête se fasse. Mais si Blaise veut se déculpabiliser, il n’a qu’à permettre l’instruction !
Pensez-vous que c’est lui qui a donné l’ordre ?
En tout cas, c’est lui qui a profité.
Soupçonnez-vous la Côte d’Ivoire d’Houphouët-Boigny d’avoir trempé dans ce complot ?
On a parlé de la Côte d’Ivoire, mais aussi de la France. C’est vrai que Thomas dérangeait. Notamment Houphouët. Et je me dis que c’est bien possible. J’attends l’enquête.
Pensez-vous que ceux qui l’ont tué voulaient seulement l’arrêter et n’ont tiré que parce qu’il a résisté ?
Non. Ils voulaient le tuer, parce qu’ils pouvaient l’arrêter à tout moment et partout, même chez lui.
N’avait-il pas des gardes du corps ?
Peut-être, mais si ceux qui l’ont tué sont arrivés jusqu’à lui, cela veut dire qu’ils avaient accès partout. Ils pouvaient donc l’arrêter. Et c’est pourquoi je me révolte. Je n’accepte pas sa mort.
N’est-ce pas difficile de vivre dans le souvenir de son mari ?
Certaines personnes me le reprochent, mais c’est comme si cela venait de se passer. C’est quelque chose que je vis au quotidien. Chaque jour, il y a quelque chose qui me rappelle ce qui s’est passé, et je ne l’ai pas encore accepté. Vous savez, c’est difficile. Vous quittez une personne comme ça, et puis vous n’avez jamais vu le corps… C’est dur. Très dur.
Jeune Afrique
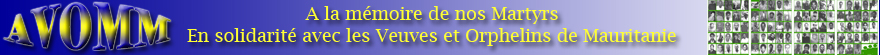
 Actualités
Actualités



















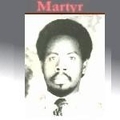
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)