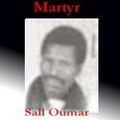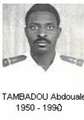Nous avons décidé de le publier parce qu'il illustre, mieux peut-être que toutes les enquêtes, le monde de Kafka dans lequel sont plongés les demandeurs d'asile et ceux qui traitent leurs dossiers.
Certes, la France ne peut accueillir, selon l'_expression consacrée, toute la misère du monde. Mais, souvent insuffisamment formés, exhortés à « faire du chiffre », les agents de l'Ofpra sont confrontés à l'obligation de pratiquer un tri cruel et parfois arbitraire selon des critères pas toujours explicites. Au moment où le gouvernement prépare une nouvelle loi sur l'immigration alors que l'Europe des 25 tente d'élaborer des règles d'asile communes et où il entend rendre plus strictes les conditions de l'obtention du statut de réfugié, ce récit du quotidien d'un agent, vu de l'intérieur, démontre la complexité et les difficultés concrètes d'une application juste et cohérente du droit d'asile.
Un témoignage exclusif
Le visage sérieux et concentré, droits comme des petits soldats, nous écoutons attentivement le discours de bienvenue du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. «Nous avons reçu 60 000 demandes d'asile l'année dernière. Le délai de traitement des dossiers est actuellement de onze mois, l'objectif est de passer à deux mois », explique-t-il aux 150 nouvelles recrues, en cette matinée de janvier 2003. Pendant deux ans, jusqu'à ma démission, j'ai assisté à la préparation puis à l'application de la réforme du droit d'asile.
Au poste d'officier de protection, je recevais les dossiers des demandeurs et je les convoquais en entretien afin de leur reconnaître ou non le statut de réfugié politique. « Il ne faut pas parler d'unités de déstockage », martèle mon chef de service. Et pourtant, la nouvelle armée d'officiers de protection est chargée d'épurer les 30 000 dossiers en attente. En guise de mise en jambes, la hiérarchie a décidé que nous devions nous exercer avec des procédures courtes: des demandes dont le récit n'apparaît pas suffisamment crédible pour que l'on reçoive le demandeur en entretien. Pour ces dossiers, triés par un collègue expérimenté, il n'y a pas de doute possible, la réponse est non. A peine le temps de réaliser que je vais m'occuper des demandes d'asile en provenance de la République démocratique du Congo et de la Mauritanie, me voici face à mes dossiers.
Toute à ma mission de protection, j'ouvre le premier et je découvre un visage. Il est congolais, il a 35 ans, son regard est plein d'espoir. Qui a-t-il laissé derrière lui ? S'est-il endetté pour faire ce voyage ? Inutile de me poser la question. Son destin est scellé: je dois rejeter sa demande. Il n'a même pas le droit de se défendre lors d'un entretien. La conduite à tenir est tracée: lire le dossier, relever les incohérences du récit, estimer qu'il n'est pas suffisamment détaillé. « J'étais officier dans l'armée de Mobutu, a écrit le demandeur. Lorsqu'il a quitté le pouvoir, les partisans de Kabila ont pillé ma maison, violé ma femme et ma fille. J'ai pu fuir par une fenêtre, je me suis caché chez ma tante et elle m'a aidé à quitter le pays. Je ne peux pas retourner à Kinshasa, où je risque d'être assassiné par le nouveau régime.» La sentence, toujours la même, tient en une seule et même formule: « Les déclarations de l'intéressé, peu personnalisées et non circonstanciées, ne permettent pas d'établir la réalité des faits énoncés ni la nature des craintes évoquées. La demande d'asile est donc rejetée.»
Dossier suivant. Autour de moi, dans l'open space, mes collègues produisent des rejets à la chaîne. Je m'interroge. Dans quelles circonstances les demandeurs ont-ils rempli leurs dossiers ? A peine arrivés en France, ils doivent foncer à la préfecture pour obtenir une autorisation provisoire de séjour (aujourd'hui, trois semaines). Ils n'ont qu'un mois pour envoyer leur dossier à l'Ofpra. Pour eux, la course commence: trouver un logement, déclencher les allocations dont ils bénéficieront pendant un an et, l'essentiel, préparer leur demande d'asile. Bien sûr, ils ne parlent pas français. Bien sûr, ils n'ont pas apporté tous les documents qui prouvent les persécutions qu'ils ont subies puisqu'ils ont fui. Alors que font-ils ? Ils se tournent vers leur communauté. Et ils paient 30 euros pour la traduction d'une page ou la fabrication d'une histoire type, censée leur permettre de décrocher le statut de réfugié politique, 50 euros pour une fausse pièce d'identité ou un diplôme bidon.
«On descend en box»
Certains, venus en France pour des raisons économiques, profitent de ces récits fabriqués de toutes pièces. Mais d'autres ont réellement souffert, ayant été persécutés parce qu'ils sont militants politiques, homosexuels ou journalistes. Comment les distinguer des autres ? Ils sont passés par le même réseau. Ils dictent leur récit à un compatriote qui, parfois peu scrupuleux, invente une autre histoire. Ne parlant pas la langue, ils ne perçoivent pas la supercherie. Leur dossier en poche, ils envoient le tout à l'Ofpra. Moi, jeune officier de protection, je sais qu'on ne peut pas déterminer, à sa seule lecture, si le demandeur d'asile a réellement souffert ou non. Je sais que je devrais le recevoir et l'écouter pour savoir s'il a écrit la vérité. Pourtant, il faut «déstocker». Mon chef a reçu l'instruction de faire du chiffre. Alors je fais du chiffre. Je rejette la demande de personnes qui, peut-être, craignent la mort dans leur pays.
Nul, dans la hiérarchie, ne remet en question la manière dont sont traités les dossiers. Nous sommes seuls face à nos cas de conscience. Et à notre méconnaissance du terrain. A mon arrivée, j'ai reçu une «fiche pays» censée contenir les informations essentielles pour prendre une décision. A savoir: une chronologie sommaire et quelques lignes sur les partis politiques d'opposition, le profil des personnes susceptibles d'être persécutées et la nature de ces sévices. Je vais bientôt recevoir les premiers demandeurs d'asile en entretien. Pour me préparer, j'observe des collègues plus expérimentés. Selon la formule consacrée, «on descend en box». Le lieu n'est pas franchement accueillant: entre 2 et 3 mètres carrés, parfois sans fenêtre, une table et trois chaises. Il est 9 heures pétantes, j'accompagne une collègue qui a convoqué trois personnes dans la matinée. Elle est jeune, n'a qu'un an et demi de métier et, pourtant, elle est lasse. Elle part chercher le demandeur dans la salle d'attente: «N° 58.» Un Mauritanien se lève: jean, baskets, sourire timide. Il s'assied face à nous, face au vide. Ma collègue ne le regarde même pas. Elle vérifie son état civil, lui demande de raconter son histoire, pose des questions sans lever le nez de la feuille sur laquelle elle prend tout en note. Le jeune homme m'interroge du regard. Avez-vous quelque chose à ajouter ?» demande ma collègue. La question clôt une demi-heure d'entretien.
Au suivant: «N° 60.» J'espère ne jamais finir comme elle. Heureusement, un autre officier de protection me donne de l'espoir. Souriante, douce, à l'écoute, elle laisse d'abord le demandeur raconter son histoire avant de poser des questions: «Vous dites avoir été militant à l'UDPS [Union pour la démocratie et le progrès social], quelle est l'idéologie de ce parti?» Puis: «Vous dites avoir été arrêté par la Division spéciale présidentielle le 18 avril 2000, pouvez-vous me décrire votre interpellation ?» Il nous regarde droit dans les yeux, nous répond avec aplomb, paraît assuré. Je regarde ma collègue, qui l'écoute avec attention. «Merci monsieur. L'entretien est fini. Vous recevrez la réponse de l'Ofpra dans les quinze jours.» Elle se lève. Je la suis, en proie au doute. Est-ce qu'elle va lui reconnaître le statut ? Je lui pose la question. Elle me regarde en souriant: « Non. Il ne peut pas avoir été arrêté par ces forces armées. Elles ont été dissoutes en 1997.» Je reste interdite: comment vais-je réussir à engranger autant d'informations ? Le week-end, je cours m'acheter des livres sur la Mauritanie et la République démocratique du Congo. Le jour du premier entretien arrive. Une question m'obsède: comment vais-je démêler le vrai du faux ? Suis-je assez informée pour poser les bonnes questions et déterminer si le demandeur dit la vérité ? Et où trouver l'information ? Sur Internet ? Impossible: nos terminaux ne sont pas connectés. Auprès des anciens collègues ? Difficile: nous avons l'ordre de ne pas les déranger. A la documentation ? Compliqué: la bibliothèque est ridiculement petite et les documentalistes sont trop peu nombreux. Quant à solliciter les Affaires étrangères, notre ministère de tutelle, j'ai vite abandonné l'idée après l'avoir soumise à mon chef. «Vous n'y pensez pas.» Le débat était clos.
Il faut faire du chiffre, sinon c'est la porte
Au bout de quelques mois, il faut bien se rendre à l'évidence: les agréments se font rares et certains dossiers sont montés de toutes pièces. Souvent, obtenir le statut de réfugié politique est la seule solution pour avoir des papiers en France. Tous les matins, devant le bâtiment, ils sont une centaine à faire la queue pour défendre leur cause. Seuls 10% d'entre eux obtiendront le statut. Pourquoi ? Parce que la plupart sont en France pour des raisons économiques. C'est la misère qui les a poussés à fuir leur pays. A nous de faire le tri: oui pour celui-ci, non pour celui-là. Nos critères juridiques sont inscrits dans la convention de Genève écrite en 1951, qui stipule: « Le terme de réfugié s'appliquera à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.» Notre mission est de vérifier si la personne appartient à l'une de ces cinq catégories et de prouver qu'elle a réellement été persécutée. Une question me taraude: est-ce que toutes les conditions sont réunies pour prendre des décisions justes ? Chaque officier de protection rencontre plus de 300 demandeurs d'asile par an. 70% d'entre nous sont dans une situation précaire: un contrat d'un an, renouvelable… s'ils atteignent les objectifs. A savoir: écumer 2,2 dossiers par jour, pas un de moins! Il faut aller vite, faire du chiffre. Sinon, c'est la porte! Nous avons tous entre 25 et 30 ans, des projets de vie: trouver un logement, avoir des enfants, partir en vacances. Et, tous les ans, au mois de décembre, nous attendons le verdict: notre contrat est-il renouvelé ou bien allons-nous devoir pointer aux Assedic ? Pour éviter de se poser la question, quelques officiers de protection traitent les dossiers mécaniquement et remplissent les feuilles de statistiques mensuelles sans trop réfléchir. Du coup, les dossiers sont étudiés différemment suivant le caractère de chacun. Par exemple, lorsque les demandeurs ne viennent pas à l'entretien, je téléphone à la préfecture pour savoir s'ils n'ont pas changé d'adresse, car ils sont nombreux à ne pas avoir de logement fixe. Or certains de mes collègues pensent que ce coup de fil est une perte de temps, multipliée si le demandeur vient en entretien, et ils préfèrent considérer que celui-ci n'a pas daigné se déplacer: ils lui refusent l'asile et l'affaire est classée.
Pour moi, le cas le plus difficile a été celui d'un Mauritanien qui habitait à la frontière du Sénégal. A peine 25 ans, vêtu d'un boubou traditionnel bleu pâle, il est entré dans mon box sans oser me regarder. Il s'est assis et, les yeux pointés sur ses chaussures, il m'a raconté son histoire en peul, tandis que l'interprète traduisait. Marabout, son père enseignait l'islam dans une école coranique. En 1989, lorsqu'un conflit éclata entre le Sénégal et la Mauritanie, les Négro-Mauritaniens furent la cible des Maures au pouvoir. L'armée fit alors irruption dans le village peul pour confisquer les quelques richesses des habitants. Le demandeur explique que son père a résisté, puis il ne trouve plus les mots pour poursuivre. Il a honte, plonge son regard vers le sol. « Les militaires lui ont demandé…», commence-t-il. La suite ne vient pas. Je lui demande, le plus doucement possible: « Que s'est-il passé? » Il lâche: « Ils lui ont demandé de se déshabiller devant nous et ses élèves.» Je ne m'attendais pas à cela: c'est humiliant, soit, mais pourquoi paraît-il si affecté ? Il explique que la réputation de son père est ruinée. Sa famille a quitté le village. Et n'y reviendra jamais. Son visage s'affaisse, il a tout dit. A la sortie du box, je me tourne vers l'interprète: « Qu'y a-t-il de si violent dans cette agression ?» Il me rétorque, droit dans les yeux: « Il n'y a rien de pire pour un marabout que d'être dégradé ainsi devant toute sa famille. Il est très pudique, il porte des boubous qui ne dévoilent que ses mains. Même sa femme ne l'a jamais vu nu. Sa réputation est anéantie et son fils, dont le destin est de prendre sa suite, ne pourra jamais assumer ses fonctions. C'est terrible», conclut-il, abattu. Je comprends mieux. Je propose de reconnaître le statut à cet homme et me bats pour que ma hiérarchie comprenne les enjeux culturels de ces persécutions. Réticent au départ, mon chef cède face à ma détermination. Là encore, je mesure l'importance du hasard: si un autre officier de protection avait traité le dossier, il n'aurait peut-être pas eu le statut.
Un an a passé. Le renouvellement des contrats a été dur: mes collègues et moi, nous nous sommes battus pour dénoncer la difficulté de travailler correctement. Sanction: trois d'entre nous ne sont pas reconduits, une collègue et moi-même ne sommes renouvelées que six mois. Je suis déçue par l'institution: j'ai cru à ma mission, j'ai défendu mes dossiers et, pour toute reconnaissance, je n'ai qu'un contrat de six mois. Pour ma deuxième année, changement radical: je suis bombardée, sans qu'on m'ait consultée, à la demande d'asile asiatique. Pakistan, Sri Lanka, Inde, Mongolie, Bangladesh, voilà mes nouvelles destinations. Pas le temps de faire le deuil de l'Afrique, on m'apporte les nouveaux dossiers. Comment peut-on être affecté sur une zone du monde que l'on ne connaît pas? L'office ne voit pas le problème. Moi, si. Langues, codes, gestuelle, culture, repères différents, j'ai l'impression de débarquer sur une autre planète: pour acquiescer, les Sri Lankais et les Indiens secouent la tête de gauche à droite, comme s'ils disaient non. Les Bangladais racontent leur histoire comme s'ils la récitaient. Certains Pakistanais ne regardent pas les femmes dans les yeux lors des entretiens et il vaut mieux ne pas s'habiller trop court.
Les dix pages des fameuses «fiches pays»
En à peine un mois, il faut connaître la situation politique d'une dizaine de contrées. Mission impossible lorsque, pour toute documentation, on nous distribue les dix pages des fameuses «fiches pays». Un dossier sri-lankais en main, je fonce voir mon chef: «Un Tamoul prétend avoir été persécuté par la police du LTTE [Tigres de libération de l'Eelam tamoul]. Qu'est-ce que je dois faire?» «Il n'y a pas de police au LTTE», affirme-t-il, l'air amusé de ma naïveté. Sa réponse me surprend. Je cours voir une collègue qui connaît très bien le pays. «Mais bien sûr que si, dit-elle, le LTTE a une police. D'ailleurs, tu peux lire cet article», ajoute-t-elle en me tendant un article du Times sur le sujet. A qui puis-je faire confiance? Pour lutter contre mon ignorance, je m'installe dans le bureau de deux spécialistes, l'un sur l'Inde et le Pakistan, l'autre sur le Sri Lanka. Ainsi encadrée, j'ai l'impression de diminuer ma marge d'erreur. J'essaie de comprendre la réalité de ces nouveaux pays, je me sens démunie. Comment être crédible et rassurer quelqu'un quand on n'a aucune idée de la situation dont il parle? Je me sens en totale insécurité. Il m'est difficile d'apparaître décontractée et souriante. Plus je constate ma difficulté face aux demandeurs, plus je me fige. Il m'arrive de les couper au milieu de leurs phrases à force d'exaspération. J'ai honte de moi, je ne me reconnais plus. Je me documente, mais comment connaître le plan de la capitale de chaque pays, le cours de la monnaie, l'idéologie de chaque parti, l'organisation de chaque gouvernement? Je parle avec mes collègues de bureau. Ils essaient de me rassurer, mais je me sens incompétente. Heureusement, certains d'entre eux ont gardé la foi et échanger avec eux m'apaise. L'office m'a usée: chaque histoire humaine est dramatique, quelles que soient les raisons qui ont poussé les personnes à quitter leur pays. J'ai en face de moi des demandeurs clochardisés, qui ont passé la nuit dehors. D'autres paient un loyer démesuré pour avoir une paillasse dans un 20-mètres carrés insalubre et surpeuplé. Dans le box, ils défendent leur avenir, celui de leur famille restée au pays. Leurs yeux espèrent, leurs mains se tordent et leur voix supplie. Et moi, qui ai le pouvoir de faire basculer leur destin, je deviens insensible à toute cette misère. Je sais que mon comportement est préjudiciable aux demandeurs. Au mois de janvier, j'ai enfin l'occasion d'exprimer ma colère. Je participe à une grève inédite: il s'agit du premier mouvement qui rassemble les salariés de l'office, ceux de la commission de recours des réfugiés (la cour d'appel de l'office) et les avocats qui défendent les requérants. Nous sommes tous réunis sous un mot d'ordre: «Asile en danger». Les rapporteurs de la CRR confient leur dégoût durant l'accueil fait aux demandeurs. Des familles entières attendent, assises à même le sol, dans les couloirs. Le nombre de dossiers à traiter par séance est tel qu'ils ont à peine le temps de les étudier.
Une histoire semblable à toutes les autres
Quelques dossiers exceptionnels me redonnent espoir. Par exemple, ce demandeur qui dit appartenir à la communauté biharie, un grand classique des dossiers bangladais. Originaires de l'Etat musulman du Bihar, ses membres ont choisi de s'exiler au Pakistan oriental (le futur Bangladesh) lors de la scission entre l'Inde et le Pakistan. Là-bas, ils ont occupé des postes à responsabilité jusqu'à la guerre d'indépendance, durant laquelle ils ont été maltraités par la population parce qu'ils soutenaient l'armée pakistanaise et étaient considérés comme des traîtres. Aujourd'hui, les Biharis sont exclus de la citoyenneté bangladaise et ils sont parqués dans un camp au centre de Dacca, où ils vivent dans le dénuement le plus total. Le jour de l'entretien, le demandeur est arrivé triste et voûté. Il m'a raconté son histoire, semblable à toutes les autres: humiliations quotidiennes et viol de sa femme. Il pleure, gémit. La routine. Je lui pose une question ou deux, brutalement. L'interprète lui demande sans cesse de parler bengali et non ourdou, la langue de sa communauté. Je m'interroge: peut-être celui-ci est-il réellement bihari? Je ne veux pas passer à côté de cet homme. Je le reconvoque. Fait rarissime, il est vraiment bihari. Il nous explique ses conditions de vie dans le camp de Mohamedpur, où tous ses compatriotes sont parqués, la misère et les persécutions quotidiennes, la débrouille et finalement le viol de sa femme. Il est brisé, il sanglote. J'ai la gorge serrée. Je me tourne vers l'interprète: elle pleure en silence. Je respire un grand coup. Mais je n'arrive pas à me retenir. C'est la première fois. Lorsqu'une femme congolaise m'avait raconté son viol collectif par des soldats rwandais, j'étais sortie du box sous le prétexte de lui ramener un verre d'eau. Aujourd'hui, cet homme dégage tant de désespoir que l'interprète et moi sommes dévastées. Un quart d'heure après, il faut repartir en entretien. Je tombe sur une femme qui prétend appartenir à une minorité ethnique persécutée, mais elle en parle avec un tel mépris que, en quelques minutes, je me rends compte que c'est impossible. L'interprète est crispée. Dans l'ascenseur, elle raconte qu'elle-même appartient à cette minorité et qu'elle a dû fuir son pays à 12 ans.
Etape suivante: défendre le dossier. Ma chef estime que cet homme peut rentrer dans son pays parce qu'il n'a pas à craindre la mort. Je ne cède pas et j'obtiens gain de cause. Quelques semaines plus tard, l'une de mes collègues se plie, pour un cas similaire, aux arguments de la hiérarchie; le demandeur n'a pas été reconnu réfugié. La routine s'installe: entretien puis rejet. Il devient déprimant d'être une machine à fabriquer des sans-papiers. Partir devient une nécessité.
Catherine Le Gall
Certes, la France ne peut accueillir, selon l'_expression consacrée, toute la misère du monde. Mais, souvent insuffisamment formés, exhortés à « faire du chiffre », les agents de l'Ofpra sont confrontés à l'obligation de pratiquer un tri cruel et parfois arbitraire selon des critères pas toujours explicites. Au moment où le gouvernement prépare une nouvelle loi sur l'immigration alors que l'Europe des 25 tente d'élaborer des règles d'asile communes et où il entend rendre plus strictes les conditions de l'obtention du statut de réfugié, ce récit du quotidien d'un agent, vu de l'intérieur, démontre la complexité et les difficultés concrètes d'une application juste et cohérente du droit d'asile.
Un témoignage exclusif
Le visage sérieux et concentré, droits comme des petits soldats, nous écoutons attentivement le discours de bienvenue du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. «Nous avons reçu 60 000 demandes d'asile l'année dernière. Le délai de traitement des dossiers est actuellement de onze mois, l'objectif est de passer à deux mois », explique-t-il aux 150 nouvelles recrues, en cette matinée de janvier 2003. Pendant deux ans, jusqu'à ma démission, j'ai assisté à la préparation puis à l'application de la réforme du droit d'asile.
Au poste d'officier de protection, je recevais les dossiers des demandeurs et je les convoquais en entretien afin de leur reconnaître ou non le statut de réfugié politique. « Il ne faut pas parler d'unités de déstockage », martèle mon chef de service. Et pourtant, la nouvelle armée d'officiers de protection est chargée d'épurer les 30 000 dossiers en attente. En guise de mise en jambes, la hiérarchie a décidé que nous devions nous exercer avec des procédures courtes: des demandes dont le récit n'apparaît pas suffisamment crédible pour que l'on reçoive le demandeur en entretien. Pour ces dossiers, triés par un collègue expérimenté, il n'y a pas de doute possible, la réponse est non. A peine le temps de réaliser que je vais m'occuper des demandes d'asile en provenance de la République démocratique du Congo et de la Mauritanie, me voici face à mes dossiers.
Toute à ma mission de protection, j'ouvre le premier et je découvre un visage. Il est congolais, il a 35 ans, son regard est plein d'espoir. Qui a-t-il laissé derrière lui ? S'est-il endetté pour faire ce voyage ? Inutile de me poser la question. Son destin est scellé: je dois rejeter sa demande. Il n'a même pas le droit de se défendre lors d'un entretien. La conduite à tenir est tracée: lire le dossier, relever les incohérences du récit, estimer qu'il n'est pas suffisamment détaillé. « J'étais officier dans l'armée de Mobutu, a écrit le demandeur. Lorsqu'il a quitté le pouvoir, les partisans de Kabila ont pillé ma maison, violé ma femme et ma fille. J'ai pu fuir par une fenêtre, je me suis caché chez ma tante et elle m'a aidé à quitter le pays. Je ne peux pas retourner à Kinshasa, où je risque d'être assassiné par le nouveau régime.» La sentence, toujours la même, tient en une seule et même formule: « Les déclarations de l'intéressé, peu personnalisées et non circonstanciées, ne permettent pas d'établir la réalité des faits énoncés ni la nature des craintes évoquées. La demande d'asile est donc rejetée.»
Dossier suivant. Autour de moi, dans l'open space, mes collègues produisent des rejets à la chaîne. Je m'interroge. Dans quelles circonstances les demandeurs ont-ils rempli leurs dossiers ? A peine arrivés en France, ils doivent foncer à la préfecture pour obtenir une autorisation provisoire de séjour (aujourd'hui, trois semaines). Ils n'ont qu'un mois pour envoyer leur dossier à l'Ofpra. Pour eux, la course commence: trouver un logement, déclencher les allocations dont ils bénéficieront pendant un an et, l'essentiel, préparer leur demande d'asile. Bien sûr, ils ne parlent pas français. Bien sûr, ils n'ont pas apporté tous les documents qui prouvent les persécutions qu'ils ont subies puisqu'ils ont fui. Alors que font-ils ? Ils se tournent vers leur communauté. Et ils paient 30 euros pour la traduction d'une page ou la fabrication d'une histoire type, censée leur permettre de décrocher le statut de réfugié politique, 50 euros pour une fausse pièce d'identité ou un diplôme bidon.
«On descend en box»
Certains, venus en France pour des raisons économiques, profitent de ces récits fabriqués de toutes pièces. Mais d'autres ont réellement souffert, ayant été persécutés parce qu'ils sont militants politiques, homosexuels ou journalistes. Comment les distinguer des autres ? Ils sont passés par le même réseau. Ils dictent leur récit à un compatriote qui, parfois peu scrupuleux, invente une autre histoire. Ne parlant pas la langue, ils ne perçoivent pas la supercherie. Leur dossier en poche, ils envoient le tout à l'Ofpra. Moi, jeune officier de protection, je sais qu'on ne peut pas déterminer, à sa seule lecture, si le demandeur d'asile a réellement souffert ou non. Je sais que je devrais le recevoir et l'écouter pour savoir s'il a écrit la vérité. Pourtant, il faut «déstocker». Mon chef a reçu l'instruction de faire du chiffre. Alors je fais du chiffre. Je rejette la demande de personnes qui, peut-être, craignent la mort dans leur pays.
Nul, dans la hiérarchie, ne remet en question la manière dont sont traités les dossiers. Nous sommes seuls face à nos cas de conscience. Et à notre méconnaissance du terrain. A mon arrivée, j'ai reçu une «fiche pays» censée contenir les informations essentielles pour prendre une décision. A savoir: une chronologie sommaire et quelques lignes sur les partis politiques d'opposition, le profil des personnes susceptibles d'être persécutées et la nature de ces sévices. Je vais bientôt recevoir les premiers demandeurs d'asile en entretien. Pour me préparer, j'observe des collègues plus expérimentés. Selon la formule consacrée, «on descend en box». Le lieu n'est pas franchement accueillant: entre 2 et 3 mètres carrés, parfois sans fenêtre, une table et trois chaises. Il est 9 heures pétantes, j'accompagne une collègue qui a convoqué trois personnes dans la matinée. Elle est jeune, n'a qu'un an et demi de métier et, pourtant, elle est lasse. Elle part chercher le demandeur dans la salle d'attente: «N° 58.» Un Mauritanien se lève: jean, baskets, sourire timide. Il s'assied face à nous, face au vide. Ma collègue ne le regarde même pas. Elle vérifie son état civil, lui demande de raconter son histoire, pose des questions sans lever le nez de la feuille sur laquelle elle prend tout en note. Le jeune homme m'interroge du regard. Avez-vous quelque chose à ajouter ?» demande ma collègue. La question clôt une demi-heure d'entretien.
Au suivant: «N° 60.» J'espère ne jamais finir comme elle. Heureusement, un autre officier de protection me donne de l'espoir. Souriante, douce, à l'écoute, elle laisse d'abord le demandeur raconter son histoire avant de poser des questions: «Vous dites avoir été militant à l'UDPS [Union pour la démocratie et le progrès social], quelle est l'idéologie de ce parti?» Puis: «Vous dites avoir été arrêté par la Division spéciale présidentielle le 18 avril 2000, pouvez-vous me décrire votre interpellation ?» Il nous regarde droit dans les yeux, nous répond avec aplomb, paraît assuré. Je regarde ma collègue, qui l'écoute avec attention. «Merci monsieur. L'entretien est fini. Vous recevrez la réponse de l'Ofpra dans les quinze jours.» Elle se lève. Je la suis, en proie au doute. Est-ce qu'elle va lui reconnaître le statut ? Je lui pose la question. Elle me regarde en souriant: « Non. Il ne peut pas avoir été arrêté par ces forces armées. Elles ont été dissoutes en 1997.» Je reste interdite: comment vais-je réussir à engranger autant d'informations ? Le week-end, je cours m'acheter des livres sur la Mauritanie et la République démocratique du Congo. Le jour du premier entretien arrive. Une question m'obsède: comment vais-je démêler le vrai du faux ? Suis-je assez informée pour poser les bonnes questions et déterminer si le demandeur dit la vérité ? Et où trouver l'information ? Sur Internet ? Impossible: nos terminaux ne sont pas connectés. Auprès des anciens collègues ? Difficile: nous avons l'ordre de ne pas les déranger. A la documentation ? Compliqué: la bibliothèque est ridiculement petite et les documentalistes sont trop peu nombreux. Quant à solliciter les Affaires étrangères, notre ministère de tutelle, j'ai vite abandonné l'idée après l'avoir soumise à mon chef. «Vous n'y pensez pas.» Le débat était clos.
Il faut faire du chiffre, sinon c'est la porte
Au bout de quelques mois, il faut bien se rendre à l'évidence: les agréments se font rares et certains dossiers sont montés de toutes pièces. Souvent, obtenir le statut de réfugié politique est la seule solution pour avoir des papiers en France. Tous les matins, devant le bâtiment, ils sont une centaine à faire la queue pour défendre leur cause. Seuls 10% d'entre eux obtiendront le statut. Pourquoi ? Parce que la plupart sont en France pour des raisons économiques. C'est la misère qui les a poussés à fuir leur pays. A nous de faire le tri: oui pour celui-ci, non pour celui-là. Nos critères juridiques sont inscrits dans la convention de Genève écrite en 1951, qui stipule: « Le terme de réfugié s'appliquera à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.» Notre mission est de vérifier si la personne appartient à l'une de ces cinq catégories et de prouver qu'elle a réellement été persécutée. Une question me taraude: est-ce que toutes les conditions sont réunies pour prendre des décisions justes ? Chaque officier de protection rencontre plus de 300 demandeurs d'asile par an. 70% d'entre nous sont dans une situation précaire: un contrat d'un an, renouvelable… s'ils atteignent les objectifs. A savoir: écumer 2,2 dossiers par jour, pas un de moins! Il faut aller vite, faire du chiffre. Sinon, c'est la porte! Nous avons tous entre 25 et 30 ans, des projets de vie: trouver un logement, avoir des enfants, partir en vacances. Et, tous les ans, au mois de décembre, nous attendons le verdict: notre contrat est-il renouvelé ou bien allons-nous devoir pointer aux Assedic ? Pour éviter de se poser la question, quelques officiers de protection traitent les dossiers mécaniquement et remplissent les feuilles de statistiques mensuelles sans trop réfléchir. Du coup, les dossiers sont étudiés différemment suivant le caractère de chacun. Par exemple, lorsque les demandeurs ne viennent pas à l'entretien, je téléphone à la préfecture pour savoir s'ils n'ont pas changé d'adresse, car ils sont nombreux à ne pas avoir de logement fixe. Or certains de mes collègues pensent que ce coup de fil est une perte de temps, multipliée si le demandeur vient en entretien, et ils préfèrent considérer que celui-ci n'a pas daigné se déplacer: ils lui refusent l'asile et l'affaire est classée.
Pour moi, le cas le plus difficile a été celui d'un Mauritanien qui habitait à la frontière du Sénégal. A peine 25 ans, vêtu d'un boubou traditionnel bleu pâle, il est entré dans mon box sans oser me regarder. Il s'est assis et, les yeux pointés sur ses chaussures, il m'a raconté son histoire en peul, tandis que l'interprète traduisait. Marabout, son père enseignait l'islam dans une école coranique. En 1989, lorsqu'un conflit éclata entre le Sénégal et la Mauritanie, les Négro-Mauritaniens furent la cible des Maures au pouvoir. L'armée fit alors irruption dans le village peul pour confisquer les quelques richesses des habitants. Le demandeur explique que son père a résisté, puis il ne trouve plus les mots pour poursuivre. Il a honte, plonge son regard vers le sol. « Les militaires lui ont demandé…», commence-t-il. La suite ne vient pas. Je lui demande, le plus doucement possible: « Que s'est-il passé? » Il lâche: « Ils lui ont demandé de se déshabiller devant nous et ses élèves.» Je ne m'attendais pas à cela: c'est humiliant, soit, mais pourquoi paraît-il si affecté ? Il explique que la réputation de son père est ruinée. Sa famille a quitté le village. Et n'y reviendra jamais. Son visage s'affaisse, il a tout dit. A la sortie du box, je me tourne vers l'interprète: « Qu'y a-t-il de si violent dans cette agression ?» Il me rétorque, droit dans les yeux: « Il n'y a rien de pire pour un marabout que d'être dégradé ainsi devant toute sa famille. Il est très pudique, il porte des boubous qui ne dévoilent que ses mains. Même sa femme ne l'a jamais vu nu. Sa réputation est anéantie et son fils, dont le destin est de prendre sa suite, ne pourra jamais assumer ses fonctions. C'est terrible», conclut-il, abattu. Je comprends mieux. Je propose de reconnaître le statut à cet homme et me bats pour que ma hiérarchie comprenne les enjeux culturels de ces persécutions. Réticent au départ, mon chef cède face à ma détermination. Là encore, je mesure l'importance du hasard: si un autre officier de protection avait traité le dossier, il n'aurait peut-être pas eu le statut.
Un an a passé. Le renouvellement des contrats a été dur: mes collègues et moi, nous nous sommes battus pour dénoncer la difficulté de travailler correctement. Sanction: trois d'entre nous ne sont pas reconduits, une collègue et moi-même ne sommes renouvelées que six mois. Je suis déçue par l'institution: j'ai cru à ma mission, j'ai défendu mes dossiers et, pour toute reconnaissance, je n'ai qu'un contrat de six mois. Pour ma deuxième année, changement radical: je suis bombardée, sans qu'on m'ait consultée, à la demande d'asile asiatique. Pakistan, Sri Lanka, Inde, Mongolie, Bangladesh, voilà mes nouvelles destinations. Pas le temps de faire le deuil de l'Afrique, on m'apporte les nouveaux dossiers. Comment peut-on être affecté sur une zone du monde que l'on ne connaît pas? L'office ne voit pas le problème. Moi, si. Langues, codes, gestuelle, culture, repères différents, j'ai l'impression de débarquer sur une autre planète: pour acquiescer, les Sri Lankais et les Indiens secouent la tête de gauche à droite, comme s'ils disaient non. Les Bangladais racontent leur histoire comme s'ils la récitaient. Certains Pakistanais ne regardent pas les femmes dans les yeux lors des entretiens et il vaut mieux ne pas s'habiller trop court.
Les dix pages des fameuses «fiches pays»
En à peine un mois, il faut connaître la situation politique d'une dizaine de contrées. Mission impossible lorsque, pour toute documentation, on nous distribue les dix pages des fameuses «fiches pays». Un dossier sri-lankais en main, je fonce voir mon chef: «Un Tamoul prétend avoir été persécuté par la police du LTTE [Tigres de libération de l'Eelam tamoul]. Qu'est-ce que je dois faire?» «Il n'y a pas de police au LTTE», affirme-t-il, l'air amusé de ma naïveté. Sa réponse me surprend. Je cours voir une collègue qui connaît très bien le pays. «Mais bien sûr que si, dit-elle, le LTTE a une police. D'ailleurs, tu peux lire cet article», ajoute-t-elle en me tendant un article du Times sur le sujet. A qui puis-je faire confiance? Pour lutter contre mon ignorance, je m'installe dans le bureau de deux spécialistes, l'un sur l'Inde et le Pakistan, l'autre sur le Sri Lanka. Ainsi encadrée, j'ai l'impression de diminuer ma marge d'erreur. J'essaie de comprendre la réalité de ces nouveaux pays, je me sens démunie. Comment être crédible et rassurer quelqu'un quand on n'a aucune idée de la situation dont il parle? Je me sens en totale insécurité. Il m'est difficile d'apparaître décontractée et souriante. Plus je constate ma difficulté face aux demandeurs, plus je me fige. Il m'arrive de les couper au milieu de leurs phrases à force d'exaspération. J'ai honte de moi, je ne me reconnais plus. Je me documente, mais comment connaître le plan de la capitale de chaque pays, le cours de la monnaie, l'idéologie de chaque parti, l'organisation de chaque gouvernement? Je parle avec mes collègues de bureau. Ils essaient de me rassurer, mais je me sens incompétente. Heureusement, certains d'entre eux ont gardé la foi et échanger avec eux m'apaise. L'office m'a usée: chaque histoire humaine est dramatique, quelles que soient les raisons qui ont poussé les personnes à quitter leur pays. J'ai en face de moi des demandeurs clochardisés, qui ont passé la nuit dehors. D'autres paient un loyer démesuré pour avoir une paillasse dans un 20-mètres carrés insalubre et surpeuplé. Dans le box, ils défendent leur avenir, celui de leur famille restée au pays. Leurs yeux espèrent, leurs mains se tordent et leur voix supplie. Et moi, qui ai le pouvoir de faire basculer leur destin, je deviens insensible à toute cette misère. Je sais que mon comportement est préjudiciable aux demandeurs. Au mois de janvier, j'ai enfin l'occasion d'exprimer ma colère. Je participe à une grève inédite: il s'agit du premier mouvement qui rassemble les salariés de l'office, ceux de la commission de recours des réfugiés (la cour d'appel de l'office) et les avocats qui défendent les requérants. Nous sommes tous réunis sous un mot d'ordre: «Asile en danger». Les rapporteurs de la CRR confient leur dégoût durant l'accueil fait aux demandeurs. Des familles entières attendent, assises à même le sol, dans les couloirs. Le nombre de dossiers à traiter par séance est tel qu'ils ont à peine le temps de les étudier.
Une histoire semblable à toutes les autres
Quelques dossiers exceptionnels me redonnent espoir. Par exemple, ce demandeur qui dit appartenir à la communauté biharie, un grand classique des dossiers bangladais. Originaires de l'Etat musulman du Bihar, ses membres ont choisi de s'exiler au Pakistan oriental (le futur Bangladesh) lors de la scission entre l'Inde et le Pakistan. Là-bas, ils ont occupé des postes à responsabilité jusqu'à la guerre d'indépendance, durant laquelle ils ont été maltraités par la population parce qu'ils soutenaient l'armée pakistanaise et étaient considérés comme des traîtres. Aujourd'hui, les Biharis sont exclus de la citoyenneté bangladaise et ils sont parqués dans un camp au centre de Dacca, où ils vivent dans le dénuement le plus total. Le jour de l'entretien, le demandeur est arrivé triste et voûté. Il m'a raconté son histoire, semblable à toutes les autres: humiliations quotidiennes et viol de sa femme. Il pleure, gémit. La routine. Je lui pose une question ou deux, brutalement. L'interprète lui demande sans cesse de parler bengali et non ourdou, la langue de sa communauté. Je m'interroge: peut-être celui-ci est-il réellement bihari? Je ne veux pas passer à côté de cet homme. Je le reconvoque. Fait rarissime, il est vraiment bihari. Il nous explique ses conditions de vie dans le camp de Mohamedpur, où tous ses compatriotes sont parqués, la misère et les persécutions quotidiennes, la débrouille et finalement le viol de sa femme. Il est brisé, il sanglote. J'ai la gorge serrée. Je me tourne vers l'interprète: elle pleure en silence. Je respire un grand coup. Mais je n'arrive pas à me retenir. C'est la première fois. Lorsqu'une femme congolaise m'avait raconté son viol collectif par des soldats rwandais, j'étais sortie du box sous le prétexte de lui ramener un verre d'eau. Aujourd'hui, cet homme dégage tant de désespoir que l'interprète et moi sommes dévastées. Un quart d'heure après, il faut repartir en entretien. Je tombe sur une femme qui prétend appartenir à une minorité ethnique persécutée, mais elle en parle avec un tel mépris que, en quelques minutes, je me rends compte que c'est impossible. L'interprète est crispée. Dans l'ascenseur, elle raconte qu'elle-même appartient à cette minorité et qu'elle a dû fuir son pays à 12 ans.
Etape suivante: défendre le dossier. Ma chef estime que cet homme peut rentrer dans son pays parce qu'il n'a pas à craindre la mort. Je ne cède pas et j'obtiens gain de cause. Quelques semaines plus tard, l'une de mes collègues se plie, pour un cas similaire, aux arguments de la hiérarchie; le demandeur n'a pas été reconnu réfugié. La routine s'installe: entretien puis rejet. Il devient déprimant d'être une machine à fabriquer des sans-papiers. Partir devient une nécessité.
Catherine Le Gall
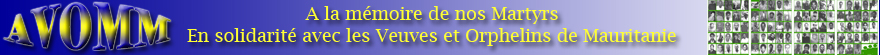
 Actualités
Actualités



















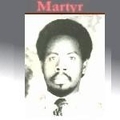
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)