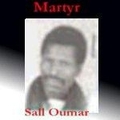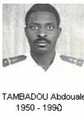Alors que le Sénégal est plongé dans l’incertitude concernant la tenue de sa prochaine élection présidentielle, l’intellectuel sénégalais exhorte le chef de l’État à prendre ses responsabilités et analyse les raisons d’une crise sans précédent de la démocratie de son pays.
L’ACTU VUE PAR – C’était le 14 février au Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), à Marseille, lors du lancement du Labo Nord Europe de la Fondation de l’innovation pour la démocratie. On y débattait de la manière de réinventer la démocratie, de lui redonner du sens. Un projet bien à propos pour Felwine Sarr, qui est apparu ces derniers jours comme l’un des intellectuels sénégalais les plus en pointe dans le combat contre le report de l’élection présidentielle.
Dialoguant à distance avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, l’auteur d’Afrotopia et de Les lieux qu’habitent mes rêves, entre autres, se désole de voir son Sénégal natal, qui a pourtant connu la tenue d’élections régulières et deux alternances, en 2000 et 2012, expérimenter une « agression antidémocratique ». Comme dans cet entretien qu’il nous a accordé, il invite le pays à regarder en face, afin de les soigner au mieux, ces vulnérabilités qui l’exposent à un risque évident de régression. Interview.
Jeune Afrique : Le Conseil constitutionnel a annulé le report au 15 décembre de la présidentielle, voté par l’Assemblée nationale et à l’origine d’une grave crise politique au Sénégal. Comment accueillez-vous cette décision ? Quels sont les scénarios possibles pour la suite ?
Felwine Sarr : Nous en sommes particulièrement heureux, mais nous devons rester vigilants. Ce report est une victoire du Conseil constitutionnel, qui nous adresse ainsi un message clair : on peut réussir à stopper une dérive autoritaire si chacun prend ses responsabilités et si les citoyens se mobilisent. Le report au 15 décembre de l’élection présidentielle et la prolongation au pouvoir jusqu’à cette date du président Macky Sall étant déclarés inconstitutionnels, le mandat de ce dernier prendra fin le 2 avril prochain comme initialement prévu, et le processus électoral interrompu reprendra son cours.
Mais cela implique une réflexion sur le réaménagement de la période de campagne…
Évidemment. Faudra-t-il accorder trois semaines aux candidats pour faire campagne et repousser de quelques jours la date du scrutin ? Devront-ils, à l’inverse, s’accommoder d’une campagne plus courte ? Selon des juristes que j’ai pu interroger, le président devra convoquer rapidement le corps électoral. Le premier tour pourrait se dérouler avant le 10 mars, le second, deux semaines plus tard. Quant à la campagne électorale, elle pourrait démarrer assez rapidement. Dans tous les cas, il est souhaitable qu’en comptant le deuxième tour et le délai requis pour le contentieux électoral tout cela n’excède pas la date du 2 avril.
Après les turbulences de ces derniers jours, les Sénégalais sont-ils toujours prêts à aller aux urnes aussi rapidement ?
Le président Macky Sall a mis fin au processus électoral à dix heures de l’ouverture de la campagne officielle. Les citoyens sont prêts depuis plusieurs semaines déjà. Les équipes de campagne des candidats étaient dans les starting-blocks et une partie du matériel électoral était déjà parvenu dans certaines localités. Et il faut au moins reconnaître à l’administration territoriale sénégalaise une grande efficacité dans l’organisation des scrutins électoraux : il n’y a jamais eu de problème technique. Le débat porte davantage sur le temps de la campagne, certains estimant d’ailleurs que cette dernière n’est pas nécessaire puisque les citoyennes et des citoyens auraient déjà fait leur choix. On pourrait le dire : les Sénégalais ont eu, depuis 2021, trois ans de campagne…
Cette décision du Conseil constitutionnel n’est-elle pas un désaveu, non seulement pour Macky Sall, mais aussi pour les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, qui lui ont apporté leur soutien à travers une lettre ouverte qu’ils ont cosignée ?
Le président Abdou Diouf s’est quelque peu rattrapé avec une mise au point qu’il a rédigée dès le lendemain, seul cette fois, dans laquelle il exige le respect de la loi et de l’ordre constitutionnel. Dès lors, le stratagème politique du président Sall, mais aussi de Karim Wade et du PDS, a été désavoué par cette décision du Conseil constitutionnel.
Diriez-vous qu’il ne faut pas désespérer de la démocratie sénégalaise ?
Oui. Il y a eu une mobilisation extraordinaire. La société civile, les journalistes, les intellectuels, les citoyennes et les citoyens, les détenus politiques du fond de leur geôle… ont fait valoir des arguments politiques et surtout juridiques, démontrant ainsi qu’ils gardaient leur puissance d’agir, le fameux cratos du peuple, qu’ils ont les moyens de faire entendre leurs voix, et qu’il ne faut jamais abdiquer tant que les voies légales ne sont pas épuisées. Ce sont les masses qui font l’histoire ; déterminées, elles peuvent remporter des victoires sociétales et, ici en l’occurrence, démocratiques.
Dans l’une de vos interviews, vous invitiez toutes les forces vives du Sénégal à s’organiser et à agir afin d’obtenir la restauration du calendrier républicain. N’était-ce pas trop demander à un peuple qui a déjà payé un trop lourd tribut à cette lutte ?
On peut mener des combats intelligents, le premier étant d’abord juridique et institutionnel : des recours ont été déposés. Ces combats se livrent dans l’opinion. Il s’agit de transmettre la bonne information, de clarifier les arguments de droit, de lutter contre les obscurcissements voulus par les discours idéologiques. Les mobilisations citoyennes n’impliquent pas toujours un rapport de force frontal. Le peuple peut se dresser dans une résistance ferme, volontaire et obstinée contre ce qui est inacceptable ; une résistance fondée sur des principes de droit, de justice et d’équité.
Dans une tribune récente, cosignée avec une centaine d’universitaires, vous avez qualifié « l’annulation » de l’élection présidentielle de « bouquet final » d’un « plan de liquidation de la démocratie sénégalaise que le régime en place déploie depuis une douzaine d’années ». À quel plan faisiez-vous référence ?
Depuis plusieurs années, il est clair que le pouvoir actuel souhaite se maintenir en place en se jouant de la Constitution. Le président Macky Sall n’a jamais souhaité affronter ses vrais adversaires dans les urnes. En 2012, après l’ère Abdoulaye Wade, il y a eu dans le pays une réelle demande de redevabilité. Pour y répondre, lorsque Karim Wade a été soupçonné de détournement de deniers publics, la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) a été ressuscitée. Elle l’a condamné. Au bout de quelques années, le président Macky Sall l’a gracié et exilé au Qatar, car il le considérait comme un adversaire potentiel dans des élections à venir.
En 2017, même scénario : Khalifa Sall, maire de Dakar, a été accusé d’avoir détourné de l’argent d’une caisse d’avance de la mairie, a été emprisonné et écarté de l’élection présidentielle de 2019. Plus récemment, entre 2021 et 2023, les condamnations successives puis l’embastillement d’Ousmane Sonko ont conforté le peuple dans l’idée que, pour Macky Sall, faire de la politique consiste à éliminer de l’espace politique ses adversaires les plus redoutés. Par ailleurs, sous son magistère, différents procédés de fermeture de l’espace public et d’entrave à l’exercice des libertés sont hélas devenus familiers : interdiction des manifestations ; emprisonnement des activistes, des jeunes ou d’individus ayant une opinion dissidente ; multiplication d’actes visant à égratigner la démocratie sénégalaise, la contester, l’affaiblir ; amenuiser les contrepouvoirs. La dérive autoritariste de Macky Sall a culminé avec ce décret qui annule les élections et empêche les citoyens d’exprimer leur volonté à travers le suffrage universel.
Comment en est-on arrivé là ? Tout le problème n’est-il pas, au fond, celui de l’hyperprésidentialisme ?
C’est exactement cela. En 1962, alors que le Sénégal est encore un régime parlementaire, le pays connait une crise de bicéphalie, avec, au sommet de l’État, un président du Conseil tout-puissant, Mamadou Dia, et un président de la République aux pouvoirs limités, Léopold Sédar Senghor, qui s’opposent sur les options de politique économique. Dia est arrêté et emprisonné ; Senghor, lui, fait adopter une nouvelle Constitution instituant un régime semi-présidentiel fort pour pallier l’instabilité qui prévaut. Nous avons hérité de ce présidentialisme devenu un hyperprésidentialisme.
Le président concentre entre ses mains la quasi-totalité des pouvoirs alors que les contrepouvoirs ne fonctionnent pas comme ils devraient. En Afrique en général, et plus particulièrement au Sénégal, les pouvoirs politiques en place entravent méthodiquement la maturation et l’autonomisation des institutions censées les contrôler. On le voit dans l’immixtion de l’exécutif dans le judiciaire et le législatif, dans les suites réservées aux travaux des corps de contrôle. On le note aussi dans la tentative de s’arroger les prérogatives du Conseil constitutionnel, de l’attaquer, de le rendre vulnérable. Ce sont des procédés récurrents qui visent à affaiblir ce qui peut limiter l’absolu du pouvoir.
En 2012, Abdoulaye Wade avait brigué un troisième mandat après avoir lui-même introduit dans la Constitution la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels successifs. En juillet 2023, Macky Sall a renoncé à briguer un troisième mandat mais sa majorité parlementaire a interrompu brutalement le processus électoral sept mois plus tard, à trois semaines de l’échéance. Les présidents sénégalais ont-ils du mal à quitter la table ?
En 2001, déjà, Abdoulaye Wade avait fait voter une Constitution limitant à deux le nombre de mandats. En 2012, il décide de ne pas suivre les règles qu’il a lui-même établies. Six mois plus tôt, il avait tenté de faire voter une loi instituant un ticket présidentiel et suivant laquelle celui qui totaliserait 25 % des suffrages au premier tour remporterait la présidentielle. Les Sénégalais s’étaient mobilisés devant l’Assemblée nationale pour s’opposer au vote, le 23 juin 2011, de cette loi totalement antidémocratique. Manifestations et contestations s’étaient ensuivies, provoquant l’échec, dans les urnes en 2012, d’un président sortant qui avait voulu se présenter envers et contre tout. Il faut cependant lui reconnaître le mérite d’avoir accepté sa défaite et d’être parti sans histoires. En leur temps, les présidents Senghor et Diouf avaient eux aussi quitté le pouvoir sans difficulté et avec une certaine élégance.
Le président Macky Sall, lui, en 2016, a fait voter une révision constitutionnelle censée consolider l’interdiction de ne pas excéder deux mandats consécutifs, mais laisse ses partisans investir le débat public en théorisant un possible second quinquennat, un troisième mandat donc, pour lui, auquel il n’a renoncé que contraint et forcé par la pression populaire et internationale. Au fond, ce n’était pas son choix de ne pas effectuer un troisième mandat : personne dans son camp n’a été préparé pour assurer la relève, il a tardé à désigner comme candidat le Premier ministre Amadou Ba, contesté par certains dans son propre camp. Le camp présidentiel a voulu reporter ses problèmes internes sur toute la nation pour retarder le processus électoral et se donner de meilleures chances de l’emporter.
Diriez-vous s’agit-il d’une tentative de manipulation des institutions ?
Oui. C’est d’ailleurs ce qui révolte les Sénégalais dans leur ensemble – pas seulement dans leur grande majorité. Ceux qui doutaient encore des desseins antidémocratiques de Macky Sall s’en rendent bien compte désormais : il n’a jamais eu l’intention de respecter les institutions, de renoncer, de partir en paix. Seul lui importe de manœuvrer pour maintenir sa famille politique au pouvoir, sans tenir compte de la volonté des Sénégalais.
La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar semble désormais prête à sacrifier son candidat, le Premier ministre Amadou Ba, ouvertement accusé par le Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) de Karim Wade d’avoir été impliqué dans la corruption de deux membres du Conseil constitutionnel. À quel scénario faut-il s’attendre ?
Je ne sais à quel scénario l’on pourrait s’attendre, cependant il apparaît que la candidature d’Amadou Ba n’a pas réussi à faire l’unanimité dans son camp, c’est évident ; l’union sacrée autour de lui semble difficile à réaliser. Les siens l’ont fragilisé, le comble étant cette accusation de corruption du PDS, non étayée, mais que les députés de Benno Bokk Yakaar ont votée alors que le Premier ministre est nommément cité.
Le véritable problème, c’est la prise en otage du Sénégal dans des jeux de politique partisane sans grand intérêt pour la nation, dont les conséquences fragilisent les institutions et mettent en péril la démocratie. Les Sénégalais souhaitent que le processus reprenne, que les candidats retenus par la Cour constitutionnelle aillent aux élections, que le président Macky Sall quitte le pouvoir le 2 avril comme le prévoit la Constitution, et que le pays inaugure une nouvelle ère. J’espère qu’il nous laissera un pays gouvernable.
Après avoir assuré à plusieurs reprises que la réforme constitutionnelle de 2016 lui donnerait le droit de briguer un « second quinquennat », Macky Sall a répété le 3 février que « »[s]on engagement solennel à ne pas [s]e présenter à l’élection présidentielle rest[ait] inchangé ». Selon vous, les circonstances exceptionnelles que traverse le pays peuvent-elles changer la donne ?
Le président Sall a certes assuré qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, mais en précisant que la Constitution lui en donne le droit. Ce qui n’est pas le cas. La Constitution sénégalaise est claire sur ce point. Il a justifié son renoncement par la volonté de respecter non pas la Constitution, mais la parole donnée. En entendant cela, on ne pouvait s’empêcher de penser qu’il se réservait le droit, un jour, dans des circonstances qualifiées d’exceptionnelles, de représenter sa candidature et de se poser en garant de la stabilité dans un Sénégal en plein chaos. C’est pour cette raison que, malgré les répressions et les violences policières, les Sénégalais ont décidé de ne pas braver les interdictions de manifester, d’attendre patiemment le jour du vote, pour ne pas lui permettre de justifier un état d’exception.
La séquence de rebondissements à laquelle on assiste depuis la proclamation des candidatures, le 20 janvier, témoigne d’une alliance inattendue entre le PDS – qu’on croyait dans l’opposition – et la coalition présidentielle. Quel scénario ont-ils en tête, selon vous ?
Il s’agissait peut-être, selon certains observateurs, d’une alliance entre Macky Sall et Karim Wade dans la perspective d’un second tour. L’Alliance pour la République (APR, de Macky Sall) est née des flancs du PDS. Ils font partie tous les deux de la grande famille libérale dans laquelle s’est jouée une espèce de tragédie antique grecque. Fondamentalement, ils n’ont pas d’intérêts divergents. Le PDS a été un temps dévitalisé, puis son alliance avec la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, en 2022, l’a remis sur le devant de la scène.
À observer leur jeu, ce n’est pas la République qui les préoccupe, mais leurs intérêts partisans. On peut ne pas être d’accord avec les règles du jeu, mais une fois qu’on décide de se présenter au scrutin présidentiel, il faut s’assurer de remplir tous les critères. Un citoyen peut-il se permettre d’entraîner tout le pays dans une crise institutionnelle pour n’avoir pas scrupuleusement respecté les règles pour être candidat ?
Pensez-vous qu’il s’agissait de barrer la route au candidat désigné par les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), Bassirou Diomaye Faye, dont le Conseil constitutionnel a finalement validé la candidature et qui pourrait placer Amadou Ba en ballotage ?
Oui, le parti d’Ousmane Sonko représente la menace à l’origine de ce pacte. La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar et le PDS ont compris qu’ils pouvaient perdre. Malgré tous les mécanismes mis en place pour rendre l’élection non-inclusive, des représentants de l’opposition étaient parvenus à passer le filtre du Conseil constitutionnel. Ainsi, en dépit des entraves à la candidature d’Ousmane Sonko, le Pastef avait trouvé une option de rechange, Bassirou Diomaye Faye, qui s’était battu pour continuer d’exister, et les électeurs du premier auraient vraisemblablement reporté leurs voix sur le second.
En sondant l’état de l’opinion de manière organique dans les taxis, les lieux de manifestations, les chaumières par exemple, il est évident qu’une très large proportion de Sénégalais souhaite le changement souhaite le changement. La coalition présidentielle et le PDS ont donc voulu changer les règles du jeu pour être certains de l’emporter. Ce fut une tentative de confisquer la démocratie.
Quoi qu’il arrive, la démocratie sénégalaise ne sortira-t-elle pas durablement abîmée de cette crise ?
Les crises présentent aussi des avantages, notamment si on en tire des leçons. En tant que Sénégalais, j’espère profondément qu’en tant que corps social nous nous en sortirons le moins abîmés possible. La communauté sénégalaise vaincra, retrouvera sa souveraineté. Il restera cependant à affronter le temps d’après. Celui où l’on refonde les institutions en tirant toutes les leçons des vulnérabilités de nos dispositifs institutionnels, de nos pratiques politiques, de nos imaginaires du politique et de nos manières de nous gouverner. Une de nos multiples urgences sera de réformer l’hyperprésidentialisme et de ne plus octroyer autant de pouvoirs à un individu, notamment celui de faire basculer tout le corps social dans une aventure incertaine, sous le prétexte de la fonction présidentielle, qui est une fonction de service au bénéfice des citoyens.
Clarisse Juompan-Yakam
Source : Jeune Afrique - (Le 17 février 2024)
L’ACTU VUE PAR – C’était le 14 février au Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), à Marseille, lors du lancement du Labo Nord Europe de la Fondation de l’innovation pour la démocratie. On y débattait de la manière de réinventer la démocratie, de lui redonner du sens. Un projet bien à propos pour Felwine Sarr, qui est apparu ces derniers jours comme l’un des intellectuels sénégalais les plus en pointe dans le combat contre le report de l’élection présidentielle.
Dialoguant à distance avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, l’auteur d’Afrotopia et de Les lieux qu’habitent mes rêves, entre autres, se désole de voir son Sénégal natal, qui a pourtant connu la tenue d’élections régulières et deux alternances, en 2000 et 2012, expérimenter une « agression antidémocratique ». Comme dans cet entretien qu’il nous a accordé, il invite le pays à regarder en face, afin de les soigner au mieux, ces vulnérabilités qui l’exposent à un risque évident de régression. Interview.
Jeune Afrique : Le Conseil constitutionnel a annulé le report au 15 décembre de la présidentielle, voté par l’Assemblée nationale et à l’origine d’une grave crise politique au Sénégal. Comment accueillez-vous cette décision ? Quels sont les scénarios possibles pour la suite ?
Felwine Sarr : Nous en sommes particulièrement heureux, mais nous devons rester vigilants. Ce report est une victoire du Conseil constitutionnel, qui nous adresse ainsi un message clair : on peut réussir à stopper une dérive autoritaire si chacun prend ses responsabilités et si les citoyens se mobilisent. Le report au 15 décembre de l’élection présidentielle et la prolongation au pouvoir jusqu’à cette date du président Macky Sall étant déclarés inconstitutionnels, le mandat de ce dernier prendra fin le 2 avril prochain comme initialement prévu, et le processus électoral interrompu reprendra son cours.
Mais cela implique une réflexion sur le réaménagement de la période de campagne…
Évidemment. Faudra-t-il accorder trois semaines aux candidats pour faire campagne et repousser de quelques jours la date du scrutin ? Devront-ils, à l’inverse, s’accommoder d’une campagne plus courte ? Selon des juristes que j’ai pu interroger, le président devra convoquer rapidement le corps électoral. Le premier tour pourrait se dérouler avant le 10 mars, le second, deux semaines plus tard. Quant à la campagne électorale, elle pourrait démarrer assez rapidement. Dans tous les cas, il est souhaitable qu’en comptant le deuxième tour et le délai requis pour le contentieux électoral tout cela n’excède pas la date du 2 avril.
Après les turbulences de ces derniers jours, les Sénégalais sont-ils toujours prêts à aller aux urnes aussi rapidement ?
Le président Macky Sall a mis fin au processus électoral à dix heures de l’ouverture de la campagne officielle. Les citoyens sont prêts depuis plusieurs semaines déjà. Les équipes de campagne des candidats étaient dans les starting-blocks et une partie du matériel électoral était déjà parvenu dans certaines localités. Et il faut au moins reconnaître à l’administration territoriale sénégalaise une grande efficacité dans l’organisation des scrutins électoraux : il n’y a jamais eu de problème technique. Le débat porte davantage sur le temps de la campagne, certains estimant d’ailleurs que cette dernière n’est pas nécessaire puisque les citoyennes et des citoyens auraient déjà fait leur choix. On pourrait le dire : les Sénégalais ont eu, depuis 2021, trois ans de campagne…
Cette décision du Conseil constitutionnel n’est-elle pas un désaveu, non seulement pour Macky Sall, mais aussi pour les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, qui lui ont apporté leur soutien à travers une lettre ouverte qu’ils ont cosignée ?
Le président Abdou Diouf s’est quelque peu rattrapé avec une mise au point qu’il a rédigée dès le lendemain, seul cette fois, dans laquelle il exige le respect de la loi et de l’ordre constitutionnel. Dès lors, le stratagème politique du président Sall, mais aussi de Karim Wade et du PDS, a été désavoué par cette décision du Conseil constitutionnel.
Diriez-vous qu’il ne faut pas désespérer de la démocratie sénégalaise ?
Oui. Il y a eu une mobilisation extraordinaire. La société civile, les journalistes, les intellectuels, les citoyennes et les citoyens, les détenus politiques du fond de leur geôle… ont fait valoir des arguments politiques et surtout juridiques, démontrant ainsi qu’ils gardaient leur puissance d’agir, le fameux cratos du peuple, qu’ils ont les moyens de faire entendre leurs voix, et qu’il ne faut jamais abdiquer tant que les voies légales ne sont pas épuisées. Ce sont les masses qui font l’histoire ; déterminées, elles peuvent remporter des victoires sociétales et, ici en l’occurrence, démocratiques.
Dans l’une de vos interviews, vous invitiez toutes les forces vives du Sénégal à s’organiser et à agir afin d’obtenir la restauration du calendrier républicain. N’était-ce pas trop demander à un peuple qui a déjà payé un trop lourd tribut à cette lutte ?
On peut mener des combats intelligents, le premier étant d’abord juridique et institutionnel : des recours ont été déposés. Ces combats se livrent dans l’opinion. Il s’agit de transmettre la bonne information, de clarifier les arguments de droit, de lutter contre les obscurcissements voulus par les discours idéologiques. Les mobilisations citoyennes n’impliquent pas toujours un rapport de force frontal. Le peuple peut se dresser dans une résistance ferme, volontaire et obstinée contre ce qui est inacceptable ; une résistance fondée sur des principes de droit, de justice et d’équité.
Dans une tribune récente, cosignée avec une centaine d’universitaires, vous avez qualifié « l’annulation » de l’élection présidentielle de « bouquet final » d’un « plan de liquidation de la démocratie sénégalaise que le régime en place déploie depuis une douzaine d’années ». À quel plan faisiez-vous référence ?
Depuis plusieurs années, il est clair que le pouvoir actuel souhaite se maintenir en place en se jouant de la Constitution. Le président Macky Sall n’a jamais souhaité affronter ses vrais adversaires dans les urnes. En 2012, après l’ère Abdoulaye Wade, il y a eu dans le pays une réelle demande de redevabilité. Pour y répondre, lorsque Karim Wade a été soupçonné de détournement de deniers publics, la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) a été ressuscitée. Elle l’a condamné. Au bout de quelques années, le président Macky Sall l’a gracié et exilé au Qatar, car il le considérait comme un adversaire potentiel dans des élections à venir.
En 2017, même scénario : Khalifa Sall, maire de Dakar, a été accusé d’avoir détourné de l’argent d’une caisse d’avance de la mairie, a été emprisonné et écarté de l’élection présidentielle de 2019. Plus récemment, entre 2021 et 2023, les condamnations successives puis l’embastillement d’Ousmane Sonko ont conforté le peuple dans l’idée que, pour Macky Sall, faire de la politique consiste à éliminer de l’espace politique ses adversaires les plus redoutés. Par ailleurs, sous son magistère, différents procédés de fermeture de l’espace public et d’entrave à l’exercice des libertés sont hélas devenus familiers : interdiction des manifestations ; emprisonnement des activistes, des jeunes ou d’individus ayant une opinion dissidente ; multiplication d’actes visant à égratigner la démocratie sénégalaise, la contester, l’affaiblir ; amenuiser les contrepouvoirs. La dérive autoritariste de Macky Sall a culminé avec ce décret qui annule les élections et empêche les citoyens d’exprimer leur volonté à travers le suffrage universel.
Comment en est-on arrivé là ? Tout le problème n’est-il pas, au fond, celui de l’hyperprésidentialisme ?
C’est exactement cela. En 1962, alors que le Sénégal est encore un régime parlementaire, le pays connait une crise de bicéphalie, avec, au sommet de l’État, un président du Conseil tout-puissant, Mamadou Dia, et un président de la République aux pouvoirs limités, Léopold Sédar Senghor, qui s’opposent sur les options de politique économique. Dia est arrêté et emprisonné ; Senghor, lui, fait adopter une nouvelle Constitution instituant un régime semi-présidentiel fort pour pallier l’instabilité qui prévaut. Nous avons hérité de ce présidentialisme devenu un hyperprésidentialisme.
Le président concentre entre ses mains la quasi-totalité des pouvoirs alors que les contrepouvoirs ne fonctionnent pas comme ils devraient. En Afrique en général, et plus particulièrement au Sénégal, les pouvoirs politiques en place entravent méthodiquement la maturation et l’autonomisation des institutions censées les contrôler. On le voit dans l’immixtion de l’exécutif dans le judiciaire et le législatif, dans les suites réservées aux travaux des corps de contrôle. On le note aussi dans la tentative de s’arroger les prérogatives du Conseil constitutionnel, de l’attaquer, de le rendre vulnérable. Ce sont des procédés récurrents qui visent à affaiblir ce qui peut limiter l’absolu du pouvoir.
En 2012, Abdoulaye Wade avait brigué un troisième mandat après avoir lui-même introduit dans la Constitution la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels successifs. En juillet 2023, Macky Sall a renoncé à briguer un troisième mandat mais sa majorité parlementaire a interrompu brutalement le processus électoral sept mois plus tard, à trois semaines de l’échéance. Les présidents sénégalais ont-ils du mal à quitter la table ?
En 2001, déjà, Abdoulaye Wade avait fait voter une Constitution limitant à deux le nombre de mandats. En 2012, il décide de ne pas suivre les règles qu’il a lui-même établies. Six mois plus tôt, il avait tenté de faire voter une loi instituant un ticket présidentiel et suivant laquelle celui qui totaliserait 25 % des suffrages au premier tour remporterait la présidentielle. Les Sénégalais s’étaient mobilisés devant l’Assemblée nationale pour s’opposer au vote, le 23 juin 2011, de cette loi totalement antidémocratique. Manifestations et contestations s’étaient ensuivies, provoquant l’échec, dans les urnes en 2012, d’un président sortant qui avait voulu se présenter envers et contre tout. Il faut cependant lui reconnaître le mérite d’avoir accepté sa défaite et d’être parti sans histoires. En leur temps, les présidents Senghor et Diouf avaient eux aussi quitté le pouvoir sans difficulté et avec une certaine élégance.
Le président Macky Sall, lui, en 2016, a fait voter une révision constitutionnelle censée consolider l’interdiction de ne pas excéder deux mandats consécutifs, mais laisse ses partisans investir le débat public en théorisant un possible second quinquennat, un troisième mandat donc, pour lui, auquel il n’a renoncé que contraint et forcé par la pression populaire et internationale. Au fond, ce n’était pas son choix de ne pas effectuer un troisième mandat : personne dans son camp n’a été préparé pour assurer la relève, il a tardé à désigner comme candidat le Premier ministre Amadou Ba, contesté par certains dans son propre camp. Le camp présidentiel a voulu reporter ses problèmes internes sur toute la nation pour retarder le processus électoral et se donner de meilleures chances de l’emporter.
Diriez-vous s’agit-il d’une tentative de manipulation des institutions ?
Oui. C’est d’ailleurs ce qui révolte les Sénégalais dans leur ensemble – pas seulement dans leur grande majorité. Ceux qui doutaient encore des desseins antidémocratiques de Macky Sall s’en rendent bien compte désormais : il n’a jamais eu l’intention de respecter les institutions, de renoncer, de partir en paix. Seul lui importe de manœuvrer pour maintenir sa famille politique au pouvoir, sans tenir compte de la volonté des Sénégalais.
La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar semble désormais prête à sacrifier son candidat, le Premier ministre Amadou Ba, ouvertement accusé par le Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) de Karim Wade d’avoir été impliqué dans la corruption de deux membres du Conseil constitutionnel. À quel scénario faut-il s’attendre ?
Je ne sais à quel scénario l’on pourrait s’attendre, cependant il apparaît que la candidature d’Amadou Ba n’a pas réussi à faire l’unanimité dans son camp, c’est évident ; l’union sacrée autour de lui semble difficile à réaliser. Les siens l’ont fragilisé, le comble étant cette accusation de corruption du PDS, non étayée, mais que les députés de Benno Bokk Yakaar ont votée alors que le Premier ministre est nommément cité.
Le véritable problème, c’est la prise en otage du Sénégal dans des jeux de politique partisane sans grand intérêt pour la nation, dont les conséquences fragilisent les institutions et mettent en péril la démocratie. Les Sénégalais souhaitent que le processus reprenne, que les candidats retenus par la Cour constitutionnelle aillent aux élections, que le président Macky Sall quitte le pouvoir le 2 avril comme le prévoit la Constitution, et que le pays inaugure une nouvelle ère. J’espère qu’il nous laissera un pays gouvernable.
Après avoir assuré à plusieurs reprises que la réforme constitutionnelle de 2016 lui donnerait le droit de briguer un « second quinquennat », Macky Sall a répété le 3 février que « »[s]on engagement solennel à ne pas [s]e présenter à l’élection présidentielle rest[ait] inchangé ». Selon vous, les circonstances exceptionnelles que traverse le pays peuvent-elles changer la donne ?
Le président Sall a certes assuré qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, mais en précisant que la Constitution lui en donne le droit. Ce qui n’est pas le cas. La Constitution sénégalaise est claire sur ce point. Il a justifié son renoncement par la volonté de respecter non pas la Constitution, mais la parole donnée. En entendant cela, on ne pouvait s’empêcher de penser qu’il se réservait le droit, un jour, dans des circonstances qualifiées d’exceptionnelles, de représenter sa candidature et de se poser en garant de la stabilité dans un Sénégal en plein chaos. C’est pour cette raison que, malgré les répressions et les violences policières, les Sénégalais ont décidé de ne pas braver les interdictions de manifester, d’attendre patiemment le jour du vote, pour ne pas lui permettre de justifier un état d’exception.
La séquence de rebondissements à laquelle on assiste depuis la proclamation des candidatures, le 20 janvier, témoigne d’une alliance inattendue entre le PDS – qu’on croyait dans l’opposition – et la coalition présidentielle. Quel scénario ont-ils en tête, selon vous ?
Il s’agissait peut-être, selon certains observateurs, d’une alliance entre Macky Sall et Karim Wade dans la perspective d’un second tour. L’Alliance pour la République (APR, de Macky Sall) est née des flancs du PDS. Ils font partie tous les deux de la grande famille libérale dans laquelle s’est jouée une espèce de tragédie antique grecque. Fondamentalement, ils n’ont pas d’intérêts divergents. Le PDS a été un temps dévitalisé, puis son alliance avec la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, en 2022, l’a remis sur le devant de la scène.
À observer leur jeu, ce n’est pas la République qui les préoccupe, mais leurs intérêts partisans. On peut ne pas être d’accord avec les règles du jeu, mais une fois qu’on décide de se présenter au scrutin présidentiel, il faut s’assurer de remplir tous les critères. Un citoyen peut-il se permettre d’entraîner tout le pays dans une crise institutionnelle pour n’avoir pas scrupuleusement respecté les règles pour être candidat ?
Pensez-vous qu’il s’agissait de barrer la route au candidat désigné par les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), Bassirou Diomaye Faye, dont le Conseil constitutionnel a finalement validé la candidature et qui pourrait placer Amadou Ba en ballotage ?
Oui, le parti d’Ousmane Sonko représente la menace à l’origine de ce pacte. La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar et le PDS ont compris qu’ils pouvaient perdre. Malgré tous les mécanismes mis en place pour rendre l’élection non-inclusive, des représentants de l’opposition étaient parvenus à passer le filtre du Conseil constitutionnel. Ainsi, en dépit des entraves à la candidature d’Ousmane Sonko, le Pastef avait trouvé une option de rechange, Bassirou Diomaye Faye, qui s’était battu pour continuer d’exister, et les électeurs du premier auraient vraisemblablement reporté leurs voix sur le second.
En sondant l’état de l’opinion de manière organique dans les taxis, les lieux de manifestations, les chaumières par exemple, il est évident qu’une très large proportion de Sénégalais souhaite le changement souhaite le changement. La coalition présidentielle et le PDS ont donc voulu changer les règles du jeu pour être certains de l’emporter. Ce fut une tentative de confisquer la démocratie.
Quoi qu’il arrive, la démocratie sénégalaise ne sortira-t-elle pas durablement abîmée de cette crise ?
Les crises présentent aussi des avantages, notamment si on en tire des leçons. En tant que Sénégalais, j’espère profondément qu’en tant que corps social nous nous en sortirons le moins abîmés possible. La communauté sénégalaise vaincra, retrouvera sa souveraineté. Il restera cependant à affronter le temps d’après. Celui où l’on refonde les institutions en tirant toutes les leçons des vulnérabilités de nos dispositifs institutionnels, de nos pratiques politiques, de nos imaginaires du politique et de nos manières de nous gouverner. Une de nos multiples urgences sera de réformer l’hyperprésidentialisme et de ne plus octroyer autant de pouvoirs à un individu, notamment celui de faire basculer tout le corps social dans une aventure incertaine, sous le prétexte de la fonction présidentielle, qui est une fonction de service au bénéfice des citoyens.
Clarisse Juompan-Yakam
Source : Jeune Afrique - (Le 17 février 2024)
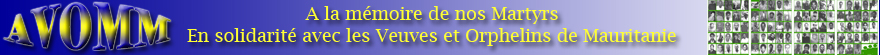
 Actualités
Actualités





















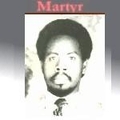
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)