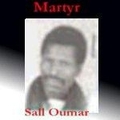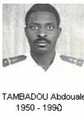Malgré la relativité de notre silence, on finit par entendre, sur notre droite, le chant d’un coq. Aussitôt, la troupe se mit en branle dans sa direction et l’on trouva, à moins d’une centaine de mètres, un village dont les habitants s’empressèrent de nous apprendre le nom, Siwré, et de nous balayer l’école, pour nous y accueillir.
C’était comme des retrouvailles d’une même famille longtemps séparée. Ces braves gens se plièrent en quatre pour nous fournir à manger, à boire et, même, à nous vêtir et chausser car beaucoup d’entre nous, dépouillés de tout par les gendarmes maures, allaient quasiment nus, de la tête aux pieds. C’était une vraie « teranga » et j’ai gardé, de cet accueil qui dura quelques semaines, le plus chaleureux des souvenirs, bien que nous fussions accablés par le nombre de nos morts. Les gens tombaient, comme des mouches. Un mal peut-être contracté lors de notre cloître au dépôt d’ordures de Kiffa. Maintenant, la faim et la soif étaient parties mais tant de personnes chères disparaissaient qu’on ne les pleurait plus. Chaque mort était comme une décharge des vivants.
Un marabout à notre secours
Un marabout [érudit musulman], Thierno Hamdou Rabby NDiath – Qu’Allah l’accueille en son saint Paradis ! – vint à notre secours. Il nous déplaça chez lui, à Médina N’Diathbé. Les premiers venus, dont faisait partie ma famille, furent logés dans sa propre demeure. Quant au dernier convoi, il s’installa dans une zone aménagée en site d’asile. Ce fut le marabout lui-même qui établit les contacts entre les réfugiés, les autorités sénégalaises, le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et les Organisations Non Gouvernementales (ONG). Certaines familles comme la nôtre manifestèrent le désir de retrouver des parents déjà expulsés et installés dans le département de Bakel, région de Tambacounda, et ce fut encore le marabout qui se chargea de notre déplacement.
À Bakel, les familles, originaires de différents lieux de Mauritanie, étaient regroupées dans un camp appelé Boussourga, à deux kilomètres, environ, de la ville et autant de la SAED, une société agricole. C’est là que j’ai commencé, en 1990, mon cursus scolaire. Il n’y avait qu’une seule classe, la « CI », enseignée par un certain monsieur N’Diaye. Mais le camp occupait une zone cultivable dont les habitants de Bakel revendiquèrent l’exploitation, quelques mois après notre arrivée, et il fallut, à nouveau, nous déplacer. On nous installa à Samba Niamé, du nom de son chef de village, à dix-huit kilomètres au sud de Bakel. Ce campement existe toujours. Aujourd’hui, il est habité par d’anciens réfugiés mauritaniens sénégalisés et des populations autochtones.
Nous fûmes très biens accueillis à Samba Niamé. Les gens des environs nous offrirent vêtements et nourriture. Et l’implantation, non loin de nous, de nombreux autres camps de réfugiés, comme Ouro Thierno ou Samba Yidé, contribuaient à adoucir notre dépaysement. J’ai effectué, à Samba Niamé, trois années d’école, du CP2 au CE2. Notre enseignant se nommait Tallatou Ba. C’était l’ami de tout le monde. Il octroyait même des fournitures et des tenues à ses élèves. Tout provenait de l’UNHCR et des ONG et nous ne manquions de rien. C’était la belle vie. Les vivres arrivaient de partout, même des moutons égorgés en Arabie Saoudite. Missions de l’UNHCR et des ONG de développement et de droits humains se succédaient, veillant à nous assurer toutes les garanties : alimentaire, sanitaire, vestimentaire, etc.
Un récépissé de demande de carte d’identité nous fut octroyé, nous permettant de circuler au Sénégal. Quelques mois plus tard, une mini-carte d’identité de réfugiés commença à être distribuée dans certains sites, mais cette opération fut plus tard suspendue, sans qu’on sût pourquoi. D’autres interruptions inopinées affectèrent plus gravement notre quotidien. En 1994, il y eut, ainsi, rupture totale de l’assistance de l’UNHCR et des ONG. La belle vie prit fin et ce fut le retour de la famine et des épidémies.
Un ‘’Haco’’spécial
Je me souviens que, durant plusieurs jours, on ne mangea plus que du « Haco » (sauce à base d’une herbe qui pousse après la pluie, qu’on augmente, à l’ordinaire, d’arachides et de divers autres ingrédients, pour assaisonner le couscous). Mais quel « Haco » ! Le nôtre n’était qu’eau et sel. C’est alors que les réfugiés commencèrent à cultiver. Je gardais les champs avec mes frères. Désertant, par la force des choses, l’école, nous quittions la maison dès l’aube, pour ne rentrer qu’à dix-huit ou dix-neuf heures. Et ce n’était pas la ration de haco saumâtre que nous amenaient nos sœurs qui pouvait nous réjouir ! A tel point, d’ailleurs, que ce plat y perdit les délices qu’il avait, naguère, pour moi.
Avec la suspension des aides, choléra, paludisme, tuberculose et bilharziose firent des ravages et, quoique l’assistance de l’UNHCR finît par revenir mais plus aussi fournie et régulière qu’avant, ma famille décida de quitter le camp pour aller s’installer à Bakel. Nous nous installâmes au quartier des Habitats à loyer modéré (HLM), dans des bâtiments inachevés. Nos mamans et sœurs se firent engager comme domestiques et nos grands frères se lancèrent dans le commerce ambulant ou suivirent des formations professionnelles. Les plus petits et moi, nous intégrâmes le système éducatif sénégalais, à l’école publique Amady Warankha N’Diaye de Bakel, où je réussis, en 1995, mon examen d’entrée en sixième.
Inscrit au collège/lycée Waoundé Ndiaye de Bakel, j’y ai rencontré un professeur chrétien, Benjamin Sambou, qui s’occupa bien de moi, jusqu’à m’offrir des fournitures. Mais c’est surtout grâce à ma mère, toujours à laver le linge des gens pour financer mes études, que j’ai pu, en 2004, obtenir mon bac, louange à Dieu. Quand je n’allais pas à l’école, je partais l’aider au fleuve où elle usait ses mains et son dos, toute la journée, ou gardais mes petits frères et sœurs, ainsi que les fils de mon oncle paternel. Pendant les vacances, j’allais aux champs et, parfois, j’arrivais à trouver quelque travail rémunéré dont j’économisais les revenus, pour l’année scolaire à venir.
C’est vrai : j’ai passé beaucoup de mon enfance à soutenir ma maman. Outre divers travaux domestiques rémunérés, j’allais, le week-end, chercher du bois, avec les jeunes filles qui venaient, de temps en temps, épauler ma mère. Mes sœurs étaient petites. L’aînée est née en 1989, quelques jours avant l’expulsion. Elle a tant subi le fardeau des évènements qu’on l’a surnommée « rescapée de 1989 », pour la taquiner.
(A suivre).
Samba Sow
Source: le calame
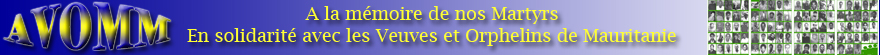
 Actualités
Actualités



















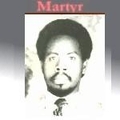
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)