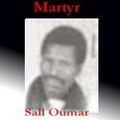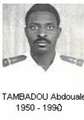Septembre II : Après la pluie, c’est le mbookho
«En tout cas la situation est tellement grave à Nouakchott, que nous n'avons pas du cœur à la littérature.» (sammbasy, sur cridem).
«Je vis en pleine campagne dans la brousse au milieu des vaches sur des paysages enherbés où le sol reste encore très propre.» (sybasarr, sur cridem).
Il a plu encore à la tombée de la nuit, et cette fois-ci les nuages étaient très sérieux.
Je disais dans le premier feuillet que la maxime toubabe « Après la pluie, c’est le beau temps » n’a aucun sens en temps de Yiiwoonde chez nous. En fait, dès que les nuages chargés de gouttes finissent leurs pleurs, bonjour l’infect. Cette situation me rappelle cette maxime pulaar qui enseigne : « sooyni yiiwonde mujji kuudi ». Eh bien, la personne qui pense recourir à ce parapluie, risque fort de demeurer dans l’infect si les nuages ne fécondent de rien. Quel dégout !
En effet, le peu d’égouts que nous avons dans nos villes se bouchent et leur couvercle s’entrouvre laissant s’échapper toute cette production stockée dans nos toilettes. Ouf, comme un soulagement! Mais l’air devient irrespirable et l’atmosphère insupportable. Éternuements et toux nous gagnent. Même le chemin de la pharmacie ne nous débouchera pas le nez.
Eh bien les rues sans asphalte, elles, deviennent des patinoires et gare aux petits vieux, aux lunettes [« Made in China »], de vues usées, qui se hasardent dehors. Ils se retrouvent immobilisés dans un lit d’hôpital, le pied fourré dans un plâtre et suspendu à une barre d’acier. La bouteille de perfusion, elle, goutte tranquillement. Le liquide suinte fièrement pour réalimenter un corps rachitique. Là une infirmière ne cessera de répéter à l’oreille dure du malade : « Grand-père, ne marchez jamais après la pluie sous nos cieux. C’est un sale temps à impérativement éviter pour votre âge. » Toutes ces paroles sont prononcées sur un ton de pitié à rendre le petit fils, assis sur la couverture rouge, taciturne.
Les sachets accrochés aux arbres de nos allées déversent sur nous leur eau fraîche, comme une vieille pisse de chauve-souris. C’est toujours en sursautant qu’on bouscule, involontairement, un passant. La discussion s’ouvre à frôler la dispute voire la bagarre. Dès lors, tout boubou blanc se met à douter de sa vraie couleur en fin de journée.
Nous sommes en ville et dans tout ce qu’elle a de « vil » (?)
Toutes les carcasses tombent en panne au milieu de la chaussée pour cause de noyades de bougies. Makhalla, elles sont de seconde ou de quadruple main ! Celles qui roulent, laissent s’échapper une fumée noire suffocante à cause du dégré d’humidité. Et les policiers [es salauds, ce n’est pas l’auteur qui qualifie, c’est l’opinion générale qui classe] s’en frottent les mains, car personne n’a le temps d’aller devant l’ordre et la discipline toujours absents de l’espace public.
Les poubelles des coins de rues remplies de grosses mouches noires laissent déborder des épluchures de mangues, de bananes, des blocs entiers d’al aïch, une carcasse de tête de mouton avec quelques poils noirs et blancs, une fine tête de yabooy, un kaagni rouge, un khoulougné entier avec un peu de riz à la sauce tomate parsemé de mégots de l’antique Camélia. Et tout ce tas, se retrouve au bord d’une flaque d’eau à la surface de laquelle flotte une épaisse couche de diwliin. On n’a qu’une seule envie : dégueuler comme une jeune femme enceinte d’à peine un mois. Je présume que c’est là l’une des figures les plus sales auxquelles conduit l’étouffement.
La philosophie du mbookho est concentrée dans cette image d’immondices que seule la pluie a le secret de photographier pour nous. Regardez le tableau social ainsi décrit et vous verrez qu’au-delà de l’allure « littéraire », il figure la tristesse et dépeint subtilement notre inconséquence en ville.
Finalement, j’ai envie de dire que chez nous, la pluie n’a de sens que sur un champ qui féconde le doux et fermentant niébé que tous mes cousins, hautains de leur liberté, sèment et récoltent à tout vent, leur vie durant.
PS : Partout, dans les capitales africaines [donc je reste dans l’espace strictement urbain pour rejeter la maxime toubabe], nous vivons sous les eaux et les plus sales d'entre elles. Tout ceci est la conséquence de dysfonctionnements structurels que je dénonce avec ma propre esthétique nak. Littérature ou pas, il s’agit d’un sujet préoccupant pour tous les acteurs.
Abdarahmane NGAIDE (Bassel), le 08/09/2013
Source: A. NGAIDE
«En tout cas la situation est tellement grave à Nouakchott, que nous n'avons pas du cœur à la littérature.» (sammbasy, sur cridem).
«Je vis en pleine campagne dans la brousse au milieu des vaches sur des paysages enherbés où le sol reste encore très propre.» (sybasarr, sur cridem).
Il a plu encore à la tombée de la nuit, et cette fois-ci les nuages étaient très sérieux.
Je disais dans le premier feuillet que la maxime toubabe « Après la pluie, c’est le beau temps » n’a aucun sens en temps de Yiiwoonde chez nous. En fait, dès que les nuages chargés de gouttes finissent leurs pleurs, bonjour l’infect. Cette situation me rappelle cette maxime pulaar qui enseigne : « sooyni yiiwonde mujji kuudi ». Eh bien, la personne qui pense recourir à ce parapluie, risque fort de demeurer dans l’infect si les nuages ne fécondent de rien. Quel dégout !
En effet, le peu d’égouts que nous avons dans nos villes se bouchent et leur couvercle s’entrouvre laissant s’échapper toute cette production stockée dans nos toilettes. Ouf, comme un soulagement! Mais l’air devient irrespirable et l’atmosphère insupportable. Éternuements et toux nous gagnent. Même le chemin de la pharmacie ne nous débouchera pas le nez.
Eh bien les rues sans asphalte, elles, deviennent des patinoires et gare aux petits vieux, aux lunettes [« Made in China »], de vues usées, qui se hasardent dehors. Ils se retrouvent immobilisés dans un lit d’hôpital, le pied fourré dans un plâtre et suspendu à une barre d’acier. La bouteille de perfusion, elle, goutte tranquillement. Le liquide suinte fièrement pour réalimenter un corps rachitique. Là une infirmière ne cessera de répéter à l’oreille dure du malade : « Grand-père, ne marchez jamais après la pluie sous nos cieux. C’est un sale temps à impérativement éviter pour votre âge. » Toutes ces paroles sont prononcées sur un ton de pitié à rendre le petit fils, assis sur la couverture rouge, taciturne.
Les sachets accrochés aux arbres de nos allées déversent sur nous leur eau fraîche, comme une vieille pisse de chauve-souris. C’est toujours en sursautant qu’on bouscule, involontairement, un passant. La discussion s’ouvre à frôler la dispute voire la bagarre. Dès lors, tout boubou blanc se met à douter de sa vraie couleur en fin de journée.
Nous sommes en ville et dans tout ce qu’elle a de « vil » (?)
Toutes les carcasses tombent en panne au milieu de la chaussée pour cause de noyades de bougies. Makhalla, elles sont de seconde ou de quadruple main ! Celles qui roulent, laissent s’échapper une fumée noire suffocante à cause du dégré d’humidité. Et les policiers [es salauds, ce n’est pas l’auteur qui qualifie, c’est l’opinion générale qui classe] s’en frottent les mains, car personne n’a le temps d’aller devant l’ordre et la discipline toujours absents de l’espace public.
Les poubelles des coins de rues remplies de grosses mouches noires laissent déborder des épluchures de mangues, de bananes, des blocs entiers d’al aïch, une carcasse de tête de mouton avec quelques poils noirs et blancs, une fine tête de yabooy, un kaagni rouge, un khoulougné entier avec un peu de riz à la sauce tomate parsemé de mégots de l’antique Camélia. Et tout ce tas, se retrouve au bord d’une flaque d’eau à la surface de laquelle flotte une épaisse couche de diwliin. On n’a qu’une seule envie : dégueuler comme une jeune femme enceinte d’à peine un mois. Je présume que c’est là l’une des figures les plus sales auxquelles conduit l’étouffement.
La philosophie du mbookho est concentrée dans cette image d’immondices que seule la pluie a le secret de photographier pour nous. Regardez le tableau social ainsi décrit et vous verrez qu’au-delà de l’allure « littéraire », il figure la tristesse et dépeint subtilement notre inconséquence en ville.
Finalement, j’ai envie de dire que chez nous, la pluie n’a de sens que sur un champ qui féconde le doux et fermentant niébé que tous mes cousins, hautains de leur liberté, sèment et récoltent à tout vent, leur vie durant.
PS : Partout, dans les capitales africaines [donc je reste dans l’espace strictement urbain pour rejeter la maxime toubabe], nous vivons sous les eaux et les plus sales d'entre elles. Tout ceci est la conséquence de dysfonctionnements structurels que je dénonce avec ma propre esthétique nak. Littérature ou pas, il s’agit d’un sujet préoccupant pour tous les acteurs.
Abdarahmane NGAIDE (Bassel), le 08/09/2013
Source: A. NGAIDE
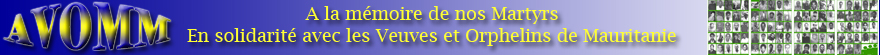
 Actualités
Actualités



















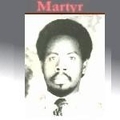
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)