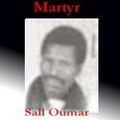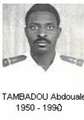En 2002, alors en classe de première, il y eut un total changement de ma situation, bouleversant mes idées. Cela commença par une déclaration solennelle de ma mère : « Tu dois te marier ; tous tes amis le sont ». Par-dessus le marché, elle me privait de tout choix. « De son vivant, ton père », m’informa-t-elle, « avait déjà choisi ta future épouse : ce sera la fille de ta tante paternelle ». Je ne l’avais jamais vue mais j’en avais beaucoup entendu parler car la famille ne cessait de me taquiner à son sujet. A l’époque, je fréquentais des filles qui me plaisaient beaucoup et à qui je plaisais bien, en retour. Mais, bon, j’étais obligé de céder à ma mère, la rendre heureuse, honorer et exécuter le projet de mon défunt papa.
Et puis, il y avait la crainte de déshonorer ma tante : un éventuel refus pourrait être interprété comme un désamour de la descendance de la petite sœur de mon père. Ma tante était pressée de voir sa fille mariée. Elle n’arrêtait de le rappeler à ma mère. « Ma fille est majeure », lui répétait-elle, « tu dois venir la chercher, si tu veux réellement d’elle comme belle-fille ». Bref, mon consentement ne fut qu’une formalité. Celui-ci aussitôt énoncé, ma mère et mon oncle paternel entreprirent le voyage au Mali où résidait ma promise avec sa mère.
Quelque temps plus tard, alors que je bavardais, de nuit, avec mes amis et copines, je vis arriver mes petits frères et sœurs. « Que venez-vous faire ici ? », les questionnais-je. Pas de réponse mais de grands sourires joyeux. Intrigué, j’allais réitérer ma question, quand je vis une des petites se pencher à l’oreille d’une copine, pour lui chuchoter : « la femme de Samba est arrivée ! ». Cris et exclamations. En un clin d’œil, voilà toutes mes amies se précipitant vers la demeure de ma mère, tandis que mes amis, tous déjà mariés, me manifestaient, déjà, leur contentement. J’avais assisté à chacun de leur mariage, j’avais, donc, une dette envers eux et l’heure était venue, me disaient-ils, de la rembourser.
Une ‘’étrangère’’ pour épouse
Tout le monde était heureux mais, moi, je me sentais abattu et affaibli. Je ne pouvais même pas me tenir debout. Mes demi-grandes « sœurs » – les filles du second époux de ma mère – vinrent nous informer que ma mère, mon oncle et « l’étrangère » s’étaient arrêtés devant notre maison et qu’il me fallait rejoindre, dare-dare, le bercail car ma fiancée devait me trouver à demeure. Mes amis me soulevèrent littéralement, pour m’aider à honorer ce rite traditionnel. Une fois rentré chez moi par une entrée annexe, il me fallut fournir tous les efforts du monde pour masquer ma faiblesse et aller saluer « l’étrangère ». Il y avait un monde fou et tous voulaient me voir alors que, moi, j’aurais voulu ne voir personne…
Le lendemain, mon grand frère expliqua que nous devions entreprendre un voyage pour avertir les parents. Mes amis partirent chercher chevaux et charrettes. Et nous partîmes en grand cortège, amis, sœurs et cousines voulant, tous, m’accompagner en ce traditionnel périple. Nous séjournâmes en un certain nombre de villes et villages, comme Gourel Hayré, Guéthié, Gabou, Samba Niamé, Samba Yidé, Alhinna, Bordé, Cannda, Carrefour… Nous fûmes, partout, très bien accueillis.
Chaque famille parente se débrouillait à égorger, qui une chèvre, qui un mouton, pour nous. Chacune étant tenue de contribuer au mariage, certains nous donnaient de l’argent, d’autres une vache ou un mouton ou une chèvre… C’était un de mes amis, Diao Djenngoundi Aly, qui était chargé de récupérer les contributions en monnaie, or ou argent. Il était aveugle, sa situation me touchait vraiment beaucoup et ce sentiment me l’avait rendu très intime. Actuellement, il vit à Samba Niamé et attend la reprise des opérations de rapatriement.
Certains parents donnaient des gris-gris, en guise de soutien. J’étais très gêné de cette obligation publique qui occasionnait, parfois, de la honte, lisible sur les visages de ceux qui ne pouvaient contribuer que peu ou prou, en ces temps difficiles. Mais j’étais obligé, moi aussi, de me rendre auprès d’eux, pour les informer du mariage. En fait, contribuer n’est qu’un devoir moral, qui peut se suffire de simples et sincères prières. Cependant, c’était, à l’époque, comme un défi à la situation de déportés que de s’efforcer à matérialiser ce devoir et ceux qui ne le pouvaient pas en souffraient.
Les parents nous retinrent tant et tant que nous faillîmes retarder le jour convenu pour le mariage. Enfin rentrés à Bakel, nous trouvâmes les gens déjà réunis. C’était le soir, il y avait beaucoup de monde. On battait le tam-tam. On dansait. Il y avait des griots ou wammbabé, des awloubé, des potiers ou maboubé, des forgerons ou wayloubé… Chacun d’eux devait recevoir une part des dons, en argent ou en bétail. Ce qui fut fait, bien dans les règles, et tout le monde fut content.
C’était la première nuit du mariage qui devait, comme il se doit, durer trois jours. Il y avait tant et tant de gens qu’on n’arrivait même plus à retrouver les membres de notre famille. Chaque jour, ma mère venait nous saluer. Je recevais aussi, à tout bout de champ, la visite de mes petits frères et sœurs qui ressentaient ma nostalgie. Mais le bonheur de tant de personnes me donnait du courage. On n’arrêtait pas de venir me féliciter et m’encourager. Je passais la nuit, dans ma chambre, avec mon épouse, bien sûr, mais, aussi, avec N’Djenngoundi et d’autres cousines d’une autre lignée, comme c’est la coutume.
De l’anglais au Droit
Puis vint le troisième jour, celui du linge qui annonce la fin du mariage. Nous partîmes, moi, ma femme et les femmes, au fleuve. Chacun de mes amis avait amené sa radio et ses cassettes. Thiambel Guéga, Adoubal Samba et Baba Maal étaient nos chanteurs préférés. La foule s’arrêtait, au moindre prétexte, on battait le tam-tam, on obligeait mes sœurs et amis à danser, sinon, c’était à moi de m’exécuter. Arrivés au fleuve, mes amis égorgèrent un bélier pour le repas, on passa une très agréable après-midi puis nous rentrâmes à la maison pour le crépuscule. Tout le monde s’en revint chez soi, ce soir-là, sauf mes amis et les deux dernières cousines qui nous tenaient compagnie dans notre chambre. Les autres nous avaient quittés la veille.
Malgré la précarité de notre situation, mon mariage s’était bien passé. J’avais reçu beaucoup de soutiens et en tout genre. Les invités avaient pu manger à leur faim, boire thé et « toufam » (zrig) à leur guise. Tout monde était reparti joyeux. Quant à moi, c’était le début d’un vrai et profond bouleversement. J’étais inquiet. Je me demandais si et comment j’allais pouvoir garder mon épouse. J’avais repris la classe mais de nouvelles pensées inondaient mon cerveau, en pleine révision de leçon. Je me demandais si je ne devais pas abandonner les études, pour aller gagner ma vie et celle de ma femme.
Tout au long de ma Terminale, il m’arriva de m’endormir en classe. Professeurs et collègues se moquaient de moi. Heureusement, j’avais le soutien moral de la famille. Et c’est beaucoup grâce à elle que j’ai décidé de poursuivre mes études, malgré leur durée probable. En 2004, je décrochais le Baccalauréat, second de mon centre d’examen. On me récompensa de prix et cela m’a, également, beaucoup réconforté. Mais, tout d’abord orienté vers l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, section d’anglais, je n’y trouvai ni bourse ni tuteur. Aussi me tournai-je vers le département des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Malheureusement, il me fut impossible de m’acquitter, cette année-là, des frais d’inscription, qui s’élevaient à 150 000 FCFA. 2005 fut donc une année blanche, pour moi, bien que reconnu second meilleur élève de la région. Il me fallut quelque temps pour comprendre pleinement les raisons de cette étrange situation.
(A suivre)
Samba Sow
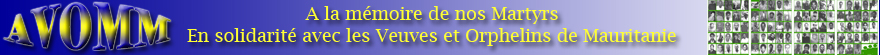
 Actualités
Actualités



















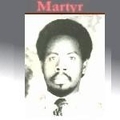
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)