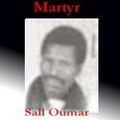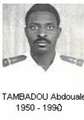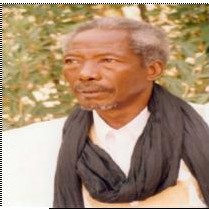
A cette époque l’état civil était presque inconnu dans le pays et plus particulièrement dans les zones de brousse, souvent éloignées des centres administratifs coloniaux.
Je suis né de parents Haratines, c’est-à-dire de parents Noirs ( sûrement d’origine négro-africaine ), devenus esclaves des Arabo-berbères de race blanche ( communément appelés bidhanes ), auxquels ils ont été totalement assimilés du point de vue de la langue (le hassania – arabe dialectal), du mode de vie (nomade), de la culture et de la civilisation (avec, toutefois, certaines nuances tout à fait caractéristiques de leur très lointaines origines dont ils n’ont jamais plus gardé, dans leur écrasante majorité aucun souvenir). Je suis membre de la petite collectivité maraboutique dite AHEL TALEB ETHMANE , aujourd’hui encore recensée dans le département central de Néma.
Les rapports de mes parents avec leurs maîtres étaient des plus ambigus : statutairement esclaves, mes parents n’étaient cependant pas attachés directement à leurs maîtres et vivaient en totale autonomie par rapport à eux. Comme tous les Haratines de l’époque (et même aujourd’hui), ils vivaient d’agriculture (cultures fluviales de l’oued Fara el Kitane, justement), d’élevage et de cueillette. Mon père pratiquait aussi la chasse à courre et à la trappe. Ma famille n’était pas assez grande et était plutôt assez bien lotie : elle possédait une tente noire en laine de mouton, du mobilier traditionnel standard de l’époque, quelques têtes de chèvres et de moutons, des animaux de bât (surtout des ânes.) Elle était composée, outre le père et la mère, d’une sœur utérine, l’aîné des enfants et de trois frères germains dont je suis le deuxième.
Il y avait, en outre, mes deux grands-mères (maternelle et paternelle) un oncle maternel (plus âgé que ma mère) et une tante paternelle (plus jeune que mon père), qui constituaient la structure de ma grande famille.
Les péripéties de mon entrée à l’école française
Mon souvenir le plus lointain remonte à cette matinée de fin septembre ou début octobre 1950 où, alors que je me trouvais en compagnie de mon frère aîné au milieu de notre troupeau de chèvres et de moutons, je fus surpris de l’entendre presque crier ces mots , d’une voix pleurnicharde:
A peine avais-je eu le temps de me retourner, que je me vis arraché du sol par mon ravisseur, lequel, en quelques pas, poussé par le deuxième ravisseur resté sur la selle, partit en grandes foulées au milieu de mes pleurs et de mes cris ainsi que ceux de mon, frère. Ce dernier nous avait poursuivis, autant que le lui permettait son handicap inhérent à des séquelles de syphilis et le terrain particulièrement rocailleux parce que collinaire ; cependant, je ne pouvais pas l’apercevoir, masqué que j’étais par mon ravisseur qui bouchait mon horizon à l’arrière. Nos pleurs et nos cris se répercutèrent longtemps dans la vallée…
Plus tard, je devais apprendre mes ravisseurs n’avaient été perçus par personne d’autre que nous, malgré la proximité de notre campement, à peine distant de deux kilomètres. L’alerte avait été donnée par mon frère, longtemps après qu’il se soit exténué à nous poursuivre.
Notre seule consolation, mon frère et moi, si consolation ce jour là il pouvait y avoir, était que les ravisseurs étaient des membres de la collectivité et non des inconnus. Pour ma part, je n’avais aucune idée des raisons et des objectifs de mon enlèvement.
Ce fut sous la tente du chef de la collectivité, alors que son épouse s’acharnait vainement à me consoler en me tenant dans les bras, que j’entendis parler, pour la première fois, de l’école à laquelle on semblait apparemment me destiner.
Le lendemain matin, je fus rejoint à Néma, où j’étais arrivé l’après-midi de la journée de mon enlèvement par mère.
Elle engagea aussitôt une très vive dispute avec le chef et sa djemaa de bidhanes. Il fut beaucoup question d’école, là aussi, du refus catégorique de ma mère de m’y laisser inscrire. Ce fut grâce à l’intervention de la logeuse du chef (une habitante de Néma, qui connaissait donc la réalité de l’école) que ma mère se décida finalement à accepter de me conduire elle-même, entourée du chef et de sa délégation, auprès du directeur d’école, feu Samba DIALLO ( un malien ) pour mon inscription. Son espoir, avait-elle dit, était que
C’est ainsi que je fus le premier ressortissant de cette collectivité à être admis à l’école des blancs, l’école des français ; à l’époque, l’école était surtout réputée pour être celle des fils de chefs en particulier, de l’aristocratie en général. Si l’objectif déclaré de la puissance coloniale était de se doter de futurs auxiliaires et collaborateurs du terroir, la réalité inavouée était que ces écoles servaient surtout à masquer le recours honteux au système des otages.
Les chefs les plus turbulents et les plus récalcitrants étaient ainsi soumis au chantage exercé, sur eux, à travers leurs fils laissés en gage d’allégeance aux mains des « infidèles ».
Pourquoi moi et pas un autre… ?
L’école française était très mal perçue en milieu maure, où elle était assimilée à l’école religieuse catholique. C’est pourquoi, certaines familles maraboutiques, plutôt que d’y envoyer leurs propres fils, préféraient leur substituer des esclaves, ce qui, à leurs yeux, était tout à fait moral et normal. C’est ce qui explique, en partie au moins, le dévolu porté sur moi, ou plus exactement sur ma famille, car c’est elle que l’on voulait atteindre à travers moi.
En effet, ma famille était caractérisée rebelle et donc mal aimée par les maîtres bidhanes ; ceux-ci ne manquaient jamais une occasion pour le lui faire sentir.
Mes parents en général et ma mère en particulier ont toujours voulu s’assumer, se comporter comme des contrairement à leurs semblables du campement, qui sous prétexte de leur soi-disant infériorité naturelle, se laissaient aller à tous les abus, se dépersonnalisant jusqu’à l’animalité, comme aiment ainsi les voir leurs maîtres, soucieux de cultiver et d’entretenir la qui les séparent des esclaves.
Ma mère avait deux maîtresses, d’une famille très pauvre, voire misérable. Leur misère était telle que leur cousin avait tendance à les déconsidérer. Ma mère, plus par générosité que contrainte et forcée, s’était dépensée sans compter pour les soutenir, veillant à ce qu’elles soient nourries, habillées et entretenues convenablement, comme il seyait à leur position sociale. Elle s’était tant et si bien occupée d’elles que l’aînée des sœurs finit par être épousée par le chef de la collectivité.
Contrairement à toute attente, la nouvelle reine, au lieu d’être reconnaissante envers son obligée servante, n’avait plus cessé de la jalouser et de la combattre. Elle réussit même à faire adhérer, à sa jalousie et à sa haine, ses cousins les plus proches, qui convinrent, un jour, d’une expédition punitive contre ma famille. Ma mère fut purement et simplement lynchée en public et quasiment laissée pour morte, baignant dans son sang au milieu des flammes et de la fumée. Sa tente et tout son mobilier avaient été incendiés, ses animaux soit abattus, soit répartis entre les agresseurs, ses perles précieuses détruites ou redistribuées, etc. Se fut un véritable carnage.
Revenue à la vie, sans rien changer à son état de délabrement physique et vestimentaire, elle s’était rendue à Néma pour se plaindre à l’administration coloniale. Cette dernière, bien que se rangeant rarement du coté des esclaves ou des Haratines, victimes des mauvais traitements de leurs maîtres, tuteurs ou simplement en rupture avec eux, face à l’atrocité des blessures de ma mère sur laquelle ses tortionnaires s’étaient acharnés sans aucun scrupule, avait non seulement exigé de réparations immédiates (restitution et remboursement des biens détruits ou disparus) mais également décidé que la plaignante, ainsi que toute sa famille, seraient dorénavant libres de toute sujétion.
Il fut suggéré à ma mère de s’installer à Néma, pour éviter d’éventuelles représailles, ce qu’elle rejeta, fermement décidée qu’elle était à s’assumer et s’imposer dans son milieu.
C’est ainsi que ma famille, pour prix du sang versé par ma mère, fut la seule femme Haratine de sa collectivité à bénéficier, à l’époque, du statut administratif de « famille », à être recensée distinctement des maîtres bidhanes, donc à payer ses impôts… C’était en 1942 ou 1943. On dit qu’au temps où se déroulaient ces événements, j’étais âgé de 12 mois.
Rebelle et indépendante mais poursuivie par la haine d’une femme influente, ma famille était donc une proie toute désignée…
Il est à noter pour l’histoire mais aussi pour la morale de cette affaire, que l’instigatrice de l’expédition punitive contre ma famille est morte, il y a quelques années, sur le lit de mon jeune frère ; les dernières années de sa vie ont été exclusivement consacrées au service de notre famille. Elle y a joué tous les rôles : mère protectrice, sœur, fille, et … esclave. Quant au plus féroce de ses cousins, il est actuellement installé à Médine où il s’était rendu depuis cette affaire, fuyant ainsi les sanctions administratives. J’ai abrogé en moi, toute haine et tout esprit de revanche, de mon pèlerinage en 1984.
Il m’a accueilli comme un fils et m’a entouré de tous les soins, y compris celui de me masser en personne malgré mes vives et sincères protestations.
S’agissant maintenant du ravisseur qui m’a arraché du sol, il me rend jusqu’ici visite à Nouakchott, chaque fois qu’il y est de passage, le deuxième étant décédé peu de temps après l’enlèvement.
Ma vie d’écolier…
A l’époque il n’y avait que deux écoles, de trois classes chacune, dans toute la région. L’une était installée à Timbédra et l’autre à Néma, les deux villes étant distantes d’une centaine de kilomètres. Les trois classes de école correspondaient respectivement au cours préparatoire (2ans), et au cours moyen (2ans).
A l’école de Néma que je fréquentais, il y avait une cantine scolaire pour les élèves venus de la brousse comme moi. Nous y avions droit aux trois repas du jour : petit déjeuner, déjeuner et dîner ; nous avions droit aussi à une tenue une ou deux fois en année scolaire composée d’un boubou et d’un saroual en percale blanche. Nous logions en ville chez les correspondants de nos familles, voire de nos tribus.
Ma correspondante était une femme assez âgée, de la tribu des Tadjekante. Elle avait sa maison dans le quartier de Néma, dénommé Délouba. Elle était veuve ou divorcée et vivait seule avec son fils âgé de 25 à .30 ans, souvent malade et absent. Nos enseignants étaient surtout des africains : sénégalais, maliens et mauritaniens. Le régime scolaire était très sévère. Nous étions battus par les maîtres. Le châtiment était parfois des plus atroces.
Je n’avais comme encadrement que celui des maîtres, quand j’étais en classe. Ma logeuse était incapable de m’encadrer, d’abord parce qu ‘elle n’en avait aucune envie et ensuite parce qu’elle me voyait très rarement. Coupé brutalement de mes parents, de leur amour, de leur chaleur, du contact des proches et des amis, j’avais très tôt ressenti tous ces besoins, d’où ma tendance à changer souvent de correspondant, recherchant de nouveaux amis, la chaleur et l’amour perdus, etc.… Je n’étais pas un mauvais élève, mais seule la peur du châtiment corporel m’astreignait à une certaine assiduité ou sérieux. A mon âge, dans mon isolement, ma solitude, mon abandon et au milieu de l’indifférence général, il n’y avait que cette peur pour me guider, me conseiller, me raisonner, me tenir compagnie.
Ma scolarité primaire s’était déroulée normalement seulement entrecoupée par le décès de ma mère, en septembre ou octobre 1953 ou 1954, puis de mon père en mai ou juin 1954 ou 1955.
Bien évidemment, j’avais ressenti très douloureusement ces pertes et j’avais dû les affronter seul, sans presque personne pour me consoler.
Dans le désarroi et la solitude de mes pensées puériles, j’avais décidé de ne plus adorer cet Allah (qu’Il me pardonne). Qui, coup sur coup, m’ôtait subitement le seul sentiment de réconfort que j’avais, à savoir : revoir de temps à autre mes parents. C’est en 1967, à l’âge de 24 ans, que j’ai levé cette mesure…
J’ai obtenu mon C.E.P.E. (Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires) en 1956 et réussi mon admission au concours d’entrée en sixième en 1957.
Mon expérience au Collège Xavier Coppolani à Rosso (Sud-ouest de la Mauritanie) a été de courte durée.
L’entière liberté découverte au Collège y avait beaucoup contribué : liberté de sécher les cours, liberté de répartie au professeur, liberté de fumer, d’entrer, de sortir, de faire ce que je voulais… C’est-à-dire tout ce dont j’avais été frustré à l’école primaire. Mon enfance brisée, comprimée, confinée n’a pas tardé à resurgir à la première occasion.
C’est ainsi qu’après avoir redoublé ma sixième, je fus exclu définitivement à la rentrée scolaire 1959/1960. Bien que reconnaissant tout à fait ma part de dans cette exclusion, je demeure convaincu aujourd’hui que si j’avais été bidhane, elle m’aurait été évitée.
Comme un malheur ne vient jamais seul, ce fut également au cours de cette même année que je perdis mon unique sœur, foudroyée sous notre tente. C’était elle qui, courageusement, avait pris le relais de papa et maman. Elle laissait derrière elle deux petites filles âgées respectivement de trois ans et d’à peine une année.
Le terrible retour du bâton…
Le choc de mon renvoi avait été terrible. Brusquement j’avais réalisé que mon expérience d’écolier avait été un échec total et donc une très grande déception pour les miens et pour moi ; au fil des ans, en effet, nous nous étions fait à l’idée que ma scolarité n’était pas, après tout, une mauvaise chose. Chacun s’était habitué à y voir un signe du destin. Certes ma mère n’était plus là pour partager notre douleur et notre déception, se rendre compte par elle-même combien ma honte était grande, combien je me méprisais et me haïssait : j’avais réalisé tout à coup que j’étais seul responsable de ce qui m’arrivait. Cette culpabilité devenait d’autant plus insupportable que je m’étais trouvé sous la hantise de la trahison de la mémoire de ma mère. Psychologiquement, j’avais côtoyé la mort de très près, la mort que j’entrevoyais comme la seule façon de fuir la honte et l’humiliation.
Je ne saurai sûrement jamais par quel miracle j’ai pu survivre à cette terrible épreuve de mon renvoi du collège alors que cette mesure était, à mes yeux, synonyme déjà de la mort… pas plus que je ne comprendrai peut-être jamais pourquoi, après avoir lâchement rejeté cette mort, ma vie n’a plus été qu’une succession de défis…
L’éveil ou la prise de conscience…
Dorénavant véritablement seul, ne connaissant pratiquement personne, jeune, novice, très peu crédible et, ce qui n’était pas pour me faciliter les choses, hartani de surcroît, je n’avais pas d’autre alternative que de surnager ou périr. M’imposer, me faire accepter, me faire respecter devint une obsession…
Je compris très vite que cette ambition démesurée pour mon âge et mon niveau et cette rage insatiable d’exister véritablement passaient d’abord et avant tout par moi-même : Il fallait que je m’assumasse pleinement, que j’aie confiance en moi-même, que je m’imposasse obligatoirement à tous. Pour cela, il fallait être cultivé, sérieux, compétent, travailleur, honnête, juste et droit ; ne pas mentir, ne pas médire, s’élever au-dessus des bassesses, ne jamais s’y impliquer, être courageux et même au besoin téméraire. Etre un adolescent parfait en attendant d’être un parfait homme, voilà ce qu’il me fallait pour être accepté par les autres, à défaut de pouvoir m’imposer à eux !
Mon combat a donc toujours été contre moi-même avant d’être contre les autres : Sortir coûte que coûte du néant, de l’anonymat, de l’inexistence !
Ma soif de culture générale, celle de la vie en particulier, ne trouva à s’étancher qu’à travers la lecture qui fut, pendant de très longues années, mon passe-temps favori. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main et j’écoutais beaucoup la radio, attentif à tout ce qu’elle pouvait diffuser. J’étais tout à fait attentif à écouter les autres surtout quand ils font étalage de leurs connaissances et de leurs expériences quelles qu’elles soient.
Une carrière administrative vite commencée…
Je fus, à la suite d’un petit test de sélection, retenu pour remplir des tâches de bénévole au secrétariat du Cercle de Néma, immédiatement après mon exclusion. Très vite donc le chef du secrétariat du commandant de cercle put se décharger sur moi en ce qui concerne de nombreuses tâches courantes : enregistrement du courrier, dactylographier du courrier non confidentiel, etc.
En décembre 1959, un concours direct fut ouvert au niveau national pour le recrutement de commis ou secrétaires d’administration. J’y participais naturellement avec toutefois un coup de pouce du Commandant de cercle français de l’époque qui avait accepté mon inscription parmi les candidats alors que je n’avais pas l’âge requis de 18 ans. L’opération avait consisté à informer, par message radio, de ma candidature en spécifiant que le dossier suivrait.
Le concours se déroula le 10 décembre sur toute l’étendue du territoire. Il fallait cependant attendre presque sept longs mois avant d’apprendre les résultats. Ce n’est qu’en juin ou juillet 1960 que l’arrêté proclamant les résultats et portant affectation des admis parvint à Néma. Je faisais partie des heureux élus et j’étais muté à Atar, en Adrar, à l’autre bout du monde, dans le nord tout à la fois craint et abhorré par les populations du sud-est de la Mauritanie à cause de ses rezzous meurtriers et surtout à cause de ses rafles d’esclaves qui n’ont jamais visé que les Haratines.
J’arrivai donc à Atar le 21 juillet 1960. J’étais plus que jamais désemparé, désorienté, complètement isolé et perdu jusque pour moi-même dans un environnement et parmi un monde à la fois inconnu et qui, de surcroît, me faisaient peur.
Présenté au Commandant de cercle, Monsieur Vésy, un français aussi, celui-ci s’était exclamé : > Il m’avait accordé trois jours de repos, peut-être pour me remettre des fatigues du voyage particulièrement éprouvant par la route à l’époque, mais peut-être aussi pour me donner le temps de me remettre de mes émotions.
L’indépendance du pays fut proclamée quelques mois après : le 28 novembre 1960. Les compétences des autorités administratives – commandants de cercle, adjoints et chefs de subdivision- furent transférées peu après à des administrateurs nationaux Bidhanes et Négro-africains.
Affecté à la subdivision centrale d’Atar, je m’étais retrouvé sous les ordres à la fois du chef de subdivision et d’un secrétaire plus ancien et plus expérimenté que moi ; tous deux étaient des Bidhanes. Au bout de quelques mois (je n’ai aucune idée de leur nombre) je m’étais retrouvé seul face au chef de subdivision et surtout face à mes responsabilités, le premier secrétaire ayant été muté au cabinet du commandant de cercle, au premier et seul étage de la bâtisse qui abritait les deux administrations territoriales.<br><br>
…et très mouvementée…
Le premier défi existentiel me mit aux prises avec le commandant de cercle de l’Adrar lui-même, feu Ibrahima KANE, à Atar.
Un garde très fouineur et très envahissant lui ayant rapporté que > il m’avait convoqué dans son bureau et avait exigé que je lui présentasse mes excuses devant témoins : le commandant de la brigade de gendarmerie (un français encore) et le garde en question.
Ayant considéré que la manière et la forme étaient trop vexatoires, voire humiliantes, j’ai refusé net de présenter mes excuses et ce après avoir confirmé les propos rapportés par le garde. Il me renvoya sèchement de son bureau en me traitant de tous les noms et m’interdit de remettre les pieds dans les lieux, jusqu’à nouvel ordre.
J’étais stagiaire et mon renvoi était quasiment automatique, mais je l’avais préféré à l’humiliation.
Il mit un point d’honneur à me faire revenir sur ma position, alternant les pressions extérieures et les siennes, la persuasion et les menaces, le tout en vain.
A l’issue d’une ultime convocation et constatant qu’il ne m’impressionnait pas du tout, il m’avait enjoint de rentrer chez moi en me tenant ces propos : >
Une ou deux années après ce généreux conseil, je fus muté par décision de Nouakchott dans le sud du pays, dans le Brakna, à Boghé.
Le désappointement du commandant de cercle avait été tel qu’il m’avait sommé de quitter Atar, le lendemain même. La providence fit qu’il tomba la même nuit une très forte pluie (on était en août 1962) qui provoqua la fermeture de la seule piste ou route. Informé de ce contretemps, le commandant de cercle décida de me céder sa place dans l’avion qui partait le même jour, mettant un point d’honneur cette fois à me faire >
Venu à l’aéroport, accompagné de son épouse, pour me voir embarquer dans l’avion en partance pour Nouakchott, il fut certainement surpris de me voir venir à eux et de m’entendre dire, en lui tendant respectueusement la main :
Il avait retenu ma main et m’avait dit :
Pourquoi cette réaction de ma part ? La réponse, je l’ai déjà donnée plus haut : Mes défis et mes combats ont toujours été contre moi-même, pour me forger un caractère, une personnalité, être un homme, atteindre mes propres limites. Je n’éprouve généralement ni haine ni rancune pour mes contradicteurs, car dans mon esprit ils n’ont occupé qu ‘une place tout à fait secondaire, fortuite, par rapport à celle, très principale, permanente, qu’occupe mon Ils ne sont pour moi qu’un champ expérimental, jamais recherché mais rencontré, par hasard…
Je surprends toujours ceux qui me connaissent par mes colères orageuses qui tombent aussi vite qu’elles apparaissent.
A Boghé et Aleg, de 1962à 1968 (avec toutefois une interruption de 6 mois de stage à Nouakchott), à Aïoun et Atrouss, de mai ou juin 1968 en décembre 1969 et à Tichit, de mars en décembre 1970, j’ai eu de nombreux défis à relever face aux différentes autorités administratives sous les ordres desquels j’avais été successivement placé. Les frictions nombreuses que j’ai eues tout au long de ma carrière administrative étaient toutes inhérentes aux mentalités de mes chefs tous issus de milieux aristocratiques ou bourgeois- qui avaient tendance à ne voir en moi qu’un esclave secrétaire. Mon âge et ma condition sociale les y encourageaient objectivement.
Mes réactions les surprenaient et les révoltaient toujours, considérant ma fierté, mon assurance et le sentiment général de liberté et d’aisance que je dégageais, pour de l’arrogance.
Il me souvient par exemple qu’ayant un jour fort contrarié mon chef, le préfet feu Cheikh DIALLO, dans son bureau, il était allé jusqu’à menacer de me gifler si je répétais le propos en cause. Sans aucune hésitation, je l’avais répété. Le préfet s’était levé fou furieux de son fauteuil, avait fait le tour de la table, s’était planté devant moi et avait levé le bras pour apparemment m’asséner la gifle promise. Il avait hésité une fraction de seconde et avait rabaissé le bras, l’index pointé en avant et, l’appuyant légèrement sur ma tempe, s’était étonné :
D’un amour propre très chatouilleux, j’avoue de côté qu’il m’est souvent arrivé de me formaliser pour des rien, y percevant parfois une volonté maligne de la part de mes contradicteurs, ce qui ne saurait être toujours vrai.
Parfois aussi certains abus délibérés de mes chefs, envers les administrés, généralement des haratines dans ces cas, m’avaient poussé à engager ouvertement les hostilités.
A l’issue du stage effectué à Nouakchott entre 1964 et 1965, nous étions 10 à être reçus au concours de fin de stage et promus au grade de rédacteurs de l’Administration générale (cycle B) pour compter du 1 janvier de l’année suivante (1966.) J’avais été reçu major de la promotion, ce qui ne m’épargna pas, cinq ans après, à Maghama, au Gorgol, de me retrouver sous les ordres d’un promotionnaire catapulté préfet alors qu’il était classé sixième de la promotion.
Lui, bien évidemment était d’une famille aristocratique (chef d’une tribu) alors que moi je n’étais qu’un fils d’esclave.
Mes vigoureuses protestations écrites eurent pour conséquence mon affectation, en juillet 1972, en qualité de chef d’arrondissement d’une localité sans population et sans eau, Temessoumitt (département de Moudjéria) au point d’intersection des régions de l’Adrar, du Trarza et du Tagant dont elle dépend administrativement.
Cette promotion, parce qu’elle était tardive et au n’avait réussi qu’à renforcer en moi le sentiment d’injustice et de discrimination que j’ai toujours au contact de l’Etat et de ses représentants.
Contraint et forcé de résider à Moudjéria, j’eus des problèmes avec mon chef direct, le préfet du département, feu Ismaïl Ould ABOUMEDIANA. Mis au courant de la situation qui prévalait entre nous, le pouvoir central me muta à Ouadane, en Adrar, un arrondissement perdu lui aussi dans le désert, mais beaucoup plus vivant que Temessoumit.
En mars/ avril 1975, je fus convoqué à Nouakchott pour suivre un stage de perfectionnement (recyclage) de quatre mois à l’issue duquel je devais être enfin nommé préfet. Une fois à Nouakchott j’appris que ce recyclage était parallèle à un autre de même durée qui préparait au concours d’entrée au cycle A Court de l’E.N.A. (Attachés d’administration générale) je fis aussitôt part au ministère de l’Intérieur de mon souhait de préparer le concours d’entrée à l’ENA.
Le ministre en personne me convoqua et tenta de me persuader de ne pas renoncer à ce pour lequel il m’avait convoqué, allant même jusqu’à me rappeler que je n’étais pas sûr de réussir mon entrée à l’école Nationale d’Administration. La pression était de taille, mais je la balayai en ces termes : > Voyant qu’il prêchait dans le désert, il utilisa son ultime arme en exigeant de moi une démission écrite du corps de commandement. L’objectif de la manœuvre était clair là aussi : En cas d’échec au concours d’entrée, il ne serait plus question de me reprendre dans le commandement et ce serait par ma seule faute.
J’acceptai néanmoins de lever le défi en signant ma démission.
Le résultat fut qu’à la rentrée, un cycle nouveau, le cycle A Long (Administrateurs civils bilingues) était introduit à l’ENA. Les conditions pour y entrer était pour le professionnel que j’étais, les mêmes que pour le cycle A Court. Le concours direct concernait quant à lui les bacheliers. Je passai donc les deux concours et je fus reçu aux deux. J’optai pour le A Long, malgré les matières arabes et les mathématiques qui occupaient une part non négligeable de l’enseignement qui y est dispensé et mes limites certaines en ces matières.
La promotion, les premières, ne comptait que dix étudiants dont neuf bacheliers et moi. La scolarité dura quatre ans. A la sortie, j’avais été classé 3ème de la promotion et je fus immédiatement promu adjoint au gouverneur du district de Nouakchott, chargé des affaires administratives.
Quatre mois après, je fus nommé préfet central à Rosso où j’eus trois épreuves de force avec les trois gouverneurs qui se sont succédé durant la seule et unique année effectuée en charge de ce département.
Je fus ensuite promu gouverneur de la région de Gorgol (Kaédi) le 1er janvier 1981. J’y suis resté jusqu’au 10 octobre 1984 et j’eus , là aussi, à relever des défis importants contre des proches du chef de l’Etat Mohamed Khouna ould HAIDALLA ; il s’agissait en l’occurrence du commandant Mohamed Lemine ould ZEIN, alors membre du Comité Militaire de Salut National et président de la Commission régionale de ma région et du capitaine MOULAYE Hachem en charge du Commissariat à la sécurité alimentaire.
J’eus également à critiquer ouvertement, dans mes rapports officiels, la politique du Gouvernement. J’ai enfin, en deux occasions au moins, fait part directement de ces critiques au chef de l’ Etat lui-même, au cours des deux seules audiences qu’il m’ait accordées, une fois à Kaédi et une deuxième fois à Nouakchott.
Une fois, au cours d’un déjeuner offert par le même chef d’Etat aux gouverneurs des régions j’eus, durant tout le temps passé avec lui, à lui apporte seul, en présence de tous les gouverneurs, du Premier Ministre (l’actuel chef de l’Etat) et de quelques membres du CMSN, la contradiction à propos de son protégé Moulaye HACHEM, également présent. Le défi était de taille, car jusque là personne n’avait osé parler au président Haidalla comme je l’avais fait.
L’une de mes nombreuses satisfactions morales (j’en rends grâce à Allah) sera certainement le jour où je fus convoqué par le permanent du CMSN, alors que j’étais de passage dans la capitale, pour me féliciter et m’encourager à propos d’un rapport très critique dont une ampliation lui avait été adressée :
Muté en octobre 1984 dans la région du Guidimakha, à Sélibaby, je n’eus pas à y effectuer trois mois complets parce que je fus nommé ministre du développement rural dans le gouvernement issu du coup d’état du 12 décembre 1984, qui vit l’avènement du président actuel, le colonel Moaouya 0uld Sid Ahmed TAYA.
Je fus le premier Hartani revendiquant sa hartanité et la brandissant comme un étendard , à accéder à toutes ces hautes fonctions dans le pays.
Mon entrée dans le gouvernement en 1984 ne devait rien changer à mes comportements, mes relations et mon engagement. Je me suis assez souvent opposé à des points de vue du chef de l’Etat, suscitant tantôt sa colère et tantôt son revirement et son sourire et ceci qu’on soit en conseil des ministres ou seul à seul.
J’ai en effet toujours considéré que s’abstenir de dire ce que l’on ressentait et surtout ce que l’on croyait était le summum de la lâcheté et de l’hypocrisie.
C’est ainsi que convoqué par le chef de l’Etat en 1986 après la publication du Manifeste négro-africain, j’ai usé de tout mon tact pour tenter de le décolérer . Ma démarche avait consisté surtout, avec force arguments, à lui banaliser la situation. Je lui avais aussi rappelé son devoir de chef de l’Etat qui lui commande, quoi qu’il arrive, de rester serein et d’éviter de se mettre en colère.
Je suis toujours resté sourd aux thèses racistes de plus en plus affichées, et parfois ouvertement… Je me suis ouvertement opposé à la destitution d’un collaborateur négro-africain, accusé d’appartenir aux Flam et ce en mettant en jeu ma fonction de ministre.
J’ai enfin ouvertement et clairement dit mon opposition à la politique anti-négro-africaine que je voyais se dessiner et j’ai même mis en garde le ministre en charge de l’Intérieur de l’époque contre un dérapage à l’exemple de celui commis par Sékou TOURE de Guinée vis-à-vis des Peuls. L’idée que mes propos seraient rapportés tels quels au chef de l’Etat ne m’impressionnait guère, bien au contraire…
Sur un autre plan, j’ai par exemple refusé de recevoir le frère aîné du chef de l’Etat (qui fait la pluie et le beau temps) soucieux que j’étais de lui faire comprendre, qu’en ce qui me concernait, il reste un citoyen ordinaire…
C’est après avoir vainement tenté de m’instrumentaliser, que j’ai été renvoyé du gouvernement le 18 mars 1988
J’ai donc quitté le gouvernement la tête haute, très bien coté par l’opinion nationale et sans avoir jamais été impliqué dans la moindre affaire sale ou douteuse.
Cette popularité n’a pas semblé n’a pas semblé être du goût du pouvoir, car que peu de temps après, dans le souci de ternir mon image de marque, voire de me briser définitivement, il m’intenta un procès devant la Cour suprême pour… On me reprochait, disait-on, d’avoir ordonné la cession gratuite d’un tonnage d’aliments pour bétail alors qu’il aurait dû être vendu. Je fus condamné à une amende d’environ 100 000 francs français que je n’ai jamais acquittée (je n’en ai pas les moyens), peine tombée en désuétude, à cause du délais de prescription.
Le régime actuel, c’est un secret de polichinelle, s’accommode difficilement des idéalistes ou simplement des gens de principe.
Ma vocation de militant anti-esclavagiste
C’est mon oncle maternel qui, alors que j’avais l’âge de 10 ou 11 ans et que j’assistais, durant les grandes vacances scolaires, au recensement de la tribu, en m’informant des injustices que subissait ma famille en matière d’imposition notamment en me demandant d’en référer au chef de subdivision – un français – dans l’espoir de l’amener à redresser la situation, a susciter ma révolte contre l’injustice en même temps que ma prise de conscience du problème de mes semblables haratines.
Mes parents ne vivaient plus et mon frère aîné était absent. Notre sœur était une femme et n’avait pas le même nom de famille que le nôtre. J’étais donc le mieux indiqué pour m’occuper des intérêts des miens et ce d’autant plus que je parlais la langue, tant bien que mal.
Je fis part au commandant de ce dont m’avait fait part mon oncle ; il m’avait écouté attentivement, sans broncher ; nous nous regardions dans les yeux…
A la fin de mon exposé, il me fixa encore quelques secondes avant de m’enjoindre sèchement : «Sors… Sors, espèce d’impoli ! >>
J’étais bien évidemment sorti sans protester mais profondément humilié et révolté par tant d’injustice vis-à-vis de ceux qui ont soif de justice et ne demandent qu’elle.
C’est à partir de ce jour là aussi que j’ai souhaité intensément occupé la même responsabilité que ce commandant.
Ce n’est que 15 ou 16 ans après, lors d’un démêlé avec l’un de mes chefs alors gouverneur à Aouin el Atrouss, qui me reprochait de le regarder dans les yeux, que je compris la raison de mon éconduite par le gouverneur français : je n’avais pas cessé de le fixer dans les yeux, ce qui, à mon âge, avait été considéré par lui comme une effronterie inadmissible.
Pourquoi ce commandant n’avait-il pas jugé, au lieu de cela, que j’étais tout simplement un enfant fasciné par le bleu de ses yeux ?
Voilà comment tout est parti : L’injustice subie à mon corps défendant et ma prise de conscience qu’au-delà de ma petite personne et de ma petite famille, elle est subie par des centaines de milliers d’individus que le hasard de la vie a placés en situation d’infériorité par rapport à d’autres individus.
Il s’imposa donc naturellement à moi, pour que j’existe véritablement, de m’investir dans le combat pour la liberté de mes semblables, contre tous les préjugés, d’abord à mon propre niveau en me comportant en homme libre et en homme de bien et ensuite au niveau de la société toute entière en faisant comprendre aux laissés pour compte qu’ils ont les mêmes droits que tous les autres, qu’ils n’ont réellement rien de plus que ceux qu’ils piétinent.
Dans mon obsession de culture, j’étais tombé par chance sur certains livres qui traitent des problèmes d’inégalité aux Etats-Unis et en Afrique du Sud et des combats qui y étaient menés. Je compris que dans mon pays il fallait livrer le même combat. C’est ainsi que dès 1962 et alors que j’étais en poste à Boghé, j’ai commencé à conceptualiser le combat que je mène encore aujourd’hui. Mes réflexions de l’époque sont encore aujourd’hui consignés dans des cahiers.
Mais mon combat était personnel, solitaire, intellectuel, et rares étaient ceux qui en avaient connaissance.
Lorsqu’en 1978, à l’ENA je fus pressenti par quelques autres haratines pour réfléchir sur notre situation, j’étais surpris et même étonné que d’autres que moi aient à cœur le même problème. En quelques jours, nous avions formé EL HOR dans la clandestinité. Son premier tract intitulé > est justement un extrait de mes cahiers. Il a été dactylographié et multiplié par moi-même. Ce titre devait d’ailleurs longtemps supplanter le nom réel de l’Organisation : EL HOR (Organisation de Libération et d’Emancipation des Haratines. Jusqu’ici, nombreux sont ceux encore qui nous affublent de >
L’inexpérience du jeune mouvement devait conduire très tôt à l’arrestation quasi générale de ses membres fondateurs et un grand nombre des ses activistes à la suite d’une manifestation organisée à Atar pour protester contre la vente d’un esclave.
Ce fut une période particulièrement éprouvante pour moi sur le plan moral et psychologique.
Alors que j’étais en poste à Rosso, les nouvelles des arrestations de mes camarades me parvenaient au jour le jour, grâce au directeur régional de la sûreté, un commissaire de police connu pour être particulièrement dangereux et magouilleur. Je compris évidemment que cet excès d’informations procédait d’ordre supérieur dont l’objectif était d’assurer ma surveillance. Plusieurs fois par jour r même tard dans la nuit, il trouvait le moyen de faire irruption dans mon bureau ou dans mon domicile pour soi-disant m’apporter des nouvelles fraîches.
Il s’agissait plus sûrement d’éprouver mes nerfs jusqu’à l’extrême.
Un jour, n’en pouvant plus, je ne pu résister à la force qui me poussait à décrocher le téléphone et à appeler le gouverneur de Nouakchott, un militaire dont j’étais il y a quelques semaines le premier adjoint, pour l’interpeller en ces termes : >
Très cordialement, mon interlocuteur avait répondu à peu près en ces termes : > Il mentait sur toute la ligne : Non seulement les arrestations avaient continué, mais comme je devais l’apprendre par la suite, les simples interrogatoires avaient été, pour certains camarades, de véritables séances de tortures. Le camarade Ahmed Salem Ould DEMBA devait, à cause de ces tortures, perdre partiellement la raison ( décédé , il y a à peine deux mois).
J’étais donc seul, isolé, sans aucun contact avec qui que ce soit du groupe dont la stratégie était d’isoler, pour sa sécurité, tout membre actif dans les rouages de l’Etat. J’étais donc isolé depuis ma sortie de l’ENA.
Un soir je me décidai à faire partager à mon épouse, une militante du Mouvement, l’objectif de mes soucis : >
Mon épouse ayant persisté, malgré mon insistance, dans son refus de donner son propre avis, acceptant et s’en remettant entièrement à mon choix, quel qu’il soit, je choisis de rester.
Le harcèlement du commissaire de police se poursuivit… Il ne prit fin que qu’ au moment où, excédé, j’eus à mettre les choses au point, à ce même commissaire, en présence du gouverneur du Trarza, un militaire de surcroît. Cette mise au point avait consisté à afficher, haut et fort, ma « hartanité », d’exprimer ma solidarité aux amis arrêtés, de dire au commissaire que « je l’em…, lui enjoins de cesser de m’importuner et advienne enfin que pourra ! »
Ma décision de rester et de subir le même sort que mes camarades m’avait ôté toute crainte, et il me brûlait de précipiter mon arrestation que je considérais inéluctable de toute façon.
Les allées et venues du commissaire avaient cessé net.
Quelques temps après, un convoi de véhicules de la gendarmerie pénétra dans la cour de ma résidence. D’abord surpris, je fus étonné d’en voir descendre, outre plusieurs gendarmes en uniforme et armés, tous mes camarades arrêtés et visiblement pas si mal en point que cela. Je vins à leur rencontre, les embrassant chaleureusement les uns après les autres. Laissant le reste de ma famille s’affairer à leur aménager où s’installer, je me rendis personnellement au marché de bétail de la ville et j’en rapportai deux grands et gros moutons à sacrifier à leur intention.
C’est bien plus tard que je compris qu’on les amenait à Rosso pour leur procès. Dans l’après-midi, ils devaient me quitter pour leur centre de détention : le camp de la gendarmerie.
Je n’ai par contre jamais compris pourquoi on leur fait cette halte dans ma résidence ?
Bien que n’y étant pas tenu, je me fis un devoir d’assister à tout le procès, assis au banc du gouvernement. Le président du tribunal – c’était un tribunal militaire – prit un malin plaisir à les questionner de temps à autre à mon sujet : « Me connaissait-on ? , M’avait-on rencontré ? Avait-on entendu parler de moi ?…»
A deux ou trois reprises je fus surpris par des membres de la Cour en flagrant délit d’encouragement par le signe à certains accusés. Enfin, dans certaines de ses interventions, l’accusation eut à me désigner, elle aussi, du regard ou d’un geste, pour réfuter ce dont la défense l’accusait à savoir : « Une chasse effrénée aux haratines ! »
Je suis toujours resté très calme et j’ai même osé interpeller l’avocat général s’agissant de ses allusions à ma personne, dans les coulisses évidemment.
Cette parenthèse fermée, ma lutte a continué, comme par le passé, à mon propre niveau, puis au niveau des haratines que je rencontrai de plus en plus dans le cadre de mes activités professionnelles, mais aussi à travers mes rapports périodiques d’autorité administratives. Ma principale préoccupation, vu les fonctions dorénavant les miennes, était de devenir un exemple de compétence, de droiture, de patriotisme, de courage et d’humilité, non pas pour une quelconque gloriole personnelle, mais bien au contraire pour les Haratines, car il était important pour leur devenir que leur symbole, l’œillère à travers laquelle on les verrait dorénavant tous, fût irréprochable.
Quand j’ai été déchargé du service actif de l’Etat, j’ai attendu tranquillement que mes camarades de El Hor se manifestent. Je ne voulais pas, prendre moi-même l’initiative de me présenter à eux par peur d’être taxé de vouloir m’imposer en leader ou de servir du Mouvement à des fins égoïstes et de… je ne sais quoi encore, toutes choses que je suis dans l’incapacité de supporter.
C’est en 1989, lorsqu’ils optèrent pour une candidature haratine à l’élection municipale de Nouakchott, qu’ils reprirent contact avec moi, me demandant de me porter candidat au nom du Mouvement.
Puisque ces élections intervenaient après les tragiques événement « sénegalo-mauritaniens » avec les conséquences que l’on sait, elles ont été pour mon Organisation et pour moi-même l’occasion d’affirmer haut et fort notre position par rapport à tout cela. Nous avons défendu et soutenu les justes revendications des populations négro-africaines : leur droit à la vie, à la citoyenneté, au sol, à l’égalité, à la différence culturelle, etc. En vérité, après les événement de 1989 El Hor, par ma voix, était l’unique Organisation nationale à défendre publiquement les droits des négro-africains. Personne à l’époque n’avait même osé évoquer leur existence, sauf par tracts.
C’est notre position sans équivoque qui est certainement à l’origine de la levée de bouclier qu’a suscité ma liste combattue ouvertement par le régime. Malgré la fraude massive et les malversations, elle réussi néanmoins à faire élire dix conseillers municipaux sur 37.
En guise de protestation, je n’ai jamais accepté de siéger au dit conseil.<br><br>
Lorsque la nouvelle des exécutions extrajudiciaires a été connue, El Hor par ma voie a, publiquement et par tract, pris fait et cause pour les victimes et dénoncé énergiquement cet état de fait. Enfin, dans la vague de contestations qui a suivi, nous avions toujours occupé une place centrale. C’est notamment à notre initiative qu’a été crée le FUDC ( Forces Démocratiques Unies pour le Changement).
Lorsque les militaires, pressés par les événements, furent contraints de jouer à « l’ouverture démocratique » je fus convoqué par le chef de l’Etat qui visiblement voulait que je me range de son côté dans cette nouvelle perspective. Mon Organisation et moi avons répondu par un non catégorique, en demandant publiquement la démission pure et simple du chef de l’Etat et ce à cause principalement des crimes commis au préjudice de la communauté négro-africaine à savoir : assassinats, massacres, torture, spoliation et déportation…
Détenu en même temps que les fondateurs du FDUC (de mai-juin 1991 à fin juillet 1991), je participais, activement, à la création de UFD ( Union des Forces Démocratiques) dont je fus le premier secrétaire général.
La difficile cohabitation avec des opposants de dernière heure finit par me décider à quitter ce parti ( où j’ai été sauvagement combattu par ceux-là même que j’ai contribué à rapprocher) pour fonder en 1995 Action pour le Changement que je présidai ( A C a été dissout arbitrairement en janvier 2002).
Cela ne mit pas fin autant aux attaques directes ou voilées que je continue de subir de la part de mes anciens et nouveaux alliés car, en fait, je dérange beaucoup de monde, particulièrement ceux qui admettent difficilement que d’autres qu’eux occupent les devant de la scène.
J’avoue que je ne fais pas souvent dans la dentelle, que je suis direct, voire cassant et donc pas agréable à vivre pour ceux qui ont horreur de la vérité. Je suis, par contre, fidèle à mes conviction, à mes amitiés et à mes engagements. Mon honnêteté morale et intellectuelle que je crois être totale fait que je suis facile à tromper une première fois, puis une deuxième… et même une troisième fois parce qu’ au départ mon préjugé est toujours favorable et que les deux autres fois sont à mettre sur le compte de l’erreur, qui est humaine ; mais une fois ces chances passées, il n’y aura plus rien à faire.
La confiance ne reviendra jamais.
Si le paternalisme des bidhanes, leur condescendance, leur hégémonisme et leur mauvaise foi provoquent chez moi de vives et parfois violentes réactions, il y a aussi que la grande susceptibilité des négro-africains (qui ne cèdent en rien sur de nombreux points aux bidhanes) et leur égoïsme exacerbé ne facilitent guère une bonne entente avec eux.
Les haratines quant à eux, naguère exclus par ce qu’esclaves, ne sachant par quel bout prendre cette vie qu’ils découvrent pour la première fois, se dispersent à cause de leurs contradictions, leurs égoïsmes, leurs jalousies, leurs ambitions ou plus exactement leurs prétentions quand bien même il n’auront joué comme rôle, pour la majorité d’entre eux, que d’être haratines.
Leur lente et difficile prise de conscience, de même que leur divisions ne sont pas pour déplaire aux autres communautés, qui ne sont pas pressées de leur accorder le statut tant convoité de communauté homogène, respectable et respectée.
C’est donc dire que le combat que je mène ne me laisse aucun répit où que je me tourne, et les sujets de friction sont nombreux. Si en général les attaques des bidhanes ne sont pas directes, apparentes, celles des haratines et des négro-africains sont par contre ouvertes, violentes et fréquentes. Mes plus grandes déceptions sont toujours venues d’eux et dans le même ordre.
Mais hormis quelques rares cas d’extrême lassitude, l’idée de tout laisser tomber pour m’occuper de mes enfants, ne m’a vraiment jamais tenté.
Le combat est des plus difficiles, mais il doit se poursuivre…
Mon expérience à l’UFD puis à l’UFD /EN est en effet, sur beaucoup de points évoqués, assez édifiante : Tout a commencé avec les élections présidentielles de 1992 ; l’UFD était un grand parti, ses militants étaient nombreux et décidés. L’illusion qu’une nouvelle Mauritanie était en gestation donnait des ailes à tout le monde ; il y avait aussi cette réelle volonté, perceptible chez les principaux acteurs, sinon de faire oublier aux uns et aux autres les profondes blessures consécutives aux événements récents de 1989, 1990 et1991, au moins de contribuer à en limiter des séquelles morales et psychologiques en faisant partager par tous leur foi en un changement profond de la société profitable à tous.<br><br>
Ces maudites élections allaient donc sonner le glas de toute cette euphorie, de tout cet enthousiasme, de toutes ces convictions fortes, de toutes ces généreuses illusions…
Le parti prôna au départ le boycott si des garanties de transparences n’étaient pas obtenues. Il s’avéra par la suite que ce qui était, une position stratégique pour les uns (mon groupe notamment) n’était qu’un repli tactique pour les autres qui attendaient « d’avoir un candidat crédible, c’est à dire un bidhane » l’idée de présenter le plus adulé et plus charismatique du parti (moi) n’étant tout simplement pas envisageable à leurs yeux. Personne ne voulait de moi comme candidat, non pas à cause de mes qualités morales et intellectuelles que personne ne mettait en doute, mais simplement parce que je suis un hartani.
Mon éventuelle candidature était combattue non seulement par les bidhanes, mais également par les négro-africains.
Tous en effet considèrent intérieurement ou ouvertement qu’un esclave ne saurait devenir un prince.
Une fois le candidat trouvé en la personne d’Ahmed Ould Daddah (dont la seule caution politique et morale est qu’il soit le frère du premier président mauritanien renversé en 1978) il y eut un renversement de tendance, prônant cette fois la participation du parti aux élections, non pas en présentant un candidat issu de ses rangs, mais seulement en soutenant la candidature indépendante d’Ahmed… Mon opposition à cette démarche fera que ledit candidat ne verra plus en moi qu’un vulgaire et redoutable adversaire ou même un ennemi qu’il faut abattre par tous les moyens.
Même lorsque j’acceptai plus tard de revenir sur ma décision, de faire campagne pour lui et enfin d’accepter de demeure dans l’UFD/EN dont il est devenu le chef, cela n’améliora pas ma cote auprès de lui.
Il travailla activement en vue de me faire quitter le parti où lui et ses alliés conjoncturels se sentaient très à l’étroit à cause de ma popularité au niveau de la base du parti, essentiellement constitué de haratines et de négro-africains. Si lui se sentait « frustré ou menacé » dans mon rôle de chef incontesté, certains cadres négro-africains, considérant eux aussi que ma popularité auprès de « leur base négro-africaine » leur portait ombrage, n’étaient pas mécontents non plus de me voir partir… C’est ce que je fis en 1994.
Je peux dire aujourd’hui, sans aucun risque de me tromper, que mon départ a sonné définitivement le glas de l’UFD/EN.
Quel outil pour le changement ?
Action pour le Changement regroupait des Haratines, des Négro-africains mais aussi des Bidhanes. Nous militions tous pour un changement démocratique véritable dans la société.
Pour cela il faut la citoyenneté pleine et entière pour tous : liberté, égalité, unité et solidarité de tous les mauritaniens.
Nous voulons que l’esclavage soit constitutionnellement aboli, déclaré crime contre l’humanité et qu’à ce titre des sanctions soient prévues à l’encontre de ceux qui persisteraient, à le pratiquer. Nous reconnaissons ( mais cela n’est pas nouveau) que l’esclavage existe au niveau de toutes les communautés mauritanienne, c’est à dire la communauté maure et les communautés négro-africaines. Nous voulons que des programmes spécifiques soient mis en œuvre pour toutes les couches défavorisées dont évidemment les haratines.
Nous voulons que le caractère pluriculturel de la Mauritanie soit constitutionnellement reconnu scellant ainsi le droit à la différence. Nous voulons que les mauritaniens aient la même égalité de chance et qu’ils soient mis dans les mêmes conditions.
Nous refusons d’oublier les crimes horribles commis à l’endroit de nos compatriotes négro-africains et nous exigeons que justice soit faite, que les coupables soient punis, que les réparations soient consenties aux ayant droit.
C’est alors seulement que le pardon pourra être sollicité et obtenu…
Nous croyons sincèrement à la démocratie et à l’unité nationale sur ces bases et nous la croyons tout à fait réalisable à plus ou moins terme.
Nous voulons que tous ces changements s’opèrent en dehors de toute violence et de tout esprit revanchard.
Sur ce point nous divergeons fondamentalement avec les FLAM.
A propos de quelques points précis…
A la lecture du premier manifeste des FLAM, je reconnais que je n’en ai pas partagé toutes les idées et particulièrement celles qui ont consisté à décompter les mauritaniens sur la base de la couleur et à se présenter en défenseurs ou protecteurs des haratines alors que ses auteurs n’y ont jamais pensé par le passé et surtout parce qu’ils ne les ont jamais approchés politiquement jusqu’ici.
Il y a aussi que j’avais jugé, à juste titre, je crois, qu’il y avait de l’exagération en ce qui concerne l’exclusion des négro-africains au moment de la présentation du document. L’aristocratie négro-africaine – pour ne pas dire les négro-africains en général- a toujours tout partagé avec les bidhanes, y compris le mépris souverain des haratines et partant l’attitude qui consiste à les ignorer totalement. A l’époque, crier à l’exclusion des communautés négro-africaine était quelque peu exagéré, même si l’accélération de l’arabisation pouvait présager le pire.
Bien évidemment, la situation aujourd’hui est pire que celle décrite en 1986. Aucun mot ne pourra jamais faire saisir tout à fait l’intensité et l’horreur de la vague de répression qui à déferlé sur ces communautés. Nous travaillons de concert avec tous ceux qui croient encore à l’idéal de justice, de paix, d’unité et de solidarité. Notre foi et notre détermination pour la réalisation de cet objectif ne faibliront jamais.
Je suis au courant de nouvelles tendances qui se dessinent chez les FLAM et j’attends, pour y voir clair réellement, que les FLAM cessent de répandre des aberrations mensongères à propos des haratines qu’ils considèrent être la source de leurs maux et donc leur principal ennemi. Je crois très sincèrement et très simplement que les haratines qui ont ( par eux-mêmes ou parce qu’ils ont été manipulés par d’autres) massacré ou pillé des négro-africains lors des évènements exceptionnels, ne doivent pas ravir la vedette à tous les autres, beaucoup plus nombreux, qui ont défendu ces mêmes négro-africains, parfois au risque de leur vie.
A l’heure actuelle le pouvoir en Mauritanie agit sans la moindre logique, de manière presque paranoïaque. Ainsi la Mauritanie s’est retirée de la CEDEAO, pour se couper encore davantage du monde noir africain alors que celui-ci fait partie de la substance de son peuple, qu’il fait partie de son héritage culturel et historique.
Sans doute les dirigeants actuels croient-ils se racheter aux yeux du monde arabe après la catastrophique décision d’établir des relations diplomatiques avec l’Etat d’Israël, mais ils se trompent lourdement sur toute la ligne car outre que rien ne les rachètera de « ce péché mortel » l’intérêt majeur des arabes est sans doute d’étendre et de consolider leurs relations avec les Etats d’Afrique noire avec lesquels ils ont beaucoup de points communs.
Sans un rôle constructif et d’avant garde à jouer en Afrique noire, la Mauritanie ne représente aucun intérêt pour le monde arabe, ni pour le monde islamique, ni même pour ses propres citoyens.
La Mauritanie a pour seule vocation d’être ouverte sur le monde arabe, sur le monde africain car par l’effet du hasard elle se trouve à la rencontre entre ces deux monde dont elle pourrait constituer une admirable synthèse capable de favoriser entre les deux une totale symbiose.
Dois-je enfin rappeler que l’Afrique noire constitue le seul et unique arrière-pays pour les bidhanes ?
Je souhaite donc du fond du coeur l’avènement dans mon pays, comme dans le reste du monde, d’une démocratie véritable, d’un dialogue sincère et constructif, seule alternative à la violence. Il faut que le pouvoir en Mauritanie crée les conditions d’un tel dialogue. Une fois ces conditions réunies, l’opposition y répondra favorablement à coup sûr…<br><br>
Les haratines représentent environ 50% de la population totale du pays, elle même estimée à 2.500.000 habitants.
Aux élections de 1996, Action pour le Changement a été le seul parti véritablement de l’opposition à avoir fait élire un député qui, depuis a pris le large…
Aux élections de 2001, AC a fait élire 4 députés ( deux à Nouakchott dont moi-même, un à Nouadhibou et un au Guidimaka) , 4 maires ( dont trois à Nouakchott et un à Sélibaby) et plusieurs conseillers municipaux sur le territoire national devenant ainsi le premier parti de l’opposition, malgré toutes les contraintes imposées par le régimes et sa machine administratives.
Après la dissolution arbitraire de mon parti AC en janvier 2002, dans les conditions que vous connaissez et le refus de ce régime de reconnaître notre nouvelle formation politique Convention pour le Changement ; il a été convenu de fusionner Convention pour le Changement (CC) et l’Alliance Populaire pour le Progrès (APP) au sein du parti APP.
Malgré l’attachement du peuple mauritanien à la démocratie, son aspiration à participer à la gestion des affaires du pays et la lutte qui a été engagée par ses forces vives, patriotiques et démocratiques, le processus démocratique dans notre pays est adopté surtout pour répondre aux orientations et pressions des pays occidentaux ainsi qu’aux changement survenus dans le monde, précisément la chute du bloc socialiste et la course des pays de l’Europe de l’Est vers le système libéral et la mode libérale qui a gagné l’Afrique. Ces conditions ont coïncidé avec une crise aiguë multidimensionnelle vécue par le régime militaire en place qui était dans un isolement politique total et se débattait dans une crise économique profonde. Ce qui l’a amené à accepter immédiatement des orientations françaises d’Avril 1990 visant le changement dans sa forme pour éviter les conséquences de l’implosion politique.
C’est ainsi que le pluralisme est arrivé dans notre pays sous la pression de l’extérieur pour répondre à des besoins pressant du régime lui-même. Il s’agit notamment de dépasser sa crise et de camoufler ses crimes et ses violations des Droits de L’Homme qui ont culminé en 1989-91 durant toute la période d’exception et de conserver le pouvoir à travers des élections truquées.
Ce processus démocratique a été préparé unilatéralement sans aucune implication des forces et acteurs politiques dans le pays de manière à assurer au régime sa pérennité.
Ceci s’avère clair à travers les textes qui gèrent le processus démocratique. L’article 104 rajouté à la constitution, après le référendum, les textes relatifs à la protection de l’ordre publique et ceux organisant les élections promulgués dans des périodes précédent le processus démocratique, dont certains relèvent de la période coloniale, vident de fait la Constitution de son contenu.
Les élections étaient des mascarades pour pérenniser l’armée au pouvoir (Présidence de l’Etat, Présidence du Parlement, Direction des grandes entreprises économique du pays).
Cette période a été riche d’oppression, d’arbitraire, de confiscation des libertés publiques et des violation des droits de l’homme. Elle se singularisait par:
-La dissolution des partis d’opposition et le blocage des activités politiques des autres partis de l’opposition
-La censure de la presse indépendante et du barreau des avocats pour les museler
-Les multiples arrestations des dirigeants des partis politiques d’opposition et organisations de masse ( syndicats, etc. )
-Les arrestations et tortures d’hommes d’opinion
-Les massacres et tortures de citoyens innocents
-L’absence de neutralité de l’administration
-La carence de l’appareil judiciaire et l’inexistence de voies de recours.
-La gabegie, la corruption, le détournement des deniers publics, etc.
Cette période est marquée aussi par la détérioration du climat politique et économique par le régime à travers la réanimation des cadres tribaux et régionaux et le recrutement des chefs traditionnels comme ses clients politiques, et la transformation de l’appareil de l’Etat en une entreprise de corruption.
Les nominations, les services, avantages et toutes sortes d’intérêts publics sont conditionnés par le soutien au régime
Ainsi l’appartenance à la tribu a supplanté l’appartenance à l’Etat, ôtant à la loi son rôle et son pouvoir de protection et faisant du clientélisme le moyen de protection à la place des lois. Ce qui a conduit à la destruction de la notion et de la présence matérielle de l’Etat au niveau du citoyen, hypothéquant l’avenir du pays.
Les fraudes dans les élections ont fait perdre au citoyen toute confiance en celles-ci et en la démocratie.
Même si l’opposition parvient, par le biais des élections, à certaines places électives (députés ou maires), les portes resteront toujours fermées devant tout changement effectif car les institutions parlementaires et communales ne disposent d’aucune compétence réelle.
L’expérience des dernières élections a prouvé que le régime est incapable d’admettre l’opinion de l’autre car la présence d’un nombre limité d’élus au sein des institution de l’Etat l’a indisposé fortement. Que se passerait-il si l’opposition avait obtenu un nombre considérable d’élus au parlement.
Les réalités de la société et de l’opposition s’ajoutant à la volonté et au comportement du régime ont conduit le processus démocratique à de tels résultats.
La société, à cause de son sous-développement et de analphabétisme, était un instrument docile aux mains du régime et des chefs tribaux qui usent à la fois de séduction et de pression. Les partis d’opposition, du fait des conditions de leur création dans la précipitation et l’empressement, les multiples problèmes internes dont ils ont été l’objet, la faiblesse de leurs moyens matériels, leur jeune âge et leur incapacité à rassembler leurs efforts dans une action commune et continue, n’ont pas su transmettre suffisamment leurs messages aux masses, surtout en milieu rural, lequel constitue le vivier du régime et de ses alliés ; elle n’a, non plus réussi à influencer, de manière décisive, le « processus démocratique ».
Celui-ci, se trouvant dans l’impasse, toute ouverture d’horizons futurs est conditionnée par la capacité de l’opposition à unir ses efforts afin de créer les conditions favorables à une transition démocratique capable de se développer, non de tenter d’améliorer un processus en crise dés son départ.
Le parti APP a pris la décision de participer aux élections présidentielles, en présentant ma candidature.
Dans cette perspective, il est nécessaire d’œuvrer au sein de l’opposition pour que :
-le candidat du parti soit l’unique candidat de l’ensemble de l’opposition afin de sauvegarder l’unité de celle-ci ;
-Au cas où il y aurait pluralité de candidats, que prévale une bonne coordination entre eux;
-L’élaboration d’une stratégie d’actions communes de l’opposition pendant et après la campagne, ce qui suppose de travailler, ensemble, dans le cadre d’une vision, en partage, de l’alternance démocratique.
Octobre 2003
Je suis né de parents Haratines, c’est-à-dire de parents Noirs ( sûrement d’origine négro-africaine ), devenus esclaves des Arabo-berbères de race blanche ( communément appelés bidhanes ), auxquels ils ont été totalement assimilés du point de vue de la langue (le hassania – arabe dialectal), du mode de vie (nomade), de la culture et de la civilisation (avec, toutefois, certaines nuances tout à fait caractéristiques de leur très lointaines origines dont ils n’ont jamais plus gardé, dans leur écrasante majorité aucun souvenir). Je suis membre de la petite collectivité maraboutique dite AHEL TALEB ETHMANE , aujourd’hui encore recensée dans le département central de Néma.
Les rapports de mes parents avec leurs maîtres étaient des plus ambigus : statutairement esclaves, mes parents n’étaient cependant pas attachés directement à leurs maîtres et vivaient en totale autonomie par rapport à eux. Comme tous les Haratines de l’époque (et même aujourd’hui), ils vivaient d’agriculture (cultures fluviales de l’oued Fara el Kitane, justement), d’élevage et de cueillette. Mon père pratiquait aussi la chasse à courre et à la trappe. Ma famille n’était pas assez grande et était plutôt assez bien lotie : elle possédait une tente noire en laine de mouton, du mobilier traditionnel standard de l’époque, quelques têtes de chèvres et de moutons, des animaux de bât (surtout des ânes.) Elle était composée, outre le père et la mère, d’une sœur utérine, l’aîné des enfants et de trois frères germains dont je suis le deuxième.
Il y avait, en outre, mes deux grands-mères (maternelle et paternelle) un oncle maternel (plus âgé que ma mère) et une tante paternelle (plus jeune que mon père), qui constituaient la structure de ma grande famille.
Les péripéties de mon entrée à l’école française
Mon souvenir le plus lointain remonte à cette matinée de fin septembre ou début octobre 1950 où, alors que je me trouvais en compagnie de mon frère aîné au milieu de notre troupeau de chèvres et de moutons, je fus surpris de l’entendre presque crier ces mots , d’une voix pleurnicharde:
A peine avais-je eu le temps de me retourner, que je me vis arraché du sol par mon ravisseur, lequel, en quelques pas, poussé par le deuxième ravisseur resté sur la selle, partit en grandes foulées au milieu de mes pleurs et de mes cris ainsi que ceux de mon, frère. Ce dernier nous avait poursuivis, autant que le lui permettait son handicap inhérent à des séquelles de syphilis et le terrain particulièrement rocailleux parce que collinaire ; cependant, je ne pouvais pas l’apercevoir, masqué que j’étais par mon ravisseur qui bouchait mon horizon à l’arrière. Nos pleurs et nos cris se répercutèrent longtemps dans la vallée…
Plus tard, je devais apprendre mes ravisseurs n’avaient été perçus par personne d’autre que nous, malgré la proximité de notre campement, à peine distant de deux kilomètres. L’alerte avait été donnée par mon frère, longtemps après qu’il se soit exténué à nous poursuivre.
Notre seule consolation, mon frère et moi, si consolation ce jour là il pouvait y avoir, était que les ravisseurs étaient des membres de la collectivité et non des inconnus. Pour ma part, je n’avais aucune idée des raisons et des objectifs de mon enlèvement.
Ce fut sous la tente du chef de la collectivité, alors que son épouse s’acharnait vainement à me consoler en me tenant dans les bras, que j’entendis parler, pour la première fois, de l’école à laquelle on semblait apparemment me destiner.
Le lendemain matin, je fus rejoint à Néma, où j’étais arrivé l’après-midi de la journée de mon enlèvement par mère.
Elle engagea aussitôt une très vive dispute avec le chef et sa djemaa de bidhanes. Il fut beaucoup question d’école, là aussi, du refus catégorique de ma mère de m’y laisser inscrire. Ce fut grâce à l’intervention de la logeuse du chef (une habitante de Néma, qui connaissait donc la réalité de l’école) que ma mère se décida finalement à accepter de me conduire elle-même, entourée du chef et de sa délégation, auprès du directeur d’école, feu Samba DIALLO ( un malien ) pour mon inscription. Son espoir, avait-elle dit, était que
C’est ainsi que je fus le premier ressortissant de cette collectivité à être admis à l’école des blancs, l’école des français ; à l’époque, l’école était surtout réputée pour être celle des fils de chefs en particulier, de l’aristocratie en général. Si l’objectif déclaré de la puissance coloniale était de se doter de futurs auxiliaires et collaborateurs du terroir, la réalité inavouée était que ces écoles servaient surtout à masquer le recours honteux au système des otages.
Les chefs les plus turbulents et les plus récalcitrants étaient ainsi soumis au chantage exercé, sur eux, à travers leurs fils laissés en gage d’allégeance aux mains des « infidèles ».
Pourquoi moi et pas un autre… ?
L’école française était très mal perçue en milieu maure, où elle était assimilée à l’école religieuse catholique. C’est pourquoi, certaines familles maraboutiques, plutôt que d’y envoyer leurs propres fils, préféraient leur substituer des esclaves, ce qui, à leurs yeux, était tout à fait moral et normal. C’est ce qui explique, en partie au moins, le dévolu porté sur moi, ou plus exactement sur ma famille, car c’est elle que l’on voulait atteindre à travers moi.
En effet, ma famille était caractérisée rebelle et donc mal aimée par les maîtres bidhanes ; ceux-ci ne manquaient jamais une occasion pour le lui faire sentir.
Mes parents en général et ma mère en particulier ont toujours voulu s’assumer, se comporter comme des contrairement à leurs semblables du campement, qui sous prétexte de leur soi-disant infériorité naturelle, se laissaient aller à tous les abus, se dépersonnalisant jusqu’à l’animalité, comme aiment ainsi les voir leurs maîtres, soucieux de cultiver et d’entretenir la qui les séparent des esclaves.
Ma mère avait deux maîtresses, d’une famille très pauvre, voire misérable. Leur misère était telle que leur cousin avait tendance à les déconsidérer. Ma mère, plus par générosité que contrainte et forcée, s’était dépensée sans compter pour les soutenir, veillant à ce qu’elles soient nourries, habillées et entretenues convenablement, comme il seyait à leur position sociale. Elle s’était tant et si bien occupée d’elles que l’aînée des sœurs finit par être épousée par le chef de la collectivité.
Contrairement à toute attente, la nouvelle reine, au lieu d’être reconnaissante envers son obligée servante, n’avait plus cessé de la jalouser et de la combattre. Elle réussit même à faire adhérer, à sa jalousie et à sa haine, ses cousins les plus proches, qui convinrent, un jour, d’une expédition punitive contre ma famille. Ma mère fut purement et simplement lynchée en public et quasiment laissée pour morte, baignant dans son sang au milieu des flammes et de la fumée. Sa tente et tout son mobilier avaient été incendiés, ses animaux soit abattus, soit répartis entre les agresseurs, ses perles précieuses détruites ou redistribuées, etc. Se fut un véritable carnage.
Revenue à la vie, sans rien changer à son état de délabrement physique et vestimentaire, elle s’était rendue à Néma pour se plaindre à l’administration coloniale. Cette dernière, bien que se rangeant rarement du coté des esclaves ou des Haratines, victimes des mauvais traitements de leurs maîtres, tuteurs ou simplement en rupture avec eux, face à l’atrocité des blessures de ma mère sur laquelle ses tortionnaires s’étaient acharnés sans aucun scrupule, avait non seulement exigé de réparations immédiates (restitution et remboursement des biens détruits ou disparus) mais également décidé que la plaignante, ainsi que toute sa famille, seraient dorénavant libres de toute sujétion.
Il fut suggéré à ma mère de s’installer à Néma, pour éviter d’éventuelles représailles, ce qu’elle rejeta, fermement décidée qu’elle était à s’assumer et s’imposer dans son milieu.
C’est ainsi que ma famille, pour prix du sang versé par ma mère, fut la seule femme Haratine de sa collectivité à bénéficier, à l’époque, du statut administratif de « famille », à être recensée distinctement des maîtres bidhanes, donc à payer ses impôts… C’était en 1942 ou 1943. On dit qu’au temps où se déroulaient ces événements, j’étais âgé de 12 mois.
Rebelle et indépendante mais poursuivie par la haine d’une femme influente, ma famille était donc une proie toute désignée…
Il est à noter pour l’histoire mais aussi pour la morale de cette affaire, que l’instigatrice de l’expédition punitive contre ma famille est morte, il y a quelques années, sur le lit de mon jeune frère ; les dernières années de sa vie ont été exclusivement consacrées au service de notre famille. Elle y a joué tous les rôles : mère protectrice, sœur, fille, et … esclave. Quant au plus féroce de ses cousins, il est actuellement installé à Médine où il s’était rendu depuis cette affaire, fuyant ainsi les sanctions administratives. J’ai abrogé en moi, toute haine et tout esprit de revanche, de mon pèlerinage en 1984.
Il m’a accueilli comme un fils et m’a entouré de tous les soins, y compris celui de me masser en personne malgré mes vives et sincères protestations.
S’agissant maintenant du ravisseur qui m’a arraché du sol, il me rend jusqu’ici visite à Nouakchott, chaque fois qu’il y est de passage, le deuxième étant décédé peu de temps après l’enlèvement.
Ma vie d’écolier…
A l’époque il n’y avait que deux écoles, de trois classes chacune, dans toute la région. L’une était installée à Timbédra et l’autre à Néma, les deux villes étant distantes d’une centaine de kilomètres. Les trois classes de école correspondaient respectivement au cours préparatoire (2ans), et au cours moyen (2ans).
A l’école de Néma que je fréquentais, il y avait une cantine scolaire pour les élèves venus de la brousse comme moi. Nous y avions droit aux trois repas du jour : petit déjeuner, déjeuner et dîner ; nous avions droit aussi à une tenue une ou deux fois en année scolaire composée d’un boubou et d’un saroual en percale blanche. Nous logions en ville chez les correspondants de nos familles, voire de nos tribus.
Ma correspondante était une femme assez âgée, de la tribu des Tadjekante. Elle avait sa maison dans le quartier de Néma, dénommé Délouba. Elle était veuve ou divorcée et vivait seule avec son fils âgé de 25 à .30 ans, souvent malade et absent. Nos enseignants étaient surtout des africains : sénégalais, maliens et mauritaniens. Le régime scolaire était très sévère. Nous étions battus par les maîtres. Le châtiment était parfois des plus atroces.
Je n’avais comme encadrement que celui des maîtres, quand j’étais en classe. Ma logeuse était incapable de m’encadrer, d’abord parce qu ‘elle n’en avait aucune envie et ensuite parce qu’elle me voyait très rarement. Coupé brutalement de mes parents, de leur amour, de leur chaleur, du contact des proches et des amis, j’avais très tôt ressenti tous ces besoins, d’où ma tendance à changer souvent de correspondant, recherchant de nouveaux amis, la chaleur et l’amour perdus, etc.… Je n’étais pas un mauvais élève, mais seule la peur du châtiment corporel m’astreignait à une certaine assiduité ou sérieux. A mon âge, dans mon isolement, ma solitude, mon abandon et au milieu de l’indifférence général, il n’y avait que cette peur pour me guider, me conseiller, me raisonner, me tenir compagnie.
Ma scolarité primaire s’était déroulée normalement seulement entrecoupée par le décès de ma mère, en septembre ou octobre 1953 ou 1954, puis de mon père en mai ou juin 1954 ou 1955.
Bien évidemment, j’avais ressenti très douloureusement ces pertes et j’avais dû les affronter seul, sans presque personne pour me consoler.
Dans le désarroi et la solitude de mes pensées puériles, j’avais décidé de ne plus adorer cet Allah (qu’Il me pardonne). Qui, coup sur coup, m’ôtait subitement le seul sentiment de réconfort que j’avais, à savoir : revoir de temps à autre mes parents. C’est en 1967, à l’âge de 24 ans, que j’ai levé cette mesure…
J’ai obtenu mon C.E.P.E. (Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires) en 1956 et réussi mon admission au concours d’entrée en sixième en 1957.
Mon expérience au Collège Xavier Coppolani à Rosso (Sud-ouest de la Mauritanie) a été de courte durée.
L’entière liberté découverte au Collège y avait beaucoup contribué : liberté de sécher les cours, liberté de répartie au professeur, liberté de fumer, d’entrer, de sortir, de faire ce que je voulais… C’est-à-dire tout ce dont j’avais été frustré à l’école primaire. Mon enfance brisée, comprimée, confinée n’a pas tardé à resurgir à la première occasion.
C’est ainsi qu’après avoir redoublé ma sixième, je fus exclu définitivement à la rentrée scolaire 1959/1960. Bien que reconnaissant tout à fait ma part de dans cette exclusion, je demeure convaincu aujourd’hui que si j’avais été bidhane, elle m’aurait été évitée.
Comme un malheur ne vient jamais seul, ce fut également au cours de cette même année que je perdis mon unique sœur, foudroyée sous notre tente. C’était elle qui, courageusement, avait pris le relais de papa et maman. Elle laissait derrière elle deux petites filles âgées respectivement de trois ans et d’à peine une année.
Le terrible retour du bâton…
Le choc de mon renvoi avait été terrible. Brusquement j’avais réalisé que mon expérience d’écolier avait été un échec total et donc une très grande déception pour les miens et pour moi ; au fil des ans, en effet, nous nous étions fait à l’idée que ma scolarité n’était pas, après tout, une mauvaise chose. Chacun s’était habitué à y voir un signe du destin. Certes ma mère n’était plus là pour partager notre douleur et notre déception, se rendre compte par elle-même combien ma honte était grande, combien je me méprisais et me haïssait : j’avais réalisé tout à coup que j’étais seul responsable de ce qui m’arrivait. Cette culpabilité devenait d’autant plus insupportable que je m’étais trouvé sous la hantise de la trahison de la mémoire de ma mère. Psychologiquement, j’avais côtoyé la mort de très près, la mort que j’entrevoyais comme la seule façon de fuir la honte et l’humiliation.
Je ne saurai sûrement jamais par quel miracle j’ai pu survivre à cette terrible épreuve de mon renvoi du collège alors que cette mesure était, à mes yeux, synonyme déjà de la mort… pas plus que je ne comprendrai peut-être jamais pourquoi, après avoir lâchement rejeté cette mort, ma vie n’a plus été qu’une succession de défis…
L’éveil ou la prise de conscience…
Dorénavant véritablement seul, ne connaissant pratiquement personne, jeune, novice, très peu crédible et, ce qui n’était pas pour me faciliter les choses, hartani de surcroît, je n’avais pas d’autre alternative que de surnager ou périr. M’imposer, me faire accepter, me faire respecter devint une obsession…
Je compris très vite que cette ambition démesurée pour mon âge et mon niveau et cette rage insatiable d’exister véritablement passaient d’abord et avant tout par moi-même : Il fallait que je m’assumasse pleinement, que j’aie confiance en moi-même, que je m’imposasse obligatoirement à tous. Pour cela, il fallait être cultivé, sérieux, compétent, travailleur, honnête, juste et droit ; ne pas mentir, ne pas médire, s’élever au-dessus des bassesses, ne jamais s’y impliquer, être courageux et même au besoin téméraire. Etre un adolescent parfait en attendant d’être un parfait homme, voilà ce qu’il me fallait pour être accepté par les autres, à défaut de pouvoir m’imposer à eux !
Mon combat a donc toujours été contre moi-même avant d’être contre les autres : Sortir coûte que coûte du néant, de l’anonymat, de l’inexistence !
Ma soif de culture générale, celle de la vie en particulier, ne trouva à s’étancher qu’à travers la lecture qui fut, pendant de très longues années, mon passe-temps favori. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main et j’écoutais beaucoup la radio, attentif à tout ce qu’elle pouvait diffuser. J’étais tout à fait attentif à écouter les autres surtout quand ils font étalage de leurs connaissances et de leurs expériences quelles qu’elles soient.
Une carrière administrative vite commencée…
Je fus, à la suite d’un petit test de sélection, retenu pour remplir des tâches de bénévole au secrétariat du Cercle de Néma, immédiatement après mon exclusion. Très vite donc le chef du secrétariat du commandant de cercle put se décharger sur moi en ce qui concerne de nombreuses tâches courantes : enregistrement du courrier, dactylographier du courrier non confidentiel, etc.
En décembre 1959, un concours direct fut ouvert au niveau national pour le recrutement de commis ou secrétaires d’administration. J’y participais naturellement avec toutefois un coup de pouce du Commandant de cercle français de l’époque qui avait accepté mon inscription parmi les candidats alors que je n’avais pas l’âge requis de 18 ans. L’opération avait consisté à informer, par message radio, de ma candidature en spécifiant que le dossier suivrait.
Le concours se déroula le 10 décembre sur toute l’étendue du territoire. Il fallait cependant attendre presque sept longs mois avant d’apprendre les résultats. Ce n’est qu’en juin ou juillet 1960 que l’arrêté proclamant les résultats et portant affectation des admis parvint à Néma. Je faisais partie des heureux élus et j’étais muté à Atar, en Adrar, à l’autre bout du monde, dans le nord tout à la fois craint et abhorré par les populations du sud-est de la Mauritanie à cause de ses rezzous meurtriers et surtout à cause de ses rafles d’esclaves qui n’ont jamais visé que les Haratines.
J’arrivai donc à Atar le 21 juillet 1960. J’étais plus que jamais désemparé, désorienté, complètement isolé et perdu jusque pour moi-même dans un environnement et parmi un monde à la fois inconnu et qui, de surcroît, me faisaient peur.
Présenté au Commandant de cercle, Monsieur Vésy, un français aussi, celui-ci s’était exclamé : > Il m’avait accordé trois jours de repos, peut-être pour me remettre des fatigues du voyage particulièrement éprouvant par la route à l’époque, mais peut-être aussi pour me donner le temps de me remettre de mes émotions.
L’indépendance du pays fut proclamée quelques mois après : le 28 novembre 1960. Les compétences des autorités administratives – commandants de cercle, adjoints et chefs de subdivision- furent transférées peu après à des administrateurs nationaux Bidhanes et Négro-africains.
Affecté à la subdivision centrale d’Atar, je m’étais retrouvé sous les ordres à la fois du chef de subdivision et d’un secrétaire plus ancien et plus expérimenté que moi ; tous deux étaient des Bidhanes. Au bout de quelques mois (je n’ai aucune idée de leur nombre) je m’étais retrouvé seul face au chef de subdivision et surtout face à mes responsabilités, le premier secrétaire ayant été muté au cabinet du commandant de cercle, au premier et seul étage de la bâtisse qui abritait les deux administrations territoriales.<br><br>
…et très mouvementée…
Le premier défi existentiel me mit aux prises avec le commandant de cercle de l’Adrar lui-même, feu Ibrahima KANE, à Atar.
Un garde très fouineur et très envahissant lui ayant rapporté que > il m’avait convoqué dans son bureau et avait exigé que je lui présentasse mes excuses devant témoins : le commandant de la brigade de gendarmerie (un français encore) et le garde en question.
Ayant considéré que la manière et la forme étaient trop vexatoires, voire humiliantes, j’ai refusé net de présenter mes excuses et ce après avoir confirmé les propos rapportés par le garde. Il me renvoya sèchement de son bureau en me traitant de tous les noms et m’interdit de remettre les pieds dans les lieux, jusqu’à nouvel ordre.
J’étais stagiaire et mon renvoi était quasiment automatique, mais je l’avais préféré à l’humiliation.
Il mit un point d’honneur à me faire revenir sur ma position, alternant les pressions extérieures et les siennes, la persuasion et les menaces, le tout en vain.
A l’issue d’une ultime convocation et constatant qu’il ne m’impressionnait pas du tout, il m’avait enjoint de rentrer chez moi en me tenant ces propos : >
Une ou deux années après ce généreux conseil, je fus muté par décision de Nouakchott dans le sud du pays, dans le Brakna, à Boghé.
Le désappointement du commandant de cercle avait été tel qu’il m’avait sommé de quitter Atar, le lendemain même. La providence fit qu’il tomba la même nuit une très forte pluie (on était en août 1962) qui provoqua la fermeture de la seule piste ou route. Informé de ce contretemps, le commandant de cercle décida de me céder sa place dans l’avion qui partait le même jour, mettant un point d’honneur cette fois à me faire >
Venu à l’aéroport, accompagné de son épouse, pour me voir embarquer dans l’avion en partance pour Nouakchott, il fut certainement surpris de me voir venir à eux et de m’entendre dire, en lui tendant respectueusement la main :
Il avait retenu ma main et m’avait dit :
Pourquoi cette réaction de ma part ? La réponse, je l’ai déjà donnée plus haut : Mes défis et mes combats ont toujours été contre moi-même, pour me forger un caractère, une personnalité, être un homme, atteindre mes propres limites. Je n’éprouve généralement ni haine ni rancune pour mes contradicteurs, car dans mon esprit ils n’ont occupé qu ‘une place tout à fait secondaire, fortuite, par rapport à celle, très principale, permanente, qu’occupe mon Ils ne sont pour moi qu’un champ expérimental, jamais recherché mais rencontré, par hasard…
Je surprends toujours ceux qui me connaissent par mes colères orageuses qui tombent aussi vite qu’elles apparaissent.
A Boghé et Aleg, de 1962à 1968 (avec toutefois une interruption de 6 mois de stage à Nouakchott), à Aïoun et Atrouss, de mai ou juin 1968 en décembre 1969 et à Tichit, de mars en décembre 1970, j’ai eu de nombreux défis à relever face aux différentes autorités administratives sous les ordres desquels j’avais été successivement placé. Les frictions nombreuses que j’ai eues tout au long de ma carrière administrative étaient toutes inhérentes aux mentalités de mes chefs tous issus de milieux aristocratiques ou bourgeois- qui avaient tendance à ne voir en moi qu’un esclave secrétaire. Mon âge et ma condition sociale les y encourageaient objectivement.
Mes réactions les surprenaient et les révoltaient toujours, considérant ma fierté, mon assurance et le sentiment général de liberté et d’aisance que je dégageais, pour de l’arrogance.
Il me souvient par exemple qu’ayant un jour fort contrarié mon chef, le préfet feu Cheikh DIALLO, dans son bureau, il était allé jusqu’à menacer de me gifler si je répétais le propos en cause. Sans aucune hésitation, je l’avais répété. Le préfet s’était levé fou furieux de son fauteuil, avait fait le tour de la table, s’était planté devant moi et avait levé le bras pour apparemment m’asséner la gifle promise. Il avait hésité une fraction de seconde et avait rabaissé le bras, l’index pointé en avant et, l’appuyant légèrement sur ma tempe, s’était étonné :
D’un amour propre très chatouilleux, j’avoue de côté qu’il m’est souvent arrivé de me formaliser pour des rien, y percevant parfois une volonté maligne de la part de mes contradicteurs, ce qui ne saurait être toujours vrai.
Parfois aussi certains abus délibérés de mes chefs, envers les administrés, généralement des haratines dans ces cas, m’avaient poussé à engager ouvertement les hostilités.
A l’issue du stage effectué à Nouakchott entre 1964 et 1965, nous étions 10 à être reçus au concours de fin de stage et promus au grade de rédacteurs de l’Administration générale (cycle B) pour compter du 1 janvier de l’année suivante (1966.) J’avais été reçu major de la promotion, ce qui ne m’épargna pas, cinq ans après, à Maghama, au Gorgol, de me retrouver sous les ordres d’un promotionnaire catapulté préfet alors qu’il était classé sixième de la promotion.
Lui, bien évidemment était d’une famille aristocratique (chef d’une tribu) alors que moi je n’étais qu’un fils d’esclave.
Mes vigoureuses protestations écrites eurent pour conséquence mon affectation, en juillet 1972, en qualité de chef d’arrondissement d’une localité sans population et sans eau, Temessoumitt (département de Moudjéria) au point d’intersection des régions de l’Adrar, du Trarza et du Tagant dont elle dépend administrativement.
Cette promotion, parce qu’elle était tardive et au n’avait réussi qu’à renforcer en moi le sentiment d’injustice et de discrimination que j’ai toujours au contact de l’Etat et de ses représentants.
Contraint et forcé de résider à Moudjéria, j’eus des problèmes avec mon chef direct, le préfet du département, feu Ismaïl Ould ABOUMEDIANA. Mis au courant de la situation qui prévalait entre nous, le pouvoir central me muta à Ouadane, en Adrar, un arrondissement perdu lui aussi dans le désert, mais beaucoup plus vivant que Temessoumit.
En mars/ avril 1975, je fus convoqué à Nouakchott pour suivre un stage de perfectionnement (recyclage) de quatre mois à l’issue duquel je devais être enfin nommé préfet. Une fois à Nouakchott j’appris que ce recyclage était parallèle à un autre de même durée qui préparait au concours d’entrée au cycle A Court de l’E.N.A. (Attachés d’administration générale) je fis aussitôt part au ministère de l’Intérieur de mon souhait de préparer le concours d’entrée à l’ENA.
Le ministre en personne me convoqua et tenta de me persuader de ne pas renoncer à ce pour lequel il m’avait convoqué, allant même jusqu’à me rappeler que je n’étais pas sûr de réussir mon entrée à l’école Nationale d’Administration. La pression était de taille, mais je la balayai en ces termes : > Voyant qu’il prêchait dans le désert, il utilisa son ultime arme en exigeant de moi une démission écrite du corps de commandement. L’objectif de la manœuvre était clair là aussi : En cas d’échec au concours d’entrée, il ne serait plus question de me reprendre dans le commandement et ce serait par ma seule faute.
J’acceptai néanmoins de lever le défi en signant ma démission.
Le résultat fut qu’à la rentrée, un cycle nouveau, le cycle A Long (Administrateurs civils bilingues) était introduit à l’ENA. Les conditions pour y entrer était pour le professionnel que j’étais, les mêmes que pour le cycle A Court. Le concours direct concernait quant à lui les bacheliers. Je passai donc les deux concours et je fus reçu aux deux. J’optai pour le A Long, malgré les matières arabes et les mathématiques qui occupaient une part non négligeable de l’enseignement qui y est dispensé et mes limites certaines en ces matières.
La promotion, les premières, ne comptait que dix étudiants dont neuf bacheliers et moi. La scolarité dura quatre ans. A la sortie, j’avais été classé 3ème de la promotion et je fus immédiatement promu adjoint au gouverneur du district de Nouakchott, chargé des affaires administratives.
Quatre mois après, je fus nommé préfet central à Rosso où j’eus trois épreuves de force avec les trois gouverneurs qui se sont succédé durant la seule et unique année effectuée en charge de ce département.
Je fus ensuite promu gouverneur de la région de Gorgol (Kaédi) le 1er janvier 1981. J’y suis resté jusqu’au 10 octobre 1984 et j’eus , là aussi, à relever des défis importants contre des proches du chef de l’Etat Mohamed Khouna ould HAIDALLA ; il s’agissait en l’occurrence du commandant Mohamed Lemine ould ZEIN, alors membre du Comité Militaire de Salut National et président de la Commission régionale de ma région et du capitaine MOULAYE Hachem en charge du Commissariat à la sécurité alimentaire.
J’eus également à critiquer ouvertement, dans mes rapports officiels, la politique du Gouvernement. J’ai enfin, en deux occasions au moins, fait part directement de ces critiques au chef de l’ Etat lui-même, au cours des deux seules audiences qu’il m’ait accordées, une fois à Kaédi et une deuxième fois à Nouakchott.
Une fois, au cours d’un déjeuner offert par le même chef d’Etat aux gouverneurs des régions j’eus, durant tout le temps passé avec lui, à lui apporte seul, en présence de tous les gouverneurs, du Premier Ministre (l’actuel chef de l’Etat) et de quelques membres du CMSN, la contradiction à propos de son protégé Moulaye HACHEM, également présent. Le défi était de taille, car jusque là personne n’avait osé parler au président Haidalla comme je l’avais fait.
L’une de mes nombreuses satisfactions morales (j’en rends grâce à Allah) sera certainement le jour où je fus convoqué par le permanent du CMSN, alors que j’étais de passage dans la capitale, pour me féliciter et m’encourager à propos d’un rapport très critique dont une ampliation lui avait été adressée :
Muté en octobre 1984 dans la région du Guidimakha, à Sélibaby, je n’eus pas à y effectuer trois mois complets parce que je fus nommé ministre du développement rural dans le gouvernement issu du coup d’état du 12 décembre 1984, qui vit l’avènement du président actuel, le colonel Moaouya 0uld Sid Ahmed TAYA.
Je fus le premier Hartani revendiquant sa hartanité et la brandissant comme un étendard , à accéder à toutes ces hautes fonctions dans le pays.
Mon entrée dans le gouvernement en 1984 ne devait rien changer à mes comportements, mes relations et mon engagement. Je me suis assez souvent opposé à des points de vue du chef de l’Etat, suscitant tantôt sa colère et tantôt son revirement et son sourire et ceci qu’on soit en conseil des ministres ou seul à seul.
J’ai en effet toujours considéré que s’abstenir de dire ce que l’on ressentait et surtout ce que l’on croyait était le summum de la lâcheté et de l’hypocrisie.
C’est ainsi que convoqué par le chef de l’Etat en 1986 après la publication du Manifeste négro-africain, j’ai usé de tout mon tact pour tenter de le décolérer . Ma démarche avait consisté surtout, avec force arguments, à lui banaliser la situation. Je lui avais aussi rappelé son devoir de chef de l’Etat qui lui commande, quoi qu’il arrive, de rester serein et d’éviter de se mettre en colère.
Je suis toujours resté sourd aux thèses racistes de plus en plus affichées, et parfois ouvertement… Je me suis ouvertement opposé à la destitution d’un collaborateur négro-africain, accusé d’appartenir aux Flam et ce en mettant en jeu ma fonction de ministre.
J’ai enfin ouvertement et clairement dit mon opposition à la politique anti-négro-africaine que je voyais se dessiner et j’ai même mis en garde le ministre en charge de l’Intérieur de l’époque contre un dérapage à l’exemple de celui commis par Sékou TOURE de Guinée vis-à-vis des Peuls. L’idée que mes propos seraient rapportés tels quels au chef de l’Etat ne m’impressionnait guère, bien au contraire…
Sur un autre plan, j’ai par exemple refusé de recevoir le frère aîné du chef de l’Etat (qui fait la pluie et le beau temps) soucieux que j’étais de lui faire comprendre, qu’en ce qui me concernait, il reste un citoyen ordinaire…
C’est après avoir vainement tenté de m’instrumentaliser, que j’ai été renvoyé du gouvernement le 18 mars 1988
J’ai donc quitté le gouvernement la tête haute, très bien coté par l’opinion nationale et sans avoir jamais été impliqué dans la moindre affaire sale ou douteuse.
Cette popularité n’a pas semblé n’a pas semblé être du goût du pouvoir, car que peu de temps après, dans le souci de ternir mon image de marque, voire de me briser définitivement, il m’intenta un procès devant la Cour suprême pour… On me reprochait, disait-on, d’avoir ordonné la cession gratuite d’un tonnage d’aliments pour bétail alors qu’il aurait dû être vendu. Je fus condamné à une amende d’environ 100 000 francs français que je n’ai jamais acquittée (je n’en ai pas les moyens), peine tombée en désuétude, à cause du délais de prescription.
Le régime actuel, c’est un secret de polichinelle, s’accommode difficilement des idéalistes ou simplement des gens de principe.
Ma vocation de militant anti-esclavagiste
C’est mon oncle maternel qui, alors que j’avais l’âge de 10 ou 11 ans et que j’assistais, durant les grandes vacances scolaires, au recensement de la tribu, en m’informant des injustices que subissait ma famille en matière d’imposition notamment en me demandant d’en référer au chef de subdivision – un français – dans l’espoir de l’amener à redresser la situation, a susciter ma révolte contre l’injustice en même temps que ma prise de conscience du problème de mes semblables haratines.
Mes parents ne vivaient plus et mon frère aîné était absent. Notre sœur était une femme et n’avait pas le même nom de famille que le nôtre. J’étais donc le mieux indiqué pour m’occuper des intérêts des miens et ce d’autant plus que je parlais la langue, tant bien que mal.
Je fis part au commandant de ce dont m’avait fait part mon oncle ; il m’avait écouté attentivement, sans broncher ; nous nous regardions dans les yeux…
A la fin de mon exposé, il me fixa encore quelques secondes avant de m’enjoindre sèchement : «Sors… Sors, espèce d’impoli ! >>
J’étais bien évidemment sorti sans protester mais profondément humilié et révolté par tant d’injustice vis-à-vis de ceux qui ont soif de justice et ne demandent qu’elle.
C’est à partir de ce jour là aussi que j’ai souhaité intensément occupé la même responsabilité que ce commandant.
Ce n’est que 15 ou 16 ans après, lors d’un démêlé avec l’un de mes chefs alors gouverneur à Aouin el Atrouss, qui me reprochait de le regarder dans les yeux, que je compris la raison de mon éconduite par le gouverneur français : je n’avais pas cessé de le fixer dans les yeux, ce qui, à mon âge, avait été considéré par lui comme une effronterie inadmissible.
Pourquoi ce commandant n’avait-il pas jugé, au lieu de cela, que j’étais tout simplement un enfant fasciné par le bleu de ses yeux ?
Voilà comment tout est parti : L’injustice subie à mon corps défendant et ma prise de conscience qu’au-delà de ma petite personne et de ma petite famille, elle est subie par des centaines de milliers d’individus que le hasard de la vie a placés en situation d’infériorité par rapport à d’autres individus.
Il s’imposa donc naturellement à moi, pour que j’existe véritablement, de m’investir dans le combat pour la liberté de mes semblables, contre tous les préjugés, d’abord à mon propre niveau en me comportant en homme libre et en homme de bien et ensuite au niveau de la société toute entière en faisant comprendre aux laissés pour compte qu’ils ont les mêmes droits que tous les autres, qu’ils n’ont réellement rien de plus que ceux qu’ils piétinent.
Dans mon obsession de culture, j’étais tombé par chance sur certains livres qui traitent des problèmes d’inégalité aux Etats-Unis et en Afrique du Sud et des combats qui y étaient menés. Je compris que dans mon pays il fallait livrer le même combat. C’est ainsi que dès 1962 et alors que j’étais en poste à Boghé, j’ai commencé à conceptualiser le combat que je mène encore aujourd’hui. Mes réflexions de l’époque sont encore aujourd’hui consignés dans des cahiers.
Mais mon combat était personnel, solitaire, intellectuel, et rares étaient ceux qui en avaient connaissance.
Lorsqu’en 1978, à l’ENA je fus pressenti par quelques autres haratines pour réfléchir sur notre situation, j’étais surpris et même étonné que d’autres que moi aient à cœur le même problème. En quelques jours, nous avions formé EL HOR dans la clandestinité. Son premier tract intitulé > est justement un extrait de mes cahiers. Il a été dactylographié et multiplié par moi-même. Ce titre devait d’ailleurs longtemps supplanter le nom réel de l’Organisation : EL HOR (Organisation de Libération et d’Emancipation des Haratines. Jusqu’ici, nombreux sont ceux encore qui nous affublent de >
L’inexpérience du jeune mouvement devait conduire très tôt à l’arrestation quasi générale de ses membres fondateurs et un grand nombre des ses activistes à la suite d’une manifestation organisée à Atar pour protester contre la vente d’un esclave.
Ce fut une période particulièrement éprouvante pour moi sur le plan moral et psychologique.
Alors que j’étais en poste à Rosso, les nouvelles des arrestations de mes camarades me parvenaient au jour le jour, grâce au directeur régional de la sûreté, un commissaire de police connu pour être particulièrement dangereux et magouilleur. Je compris évidemment que cet excès d’informations procédait d’ordre supérieur dont l’objectif était d’assurer ma surveillance. Plusieurs fois par jour r même tard dans la nuit, il trouvait le moyen de faire irruption dans mon bureau ou dans mon domicile pour soi-disant m’apporter des nouvelles fraîches.
Il s’agissait plus sûrement d’éprouver mes nerfs jusqu’à l’extrême.
Un jour, n’en pouvant plus, je ne pu résister à la force qui me poussait à décrocher le téléphone et à appeler le gouverneur de Nouakchott, un militaire dont j’étais il y a quelques semaines le premier adjoint, pour l’interpeller en ces termes : >
Très cordialement, mon interlocuteur avait répondu à peu près en ces termes : > Il mentait sur toute la ligne : Non seulement les arrestations avaient continué, mais comme je devais l’apprendre par la suite, les simples interrogatoires avaient été, pour certains camarades, de véritables séances de tortures. Le camarade Ahmed Salem Ould DEMBA devait, à cause de ces tortures, perdre partiellement la raison ( décédé , il y a à peine deux mois).
J’étais donc seul, isolé, sans aucun contact avec qui que ce soit du groupe dont la stratégie était d’isoler, pour sa sécurité, tout membre actif dans les rouages de l’Etat. J’étais donc isolé depuis ma sortie de l’ENA.
Un soir je me décidai à faire partager à mon épouse, une militante du Mouvement, l’objectif de mes soucis : >
Mon épouse ayant persisté, malgré mon insistance, dans son refus de donner son propre avis, acceptant et s’en remettant entièrement à mon choix, quel qu’il soit, je choisis de rester.
Le harcèlement du commissaire de police se poursuivit… Il ne prit fin que qu’ au moment où, excédé, j’eus à mettre les choses au point, à ce même commissaire, en présence du gouverneur du Trarza, un militaire de surcroît. Cette mise au point avait consisté à afficher, haut et fort, ma « hartanité », d’exprimer ma solidarité aux amis arrêtés, de dire au commissaire que « je l’em…, lui enjoins de cesser de m’importuner et advienne enfin que pourra ! »
Ma décision de rester et de subir le même sort que mes camarades m’avait ôté toute crainte, et il me brûlait de précipiter mon arrestation que je considérais inéluctable de toute façon.
Les allées et venues du commissaire avaient cessé net.
Quelques temps après, un convoi de véhicules de la gendarmerie pénétra dans la cour de ma résidence. D’abord surpris, je fus étonné d’en voir descendre, outre plusieurs gendarmes en uniforme et armés, tous mes camarades arrêtés et visiblement pas si mal en point que cela. Je vins à leur rencontre, les embrassant chaleureusement les uns après les autres. Laissant le reste de ma famille s’affairer à leur aménager où s’installer, je me rendis personnellement au marché de bétail de la ville et j’en rapportai deux grands et gros moutons à sacrifier à leur intention.
C’est bien plus tard que je compris qu’on les amenait à Rosso pour leur procès. Dans l’après-midi, ils devaient me quitter pour leur centre de détention : le camp de la gendarmerie.
Je n’ai par contre jamais compris pourquoi on leur fait cette halte dans ma résidence ?
Bien que n’y étant pas tenu, je me fis un devoir d’assister à tout le procès, assis au banc du gouvernement. Le président du tribunal – c’était un tribunal militaire – prit un malin plaisir à les questionner de temps à autre à mon sujet : « Me connaissait-on ? , M’avait-on rencontré ? Avait-on entendu parler de moi ?…»
A deux ou trois reprises je fus surpris par des membres de la Cour en flagrant délit d’encouragement par le signe à certains accusés. Enfin, dans certaines de ses interventions, l’accusation eut à me désigner, elle aussi, du regard ou d’un geste, pour réfuter ce dont la défense l’accusait à savoir : « Une chasse effrénée aux haratines ! »
Je suis toujours resté très calme et j’ai même osé interpeller l’avocat général s’agissant de ses allusions à ma personne, dans les coulisses évidemment.
Cette parenthèse fermée, ma lutte a continué, comme par le passé, à mon propre niveau, puis au niveau des haratines que je rencontrai de plus en plus dans le cadre de mes activités professionnelles, mais aussi à travers mes rapports périodiques d’autorité administratives. Ma principale préoccupation, vu les fonctions dorénavant les miennes, était de devenir un exemple de compétence, de droiture, de patriotisme, de courage et d’humilité, non pas pour une quelconque gloriole personnelle, mais bien au contraire pour les Haratines, car il était important pour leur devenir que leur symbole, l’œillère à travers laquelle on les verrait dorénavant tous, fût irréprochable.
Quand j’ai été déchargé du service actif de l’Etat, j’ai attendu tranquillement que mes camarades de El Hor se manifestent. Je ne voulais pas, prendre moi-même l’initiative de me présenter à eux par peur d’être taxé de vouloir m’imposer en leader ou de servir du Mouvement à des fins égoïstes et de… je ne sais quoi encore, toutes choses que je suis dans l’incapacité de supporter.
C’est en 1989, lorsqu’ils optèrent pour une candidature haratine à l’élection municipale de Nouakchott, qu’ils reprirent contact avec moi, me demandant de me porter candidat au nom du Mouvement.
Puisque ces élections intervenaient après les tragiques événement « sénegalo-mauritaniens » avec les conséquences que l’on sait, elles ont été pour mon Organisation et pour moi-même l’occasion d’affirmer haut et fort notre position par rapport à tout cela. Nous avons défendu et soutenu les justes revendications des populations négro-africaines : leur droit à la vie, à la citoyenneté, au sol, à l’égalité, à la différence culturelle, etc. En vérité, après les événement de 1989 El Hor, par ma voix, était l’unique Organisation nationale à défendre publiquement les droits des négro-africains. Personne à l’époque n’avait même osé évoquer leur existence, sauf par tracts.
C’est notre position sans équivoque qui est certainement à l’origine de la levée de bouclier qu’a suscité ma liste combattue ouvertement par le régime. Malgré la fraude massive et les malversations, elle réussi néanmoins à faire élire dix conseillers municipaux sur 37.
En guise de protestation, je n’ai jamais accepté de siéger au dit conseil.<br><br>
Lorsque la nouvelle des exécutions extrajudiciaires a été connue, El Hor par ma voie a, publiquement et par tract, pris fait et cause pour les victimes et dénoncé énergiquement cet état de fait. Enfin, dans la vague de contestations qui a suivi, nous avions toujours occupé une place centrale. C’est notamment à notre initiative qu’a été crée le FUDC ( Forces Démocratiques Unies pour le Changement).
Lorsque les militaires, pressés par les événements, furent contraints de jouer à « l’ouverture démocratique » je fus convoqué par le chef de l’Etat qui visiblement voulait que je me range de son côté dans cette nouvelle perspective. Mon Organisation et moi avons répondu par un non catégorique, en demandant publiquement la démission pure et simple du chef de l’Etat et ce à cause principalement des crimes commis au préjudice de la communauté négro-africaine à savoir : assassinats, massacres, torture, spoliation et déportation…
Détenu en même temps que les fondateurs du FDUC (de mai-juin 1991 à fin juillet 1991), je participais, activement, à la création de UFD ( Union des Forces Démocratiques) dont je fus le premier secrétaire général.
La difficile cohabitation avec des opposants de dernière heure finit par me décider à quitter ce parti ( où j’ai été sauvagement combattu par ceux-là même que j’ai contribué à rapprocher) pour fonder en 1995 Action pour le Changement que je présidai ( A C a été dissout arbitrairement en janvier 2002).
Cela ne mit pas fin autant aux attaques directes ou voilées que je continue de subir de la part de mes anciens et nouveaux alliés car, en fait, je dérange beaucoup de monde, particulièrement ceux qui admettent difficilement que d’autres qu’eux occupent les devant de la scène.
J’avoue que je ne fais pas souvent dans la dentelle, que je suis direct, voire cassant et donc pas agréable à vivre pour ceux qui ont horreur de la vérité. Je suis, par contre, fidèle à mes conviction, à mes amitiés et à mes engagements. Mon honnêteté morale et intellectuelle que je crois être totale fait que je suis facile à tromper une première fois, puis une deuxième… et même une troisième fois parce qu’ au départ mon préjugé est toujours favorable et que les deux autres fois sont à mettre sur le compte de l’erreur, qui est humaine ; mais une fois ces chances passées, il n’y aura plus rien à faire.
La confiance ne reviendra jamais.
Si le paternalisme des bidhanes, leur condescendance, leur hégémonisme et leur mauvaise foi provoquent chez moi de vives et parfois violentes réactions, il y a aussi que la grande susceptibilité des négro-africains (qui ne cèdent en rien sur de nombreux points aux bidhanes) et leur égoïsme exacerbé ne facilitent guère une bonne entente avec eux.
Les haratines quant à eux, naguère exclus par ce qu’esclaves, ne sachant par quel bout prendre cette vie qu’ils découvrent pour la première fois, se dispersent à cause de leurs contradictions, leurs égoïsmes, leurs jalousies, leurs ambitions ou plus exactement leurs prétentions quand bien même il n’auront joué comme rôle, pour la majorité d’entre eux, que d’être haratines.
Leur lente et difficile prise de conscience, de même que leur divisions ne sont pas pour déplaire aux autres communautés, qui ne sont pas pressées de leur accorder le statut tant convoité de communauté homogène, respectable et respectée.
C’est donc dire que le combat que je mène ne me laisse aucun répit où que je me tourne, et les sujets de friction sont nombreux. Si en général les attaques des bidhanes ne sont pas directes, apparentes, celles des haratines et des négro-africains sont par contre ouvertes, violentes et fréquentes. Mes plus grandes déceptions sont toujours venues d’eux et dans le même ordre.
Mais hormis quelques rares cas d’extrême lassitude, l’idée de tout laisser tomber pour m’occuper de mes enfants, ne m’a vraiment jamais tenté.
Le combat est des plus difficiles, mais il doit se poursuivre…
Mon expérience à l’UFD puis à l’UFD /EN est en effet, sur beaucoup de points évoqués, assez édifiante : Tout a commencé avec les élections présidentielles de 1992 ; l’UFD était un grand parti, ses militants étaient nombreux et décidés. L’illusion qu’une nouvelle Mauritanie était en gestation donnait des ailes à tout le monde ; il y avait aussi cette réelle volonté, perceptible chez les principaux acteurs, sinon de faire oublier aux uns et aux autres les profondes blessures consécutives aux événements récents de 1989, 1990 et1991, au moins de contribuer à en limiter des séquelles morales et psychologiques en faisant partager par tous leur foi en un changement profond de la société profitable à tous.<br><br>
Ces maudites élections allaient donc sonner le glas de toute cette euphorie, de tout cet enthousiasme, de toutes ces convictions fortes, de toutes ces généreuses illusions…
Le parti prôna au départ le boycott si des garanties de transparences n’étaient pas obtenues. Il s’avéra par la suite que ce qui était, une position stratégique pour les uns (mon groupe notamment) n’était qu’un repli tactique pour les autres qui attendaient « d’avoir un candidat crédible, c’est à dire un bidhane » l’idée de présenter le plus adulé et plus charismatique du parti (moi) n’étant tout simplement pas envisageable à leurs yeux. Personne ne voulait de moi comme candidat, non pas à cause de mes qualités morales et intellectuelles que personne ne mettait en doute, mais simplement parce que je suis un hartani.
Mon éventuelle candidature était combattue non seulement par les bidhanes, mais également par les négro-africains.
Tous en effet considèrent intérieurement ou ouvertement qu’un esclave ne saurait devenir un prince.
Une fois le candidat trouvé en la personne d’Ahmed Ould Daddah (dont la seule caution politique et morale est qu’il soit le frère du premier président mauritanien renversé en 1978) il y eut un renversement de tendance, prônant cette fois la participation du parti aux élections, non pas en présentant un candidat issu de ses rangs, mais seulement en soutenant la candidature indépendante d’Ahmed… Mon opposition à cette démarche fera que ledit candidat ne verra plus en moi qu’un vulgaire et redoutable adversaire ou même un ennemi qu’il faut abattre par tous les moyens.
Même lorsque j’acceptai plus tard de revenir sur ma décision, de faire campagne pour lui et enfin d’accepter de demeure dans l’UFD/EN dont il est devenu le chef, cela n’améliora pas ma cote auprès de lui.
Il travailla activement en vue de me faire quitter le parti où lui et ses alliés conjoncturels se sentaient très à l’étroit à cause de ma popularité au niveau de la base du parti, essentiellement constitué de haratines et de négro-africains. Si lui se sentait « frustré ou menacé » dans mon rôle de chef incontesté, certains cadres négro-africains, considérant eux aussi que ma popularité auprès de « leur base négro-africaine » leur portait ombrage, n’étaient pas mécontents non plus de me voir partir… C’est ce que je fis en 1994.
Je peux dire aujourd’hui, sans aucun risque de me tromper, que mon départ a sonné définitivement le glas de l’UFD/EN.
Quel outil pour le changement ?
Action pour le Changement regroupait des Haratines, des Négro-africains mais aussi des Bidhanes. Nous militions tous pour un changement démocratique véritable dans la société.
Pour cela il faut la citoyenneté pleine et entière pour tous : liberté, égalité, unité et solidarité de tous les mauritaniens.
Nous voulons que l’esclavage soit constitutionnellement aboli, déclaré crime contre l’humanité et qu’à ce titre des sanctions soient prévues à l’encontre de ceux qui persisteraient, à le pratiquer. Nous reconnaissons ( mais cela n’est pas nouveau) que l’esclavage existe au niveau de toutes les communautés mauritanienne, c’est à dire la communauté maure et les communautés négro-africaines. Nous voulons que des programmes spécifiques soient mis en œuvre pour toutes les couches défavorisées dont évidemment les haratines.
Nous voulons que le caractère pluriculturel de la Mauritanie soit constitutionnellement reconnu scellant ainsi le droit à la différence. Nous voulons que les mauritaniens aient la même égalité de chance et qu’ils soient mis dans les mêmes conditions.
Nous refusons d’oublier les crimes horribles commis à l’endroit de nos compatriotes négro-africains et nous exigeons que justice soit faite, que les coupables soient punis, que les réparations soient consenties aux ayant droit.
C’est alors seulement que le pardon pourra être sollicité et obtenu…
Nous croyons sincèrement à la démocratie et à l’unité nationale sur ces bases et nous la croyons tout à fait réalisable à plus ou moins terme.
Nous voulons que tous ces changements s’opèrent en dehors de toute violence et de tout esprit revanchard.
Sur ce point nous divergeons fondamentalement avec les FLAM.
A propos de quelques points précis…
A la lecture du premier manifeste des FLAM, je reconnais que je n’en ai pas partagé toutes les idées et particulièrement celles qui ont consisté à décompter les mauritaniens sur la base de la couleur et à se présenter en défenseurs ou protecteurs des haratines alors que ses auteurs n’y ont jamais pensé par le passé et surtout parce qu’ils ne les ont jamais approchés politiquement jusqu’ici.
Il y a aussi que j’avais jugé, à juste titre, je crois, qu’il y avait de l’exagération en ce qui concerne l’exclusion des négro-africains au moment de la présentation du document. L’aristocratie négro-africaine – pour ne pas dire les négro-africains en général- a toujours tout partagé avec les bidhanes, y compris le mépris souverain des haratines et partant l’attitude qui consiste à les ignorer totalement. A l’époque, crier à l’exclusion des communautés négro-africaine était quelque peu exagéré, même si l’accélération de l’arabisation pouvait présager le pire.
Bien évidemment, la situation aujourd’hui est pire que celle décrite en 1986. Aucun mot ne pourra jamais faire saisir tout à fait l’intensité et l’horreur de la vague de répression qui à déferlé sur ces communautés. Nous travaillons de concert avec tous ceux qui croient encore à l’idéal de justice, de paix, d’unité et de solidarité. Notre foi et notre détermination pour la réalisation de cet objectif ne faibliront jamais.
Je suis au courant de nouvelles tendances qui se dessinent chez les FLAM et j’attends, pour y voir clair réellement, que les FLAM cessent de répandre des aberrations mensongères à propos des haratines qu’ils considèrent être la source de leurs maux et donc leur principal ennemi. Je crois très sincèrement et très simplement que les haratines qui ont ( par eux-mêmes ou parce qu’ils ont été manipulés par d’autres) massacré ou pillé des négro-africains lors des évènements exceptionnels, ne doivent pas ravir la vedette à tous les autres, beaucoup plus nombreux, qui ont défendu ces mêmes négro-africains, parfois au risque de leur vie.
A l’heure actuelle le pouvoir en Mauritanie agit sans la moindre logique, de manière presque paranoïaque. Ainsi la Mauritanie s’est retirée de la CEDEAO, pour se couper encore davantage du monde noir africain alors que celui-ci fait partie de la substance de son peuple, qu’il fait partie de son héritage culturel et historique.
Sans doute les dirigeants actuels croient-ils se racheter aux yeux du monde arabe après la catastrophique décision d’établir des relations diplomatiques avec l’Etat d’Israël, mais ils se trompent lourdement sur toute la ligne car outre que rien ne les rachètera de « ce péché mortel » l’intérêt majeur des arabes est sans doute d’étendre et de consolider leurs relations avec les Etats d’Afrique noire avec lesquels ils ont beaucoup de points communs.
Sans un rôle constructif et d’avant garde à jouer en Afrique noire, la Mauritanie ne représente aucun intérêt pour le monde arabe, ni pour le monde islamique, ni même pour ses propres citoyens.
La Mauritanie a pour seule vocation d’être ouverte sur le monde arabe, sur le monde africain car par l’effet du hasard elle se trouve à la rencontre entre ces deux monde dont elle pourrait constituer une admirable synthèse capable de favoriser entre les deux une totale symbiose.
Dois-je enfin rappeler que l’Afrique noire constitue le seul et unique arrière-pays pour les bidhanes ?
Je souhaite donc du fond du coeur l’avènement dans mon pays, comme dans le reste du monde, d’une démocratie véritable, d’un dialogue sincère et constructif, seule alternative à la violence. Il faut que le pouvoir en Mauritanie crée les conditions d’un tel dialogue. Une fois ces conditions réunies, l’opposition y répondra favorablement à coup sûr…<br><br>
Les haratines représentent environ 50% de la population totale du pays, elle même estimée à 2.500.000 habitants.
Aux élections de 1996, Action pour le Changement a été le seul parti véritablement de l’opposition à avoir fait élire un député qui, depuis a pris le large…
Aux élections de 2001, AC a fait élire 4 députés ( deux à Nouakchott dont moi-même, un à Nouadhibou et un au Guidimaka) , 4 maires ( dont trois à Nouakchott et un à Sélibaby) et plusieurs conseillers municipaux sur le territoire national devenant ainsi le premier parti de l’opposition, malgré toutes les contraintes imposées par le régimes et sa machine administratives.
Après la dissolution arbitraire de mon parti AC en janvier 2002, dans les conditions que vous connaissez et le refus de ce régime de reconnaître notre nouvelle formation politique Convention pour le Changement ; il a été convenu de fusionner Convention pour le Changement (CC) et l’Alliance Populaire pour le Progrès (APP) au sein du parti APP.
Malgré l’attachement du peuple mauritanien à la démocratie, son aspiration à participer à la gestion des affaires du pays et la lutte qui a été engagée par ses forces vives, patriotiques et démocratiques, le processus démocratique dans notre pays est adopté surtout pour répondre aux orientations et pressions des pays occidentaux ainsi qu’aux changement survenus dans le monde, précisément la chute du bloc socialiste et la course des pays de l’Europe de l’Est vers le système libéral et la mode libérale qui a gagné l’Afrique. Ces conditions ont coïncidé avec une crise aiguë multidimensionnelle vécue par le régime militaire en place qui était dans un isolement politique total et se débattait dans une crise économique profonde. Ce qui l’a amené à accepter immédiatement des orientations françaises d’Avril 1990 visant le changement dans sa forme pour éviter les conséquences de l’implosion politique.
C’est ainsi que le pluralisme est arrivé dans notre pays sous la pression de l’extérieur pour répondre à des besoins pressant du régime lui-même. Il s’agit notamment de dépasser sa crise et de camoufler ses crimes et ses violations des Droits de L’Homme qui ont culminé en 1989-91 durant toute la période d’exception et de conserver le pouvoir à travers des élections truquées.
Ce processus démocratique a été préparé unilatéralement sans aucune implication des forces et acteurs politiques dans le pays de manière à assurer au régime sa pérennité.
Ceci s’avère clair à travers les textes qui gèrent le processus démocratique. L’article 104 rajouté à la constitution, après le référendum, les textes relatifs à la protection de l’ordre publique et ceux organisant les élections promulgués dans des périodes précédent le processus démocratique, dont certains relèvent de la période coloniale, vident de fait la Constitution de son contenu.
Les élections étaient des mascarades pour pérenniser l’armée au pouvoir (Présidence de l’Etat, Présidence du Parlement, Direction des grandes entreprises économique du pays).
Cette période a été riche d’oppression, d’arbitraire, de confiscation des libertés publiques et des violation des droits de l’homme. Elle se singularisait par:
-La dissolution des partis d’opposition et le blocage des activités politiques des autres partis de l’opposition
-La censure de la presse indépendante et du barreau des avocats pour les museler
-Les multiples arrestations des dirigeants des partis politiques d’opposition et organisations de masse ( syndicats, etc. )
-Les arrestations et tortures d’hommes d’opinion
-Les massacres et tortures de citoyens innocents
-L’absence de neutralité de l’administration
-La carence de l’appareil judiciaire et l’inexistence de voies de recours.
-La gabegie, la corruption, le détournement des deniers publics, etc.
Cette période est marquée aussi par la détérioration du climat politique et économique par le régime à travers la réanimation des cadres tribaux et régionaux et le recrutement des chefs traditionnels comme ses clients politiques, et la transformation de l’appareil de l’Etat en une entreprise de corruption.
Les nominations, les services, avantages et toutes sortes d’intérêts publics sont conditionnés par le soutien au régime
Ainsi l’appartenance à la tribu a supplanté l’appartenance à l’Etat, ôtant à la loi son rôle et son pouvoir de protection et faisant du clientélisme le moyen de protection à la place des lois. Ce qui a conduit à la destruction de la notion et de la présence matérielle de l’Etat au niveau du citoyen, hypothéquant l’avenir du pays.
Les fraudes dans les élections ont fait perdre au citoyen toute confiance en celles-ci et en la démocratie.
Même si l’opposition parvient, par le biais des élections, à certaines places électives (députés ou maires), les portes resteront toujours fermées devant tout changement effectif car les institutions parlementaires et communales ne disposent d’aucune compétence réelle.
L’expérience des dernières élections a prouvé que le régime est incapable d’admettre l’opinion de l’autre car la présence d’un nombre limité d’élus au sein des institution de l’Etat l’a indisposé fortement. Que se passerait-il si l’opposition avait obtenu un nombre considérable d’élus au parlement.
Les réalités de la société et de l’opposition s’ajoutant à la volonté et au comportement du régime ont conduit le processus démocratique à de tels résultats.
La société, à cause de son sous-développement et de analphabétisme, était un instrument docile aux mains du régime et des chefs tribaux qui usent à la fois de séduction et de pression. Les partis d’opposition, du fait des conditions de leur création dans la précipitation et l’empressement, les multiples problèmes internes dont ils ont été l’objet, la faiblesse de leurs moyens matériels, leur jeune âge et leur incapacité à rassembler leurs efforts dans une action commune et continue, n’ont pas su transmettre suffisamment leurs messages aux masses, surtout en milieu rural, lequel constitue le vivier du régime et de ses alliés ; elle n’a, non plus réussi à influencer, de manière décisive, le « processus démocratique ».
Celui-ci, se trouvant dans l’impasse, toute ouverture d’horizons futurs est conditionnée par la capacité de l’opposition à unir ses efforts afin de créer les conditions favorables à une transition démocratique capable de se développer, non de tenter d’améliorer un processus en crise dés son départ.
Le parti APP a pris la décision de participer aux élections présidentielles, en présentant ma candidature.
Dans cette perspective, il est nécessaire d’œuvrer au sein de l’opposition pour que :
-le candidat du parti soit l’unique candidat de l’ensemble de l’opposition afin de sauvegarder l’unité de celle-ci ;
-Au cas où il y aurait pluralité de candidats, que prévale une bonne coordination entre eux;
-L’élaboration d’une stratégie d’actions communes de l’opposition pendant et après la campagne, ce qui suppose de travailler, ensemble, dans le cadre d’une vision, en partage, de l’alternance démocratique.
Octobre 2003
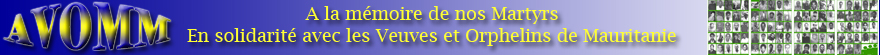
 Actualités
Actualités



















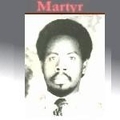
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)