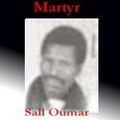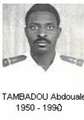Frédéric Encel
Entre l’Etat d’Israël et l’Afrique noire, on a souvent pu parler d’une histoire affective forte, compliquée par des évolutions géopolitiques incontournables. De la décolonisation à aujourd’hui, les relations entre les peuples juif et africain ont ainsi connu des hauts et des bas.
L’accession à la souveraineté d’une trentaine d’Etats non arabes d’Afrique, en quelques années seulement (1958-60), suscite l’intérêt immédiat et soutenu d’Israël, Etat alors en proie à une solitude géopolitique totale au Proche-Orient. Il s’agit de jouer sur les représentations communes : la faiblesse sans complexe ; la récente décolonisation face à l’Europe ; les prise en main et mise en valeur courageuses d’une terre ingrate ; et surtout une communauté de destin tragique, entre esclavage des Noirs et persécutions des Juifs. (Il convient d’ajouter à ces représentations initiales celle, plus récente et développée à partir des années 1990 seulement, de la lutte commune face au terrorisme islamique, y compris vis à vis de partenaires majoritairement musulmans comme le Sénégal).
Ajoutées à une relative complémentarité des économies, ces représentations analogues contribuent à la création et au développement de relations souvent chaleureuses. Ainsi dès 1958, la ministre israélienne des Affaires étrangères Golda Meir effectue une visite officielle au Ghana, en Côte d’Ivoire et en Guinée. A l’époque, la grande proximité commune avec la France – l’ancienne puissance coloniale désormais alliée et donatrice pour la plupart des Etats de l’ex Union française, et l’alliée stratégique d’Israël quelques années encore – facilite, avec de surcroît l’usage fréquent du français de part et d’autre, le partenariat.
Mais un premier tournant s’opère avec la guerre des Six Jours de juin 1967 ; chez plusieurs Etats africains, Israël perd son statut de petit Etat faible pour celui de puissance conquérante. Ce renversement s’opère alors que partout le bloc de l’Est progresse, à l’instar des idéologies tiers-mondistes et, avec elles, l’antiaméricanisme. Toutefois, même après ce conflit, trente-deux Etats d’Afrique noire (soit pratiquement tous) entretiennent des relations diplomatiques avec Israël. En novembre 1971, une délégation des chefs d’Etat zaïrois (Mobutu), camerounais (Ahidjo), sénégalais (Senar Senghor) et nigérian (Gowon) effectue une visite de conciliation entre Israël et l’Egypte, et propose l’envoi de casques bleus africains dans la zone conflictuelle du canal de Suez. Cette mission de bons offices n’aboutira pas à des résultats tangibles mais illustre alors la position honorable occupée par Israël auprès des principales capitales noire-africaines. Durant l’été 2001, en pleine confrontation israélo-palestinienne (seconde Intifada), cette logique de conciliation et d’équilibre au Proche-Orient se retrouve avec une initiative secrète du président sénégalais Abdoulaye Wade : réunir une conférence internationale à Dakar entre dirigeants israéliens et palestiniens.
Le second tournant, radical cette fois, s’opère en octobre 1973. Dans un contexte de dépendance pétrolière vis à vis du monde arabe et de poursuite de la progression soviétique sur le continent, vingt-neuf Etats d’Afrique noire rompent subitement leurs relations diplomatiques – et par conséquent commerciales pour la plupart – avec l’Etat hébreu ; seuls la Côte d’Ivoire et les fort modestes Maurice, Malawi, Lesotho et Swaziland les maintiennent. Le franchissement du canal de Suez durant le conflit israélo-égyptien et la percée israélienne sur sa rive occidentale (donc africaine) constituent officiellement – et psychologiquement sans doute – le motif premier de la rupture avec Israël. Les années suivantes voient se confirmer le phénomène.
UNE RELATION DE TROIS ORDRES
Lorsqu’en novembre 1975 l’Assemblée générale des Nations-Unies adopte la résolution 3379 assimilant le sionisme à une forme de racisme, seuls le Malawi, le Lesotho, la République Centrafricaine, le Liberia et la Côte d’Ivoire s’y opposent. Dans certains cas, des achats de services et de produits israéliens se poursuivent, mais discrètement. Il faut attendre le milieu des années 1980 pour voir une reprise progressive des relations diplomatiques, encouragée à la fois par le reflux de l’influence soviétique et l’atténuation de la pression pétrolière (découverte de gisements hors de l’Organisation Arabe des Pays Exportateurs de Pétrole - OAPEP, baisse des cours du brut). Le Zaïre et la Côte d’Ivoire donnent à l’époque l’exemple par la signature de juteux contrats avec l’Etat hébreu., tandis que le Togo, le Cameroun, le Kenya, la Sierra Leone, la Gambie, le Ghana, le Nigeria, la Zambie ou encore l’Ethiopie renvoient respectivement un ambassadeur à Tel Aviv.
Et en décembre 1991, quand l’Assemblée générale de l’ONU vote l’annulation de l’équation onusienne sionisme = racisme, il ne se trouve pas un seul pays d’Afrique noire pour s’y opposer, la majorité d’entre eux approuvant même cette annulation. En juin 2004, le niveau de relations – tous registres confondus – est en passe de retrouver celui précédant la guerre du Kippour.
L’attention soutenue qu’Israël a entretenue et continue d’entretenir pour l’Afrique noire s’inscrit dans un triple registre ; économique, diplomatique, stratégique.
Sur le plan économique, il s’agit de se placer dès l’accession à l’indépendance des Etats noirs africains sur ce marché émergeant et potentiellement très intéressant ; c’est en effet un nombre considérable d’Etats – une vingtaine entre 1958 et 1960 – dotés pour beaucoup de ressources naturelles non négligeables, qui apparaît. Parfois, leur solvabilité est même garantie par des aides des anciennes puissances coloniales. Les premiers contrats concernent les techniques agricoles (irrigation notamment), l’éducation, et l’aide technique militaire. Israël importe en contrepartie des matières premières : fruits, cacao, pierres précieuses, etc. Avant la rupture de la guerre du Kippour d’octobre 1973, Israël compte en Afrique noire vingt-huit partenaires commerciaux chez lesquels 2 800 experts travaillent sur soixante-sept projets de développement, pour un volume d’échanges modeste (en dizaines de millions de Dollars) mais avec une balance commerciale globale bénéficiaire. En 2004, le consortium israélien Africa Israel est en pointe dans le partenariat technique et économique avec l’Afrique noire.
Sur le plan politique, l’afflux soudain de voix africaines à l’Assemblée générale des Nations-Unies intéresse d’autant plus l’Etat hébreu que, dans les années 1960, le bloc arabo-communiste se fait sans cesse plus pressant dans ses résolutions anti-israéliennes. Au-delà de l’arithmétique (tous les Etats noirs africains ne votant pas comme un seul), il s’agit de forger des amitiés qui garantiront un non alignement éventuel sur les Etats arabes.
C’est néanmoins dans le domaine stratégique que le continent noir offre le plus d’avantages aux yeux des responsables israéliens. Comme d’autres zones, l’Afrique non arabe constitue une seconde ceinture derrière celle des Etats arabes voisins et (potentiellement) hostiles, en l’espèce l’Egypte, le Soudan et le Yémen, dans le cadre d’une stratégie de revers. A des époques différentes, les cas suivants de coopération militaire – à des degrés de discrétion plus ou moins élevés – ont illustré cette stratégie israélienne de contournement : l’Ethiopie et l’Ouganda comme principaux pays en amont du Nil (vital pour l’Egypte) ; le Kenya comme point d’appui et/ou d’acheminement d’hommes et de matériels en Somalie (pays à dominante arabo-musulmane) ; la République Centrafricaine, l’Ouganda, le Zaïre (Congo-Kinshasa), le Kenya et l’Ouganda comme bases arrières pour les combattants soudanais en lutte contre le régime islamo-nationaliste du nord ; ou encore et surtout l’Erythrée (depuis son indépendance en 1994) comme nouvelle puissance face au Yémen dans le très stratégique détroit de Bab el Mandeb (goulet d’étranglement méridional de la mer Rouge).
Parfois, un Etat africain brandit la menace d’un partenariat actif avec Israël contre un adversaire, comme ce fut le cas avec l’Ethiopie qui menaça le Soudan et l’Egypte d’ériger un barrage hydraulique sur le Nil avec l’aide technique d’Israël si certaines revendications n’était pas satisfaites. Dans la lutte anti-terroriste aussi, la coopération permet des initiatives militaires osées : la spectaculaire opération de libération des otages d’Entebbé (Ouganda), en juillet 1976, réussie grâce à l’utilisation de l’espace aérien kenyan. Idem pour les opérations aéroportées de rapatriement de Juifs éthiopiens, les Falashas, entre 1984 et 1991 : un minimum de coopération fut nécessaire à l’atterrissage d’avions de ligne et de gros porteurs militaires avec un régime officiellement marxiste, celui du président Mengistu, pourtant peu soupçonnable d’empathie pour le sionisme.
A cet égard, le cas du Rwanda est éloquent : de nombreux Tutsis se représentent comme les Juifs de l’Afrique : minoritaires dans un environnement plutôt voire très hostile, objets d’une perception fantasmatique d’hommes « élus », victimes abandonnées d’un génocide en 1994, peuple doté d’une combativité lui ayant permis de chasser ses bourreaux et de prendre le pouvoir par les armes… Pour certains Tutsis enfin, leur origine correspondrait – à l’instar des Falashas d’Ethiopie – à la descendance du roi Salomon et de la reine de Saba (Xè siècle av. J-C). On aurait tort de mésestimer le poids géopolitique de ces représentations. A peine parvenu au pouvoir suite au génocide perpétré par les Hutus, le chef du Front Patriotique du Rwanda (FPR) tutsi Paul Kagamé se rend en voyage officiel en Israël.
C’est du reste sous l’impulsion du Rwanda ami que le 3 avril 2004, une délégation de cinq ambassadeurs africains auprès de l’ONU (respectivement ceux du Rwanda, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la République démocratique du Congo – RDC ou ex-Zaïre) se rendit en Israël en visite de travail ; elle serait suivie par plusieurs autres, y compris en 2007.
ISRAEL ET L’APARTHEID
Il convient d’ajouter quelques réflexions que ce cas à part qui correspond aux anciens rapports entre l’Etat d’Israël et l’Afrique du Sud ; entretenus dès 1948, ils donnent généralement lieu à une condamnation morale pour ce qui concerne la période d’Apartheid. Or durant toute cette période, si des échanges ont bien lieu – notamment dans le domaine des diamants et du high tech – Israël ne représente jamais qu’un partenaire quantitativement secondaire, moins considérable par exemple que les Etats d’Europe occidentale ou qu’un contempteur systématique d’Israël tel que l’Arabie saoudite ; le royaume arabe ne cessera d’entretenir une étroite relation commerciale fondée sur la vente de pétrole brut à l’Afrique du Sud, et pour un volume d’échanges bien plus considérable que celui prévalant avec Israël. De nombreux autres Etats, du Sud comme du Nord, commercent également tous azimuts avec Pretoria tout en condamnant officiellement l’Apartheid. Quant à la nature du lien israélo-sud-africain, il ne fut jamais idéologique ; en 1961, Israël vote une résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies condamnant explicitement l’Apartheid, et n’ouvre au rang d’ambassadeur ses relations diplomatiques qu’en 1974.
Le 18 mars 1987, le gouvernement israélien va jusqu’à suspendre tous ses contrats avec l’Afrique du Sud. Quant à la coopération nucléaire, elle est officiellement abandonnée par le premier gouvernement ANC de Nelson Mandela en 1994 et, pour des raisons idéologiques, les gouvernements sud-africains successifs – tiers-mondistes et marqués par le marxisme – vont amenuiser les relations commerciales avec un Etat hébreu dont l’image est négative du fait de l’Intifada. Les relations entre les deux pays se dégradent encore lorsque, à la conférence de Durban sur le racisme d’août 2001, Israël, le sionisme et même les Juifs sont très violemment condamnés. Il convient toutefois de rappeler que le leader historique Nelson Mandela – qui n’est déjà plus au pouvoir lors de cette conférence – a toujours reconnu le sionisme comme un mouvement légitime de libération nationale du peuple juif.
Ni amie, ni ennemie, éloignée du théâtre moyen-oriental ; l’Afrique du Sud, au niveau géopolitique, ne revêt plus l’importance relative d’autrefois pour Israël, dans la mesure où elle a renoncé, d’une part, à importer des produits militaires à haute valeur ajoutée, et, d’autre part, à assumer un rôle de puissance autre que régionale africaine.
En définitive, comme pour la plupart des autres relations internationales, celles entretenues entre l’Etat juif et les Etats d’Afrique noire auront toujours correspondu à un mélange d’authentique proximité et de réalisme politico-économique.
Frédéric Encel
____________________________________________________________________________
* Nous admettons comme Etats d’Afrique noire ceux qui sont gouvernés par des régimes « noirs » (donc pas l’Afrique du Sud de l’Apartheid ou la Rhodésie, ex Zimbabwé), et non arabes (donc pas la Somalie).
Cela ne signifie pas qu’Israël n’entretienne pas de rapports diplomatiques avec certains des régimes non compris dans cette sélection. Ex : la Mauritanie, l’Afrique du Sud post-Apartheid, etc.).
** Voir l’Essentiel des relations internationales n°13, avril-mai 2007.
Docteur en géopolitique, Frédéric Encel (www.fredericencel.org) est spécialiste du Moyen-Orient et Professeur à l’ESG. Il enseigne en outre les relations internationales à la prép-ENA de Sciences-Po Rennes et est Directeur de recherche à l'Institut français de géopolitique. Il est auteur de plusieurs livres sur la géopolitique internationale.
Source: icicemac
(M)
L’accession à la souveraineté d’une trentaine d’Etats non arabes d’Afrique, en quelques années seulement (1958-60), suscite l’intérêt immédiat et soutenu d’Israël, Etat alors en proie à une solitude géopolitique totale au Proche-Orient. Il s’agit de jouer sur les représentations communes : la faiblesse sans complexe ; la récente décolonisation face à l’Europe ; les prise en main et mise en valeur courageuses d’une terre ingrate ; et surtout une communauté de destin tragique, entre esclavage des Noirs et persécutions des Juifs. (Il convient d’ajouter à ces représentations initiales celle, plus récente et développée à partir des années 1990 seulement, de la lutte commune face au terrorisme islamique, y compris vis à vis de partenaires majoritairement musulmans comme le Sénégal).
Ajoutées à une relative complémentarité des économies, ces représentations analogues contribuent à la création et au développement de relations souvent chaleureuses. Ainsi dès 1958, la ministre israélienne des Affaires étrangères Golda Meir effectue une visite officielle au Ghana, en Côte d’Ivoire et en Guinée. A l’époque, la grande proximité commune avec la France – l’ancienne puissance coloniale désormais alliée et donatrice pour la plupart des Etats de l’ex Union française, et l’alliée stratégique d’Israël quelques années encore – facilite, avec de surcroît l’usage fréquent du français de part et d’autre, le partenariat.
Mais un premier tournant s’opère avec la guerre des Six Jours de juin 1967 ; chez plusieurs Etats africains, Israël perd son statut de petit Etat faible pour celui de puissance conquérante. Ce renversement s’opère alors que partout le bloc de l’Est progresse, à l’instar des idéologies tiers-mondistes et, avec elles, l’antiaméricanisme. Toutefois, même après ce conflit, trente-deux Etats d’Afrique noire (soit pratiquement tous) entretiennent des relations diplomatiques avec Israël. En novembre 1971, une délégation des chefs d’Etat zaïrois (Mobutu), camerounais (Ahidjo), sénégalais (Senar Senghor) et nigérian (Gowon) effectue une visite de conciliation entre Israël et l’Egypte, et propose l’envoi de casques bleus africains dans la zone conflictuelle du canal de Suez. Cette mission de bons offices n’aboutira pas à des résultats tangibles mais illustre alors la position honorable occupée par Israël auprès des principales capitales noire-africaines. Durant l’été 2001, en pleine confrontation israélo-palestinienne (seconde Intifada), cette logique de conciliation et d’équilibre au Proche-Orient se retrouve avec une initiative secrète du président sénégalais Abdoulaye Wade : réunir une conférence internationale à Dakar entre dirigeants israéliens et palestiniens.
Le second tournant, radical cette fois, s’opère en octobre 1973. Dans un contexte de dépendance pétrolière vis à vis du monde arabe et de poursuite de la progression soviétique sur le continent, vingt-neuf Etats d’Afrique noire rompent subitement leurs relations diplomatiques – et par conséquent commerciales pour la plupart – avec l’Etat hébreu ; seuls la Côte d’Ivoire et les fort modestes Maurice, Malawi, Lesotho et Swaziland les maintiennent. Le franchissement du canal de Suez durant le conflit israélo-égyptien et la percée israélienne sur sa rive occidentale (donc africaine) constituent officiellement – et psychologiquement sans doute – le motif premier de la rupture avec Israël. Les années suivantes voient se confirmer le phénomène.
UNE RELATION DE TROIS ORDRES
Lorsqu’en novembre 1975 l’Assemblée générale des Nations-Unies adopte la résolution 3379 assimilant le sionisme à une forme de racisme, seuls le Malawi, le Lesotho, la République Centrafricaine, le Liberia et la Côte d’Ivoire s’y opposent. Dans certains cas, des achats de services et de produits israéliens se poursuivent, mais discrètement. Il faut attendre le milieu des années 1980 pour voir une reprise progressive des relations diplomatiques, encouragée à la fois par le reflux de l’influence soviétique et l’atténuation de la pression pétrolière (découverte de gisements hors de l’Organisation Arabe des Pays Exportateurs de Pétrole - OAPEP, baisse des cours du brut). Le Zaïre et la Côte d’Ivoire donnent à l’époque l’exemple par la signature de juteux contrats avec l’Etat hébreu., tandis que le Togo, le Cameroun, le Kenya, la Sierra Leone, la Gambie, le Ghana, le Nigeria, la Zambie ou encore l’Ethiopie renvoient respectivement un ambassadeur à Tel Aviv.
Et en décembre 1991, quand l’Assemblée générale de l’ONU vote l’annulation de l’équation onusienne sionisme = racisme, il ne se trouve pas un seul pays d’Afrique noire pour s’y opposer, la majorité d’entre eux approuvant même cette annulation. En juin 2004, le niveau de relations – tous registres confondus – est en passe de retrouver celui précédant la guerre du Kippour.
L’attention soutenue qu’Israël a entretenue et continue d’entretenir pour l’Afrique noire s’inscrit dans un triple registre ; économique, diplomatique, stratégique.
Sur le plan économique, il s’agit de se placer dès l’accession à l’indépendance des Etats noirs africains sur ce marché émergeant et potentiellement très intéressant ; c’est en effet un nombre considérable d’Etats – une vingtaine entre 1958 et 1960 – dotés pour beaucoup de ressources naturelles non négligeables, qui apparaît. Parfois, leur solvabilité est même garantie par des aides des anciennes puissances coloniales. Les premiers contrats concernent les techniques agricoles (irrigation notamment), l’éducation, et l’aide technique militaire. Israël importe en contrepartie des matières premières : fruits, cacao, pierres précieuses, etc. Avant la rupture de la guerre du Kippour d’octobre 1973, Israël compte en Afrique noire vingt-huit partenaires commerciaux chez lesquels 2 800 experts travaillent sur soixante-sept projets de développement, pour un volume d’échanges modeste (en dizaines de millions de Dollars) mais avec une balance commerciale globale bénéficiaire. En 2004, le consortium israélien Africa Israel est en pointe dans le partenariat technique et économique avec l’Afrique noire.
Sur le plan politique, l’afflux soudain de voix africaines à l’Assemblée générale des Nations-Unies intéresse d’autant plus l’Etat hébreu que, dans les années 1960, le bloc arabo-communiste se fait sans cesse plus pressant dans ses résolutions anti-israéliennes. Au-delà de l’arithmétique (tous les Etats noirs africains ne votant pas comme un seul), il s’agit de forger des amitiés qui garantiront un non alignement éventuel sur les Etats arabes.
C’est néanmoins dans le domaine stratégique que le continent noir offre le plus d’avantages aux yeux des responsables israéliens. Comme d’autres zones, l’Afrique non arabe constitue une seconde ceinture derrière celle des Etats arabes voisins et (potentiellement) hostiles, en l’espèce l’Egypte, le Soudan et le Yémen, dans le cadre d’une stratégie de revers. A des époques différentes, les cas suivants de coopération militaire – à des degrés de discrétion plus ou moins élevés – ont illustré cette stratégie israélienne de contournement : l’Ethiopie et l’Ouganda comme principaux pays en amont du Nil (vital pour l’Egypte) ; le Kenya comme point d’appui et/ou d’acheminement d’hommes et de matériels en Somalie (pays à dominante arabo-musulmane) ; la République Centrafricaine, l’Ouganda, le Zaïre (Congo-Kinshasa), le Kenya et l’Ouganda comme bases arrières pour les combattants soudanais en lutte contre le régime islamo-nationaliste du nord ; ou encore et surtout l’Erythrée (depuis son indépendance en 1994) comme nouvelle puissance face au Yémen dans le très stratégique détroit de Bab el Mandeb (goulet d’étranglement méridional de la mer Rouge).
Parfois, un Etat africain brandit la menace d’un partenariat actif avec Israël contre un adversaire, comme ce fut le cas avec l’Ethiopie qui menaça le Soudan et l’Egypte d’ériger un barrage hydraulique sur le Nil avec l’aide technique d’Israël si certaines revendications n’était pas satisfaites. Dans la lutte anti-terroriste aussi, la coopération permet des initiatives militaires osées : la spectaculaire opération de libération des otages d’Entebbé (Ouganda), en juillet 1976, réussie grâce à l’utilisation de l’espace aérien kenyan. Idem pour les opérations aéroportées de rapatriement de Juifs éthiopiens, les Falashas, entre 1984 et 1991 : un minimum de coopération fut nécessaire à l’atterrissage d’avions de ligne et de gros porteurs militaires avec un régime officiellement marxiste, celui du président Mengistu, pourtant peu soupçonnable d’empathie pour le sionisme.
A cet égard, le cas du Rwanda est éloquent : de nombreux Tutsis se représentent comme les Juifs de l’Afrique : minoritaires dans un environnement plutôt voire très hostile, objets d’une perception fantasmatique d’hommes « élus », victimes abandonnées d’un génocide en 1994, peuple doté d’une combativité lui ayant permis de chasser ses bourreaux et de prendre le pouvoir par les armes… Pour certains Tutsis enfin, leur origine correspondrait – à l’instar des Falashas d’Ethiopie – à la descendance du roi Salomon et de la reine de Saba (Xè siècle av. J-C). On aurait tort de mésestimer le poids géopolitique de ces représentations. A peine parvenu au pouvoir suite au génocide perpétré par les Hutus, le chef du Front Patriotique du Rwanda (FPR) tutsi Paul Kagamé se rend en voyage officiel en Israël.
C’est du reste sous l’impulsion du Rwanda ami que le 3 avril 2004, une délégation de cinq ambassadeurs africains auprès de l’ONU (respectivement ceux du Rwanda, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la République démocratique du Congo – RDC ou ex-Zaïre) se rendit en Israël en visite de travail ; elle serait suivie par plusieurs autres, y compris en 2007.
ISRAEL ET L’APARTHEID
Il convient d’ajouter quelques réflexions que ce cas à part qui correspond aux anciens rapports entre l’Etat d’Israël et l’Afrique du Sud ; entretenus dès 1948, ils donnent généralement lieu à une condamnation morale pour ce qui concerne la période d’Apartheid. Or durant toute cette période, si des échanges ont bien lieu – notamment dans le domaine des diamants et du high tech – Israël ne représente jamais qu’un partenaire quantitativement secondaire, moins considérable par exemple que les Etats d’Europe occidentale ou qu’un contempteur systématique d’Israël tel que l’Arabie saoudite ; le royaume arabe ne cessera d’entretenir une étroite relation commerciale fondée sur la vente de pétrole brut à l’Afrique du Sud, et pour un volume d’échanges bien plus considérable que celui prévalant avec Israël. De nombreux autres Etats, du Sud comme du Nord, commercent également tous azimuts avec Pretoria tout en condamnant officiellement l’Apartheid. Quant à la nature du lien israélo-sud-africain, il ne fut jamais idéologique ; en 1961, Israël vote une résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies condamnant explicitement l’Apartheid, et n’ouvre au rang d’ambassadeur ses relations diplomatiques qu’en 1974.
Le 18 mars 1987, le gouvernement israélien va jusqu’à suspendre tous ses contrats avec l’Afrique du Sud. Quant à la coopération nucléaire, elle est officiellement abandonnée par le premier gouvernement ANC de Nelson Mandela en 1994 et, pour des raisons idéologiques, les gouvernements sud-africains successifs – tiers-mondistes et marqués par le marxisme – vont amenuiser les relations commerciales avec un Etat hébreu dont l’image est négative du fait de l’Intifada. Les relations entre les deux pays se dégradent encore lorsque, à la conférence de Durban sur le racisme d’août 2001, Israël, le sionisme et même les Juifs sont très violemment condamnés. Il convient toutefois de rappeler que le leader historique Nelson Mandela – qui n’est déjà plus au pouvoir lors de cette conférence – a toujours reconnu le sionisme comme un mouvement légitime de libération nationale du peuple juif.
Ni amie, ni ennemie, éloignée du théâtre moyen-oriental ; l’Afrique du Sud, au niveau géopolitique, ne revêt plus l’importance relative d’autrefois pour Israël, dans la mesure où elle a renoncé, d’une part, à importer des produits militaires à haute valeur ajoutée, et, d’autre part, à assumer un rôle de puissance autre que régionale africaine.
En définitive, comme pour la plupart des autres relations internationales, celles entretenues entre l’Etat juif et les Etats d’Afrique noire auront toujours correspondu à un mélange d’authentique proximité et de réalisme politico-économique.
Frédéric Encel
____________________________________________________________________________
* Nous admettons comme Etats d’Afrique noire ceux qui sont gouvernés par des régimes « noirs » (donc pas l’Afrique du Sud de l’Apartheid ou la Rhodésie, ex Zimbabwé), et non arabes (donc pas la Somalie).
Cela ne signifie pas qu’Israël n’entretienne pas de rapports diplomatiques avec certains des régimes non compris dans cette sélection. Ex : la Mauritanie, l’Afrique du Sud post-Apartheid, etc.).
** Voir l’Essentiel des relations internationales n°13, avril-mai 2007.
Docteur en géopolitique, Frédéric Encel (www.fredericencel.org) est spécialiste du Moyen-Orient et Professeur à l’ESG. Il enseigne en outre les relations internationales à la prép-ENA de Sciences-Po Rennes et est Directeur de recherche à l'Institut français de géopolitique. Il est auteur de plusieurs livres sur la géopolitique internationale.
Source: icicemac
(M)
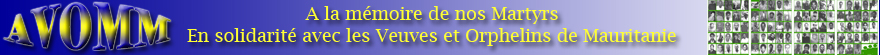
 Actualités
Actualités



















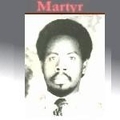
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)