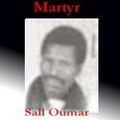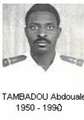C’est un coup de tonnerre dans un ciel que le gouvernement israélien croyait bleu, occupé qu’il était à étendre la colonisation et à écraser toute forme de résistance en Cisjordanie. L’attaque menée par différentes organisations palestiniennes sous l’égide du Hamas a ébranlé toutes les certitudes et ouvert une période de guerre et d’incertitude pour Israël et tout le Proche-Orient.
C’était il y aura bientôt 150 ans. Ce 25 juin 1876, une coalition de guerriers sioux et cheyennes avec à leur tête les chefs tribaux Sitting Bull et Crazy Horse parvient à leurrer le 7e régiment de cavalerie de l’armée américaine pour le diriger vers une cuvette nommé Little Big Horn, dans l’état du Montana, au Nord-Ouest des États-Unis. La troupe était emmenée par le lieutenant-colonel George Armstrong Custer, notoirement connu pour son racisme colonial exacerbé à l’égard de ceux qu’il appelait improprement les « Indiens » — c’est-à-dire les populations indigènes. Custer y perdit la vie, et avec lui 40 % de ses hommes, sans compter les blessés.
Une victoire des « indigènes »
Ce fut l’une des rarissimes « victoires » que sont parvenus à remporter les indigènes lors de la « conquête de l’Ouest » menée contre eux par le gouvernement américain et qui s’accompagnait d’une dépossession systématique de leurs terres et propriétés. Une dépossession destinée à regrouper ces derniers dans des « réserves » — le terme « bantoustan » n’avait pas encore été inventé. Custer, gonflé de certitudes, acquis à l’idée que les « Indiens » n’étaient que des barbares incapables, des êtres inférieurs, s’engouffra dans la cuvette. Il fut surpris par l’organisation des guerriers sioux et cheyennes, l’armement dont ils disposaient, leur préparation au combat, leur mobilité. La bataille ne dura que 36 heures, mais la défaite ponctuelle laissa les Américains pantois, quasi ahuris.
Cette défaite a marqué profondément la culture américaine. On ne compte plus les romans, les pièces de théâtre, les films consacrés à cet événement. Pendant 100 ans (de 1876 à 1976), Custer incarna le héros américain face à l’autochtone barbare, l’adepte du scalp. Mais depuis le film Little Big Man (1976) et d’autres films et ouvrages, renversement total : le chef indigène est devenu dans la culture américaine le héros défendant sa juste cause. Toutefois, la victoire des autochtones à Little Big Horn ne modifia rien du devenir que les colons européens leur promettaient. Le rapport global des forces leur était par trop défavorable. Le gouvernement américain et son armée mirent en place moult « commissions d’enquête » pour tenter de comprendre comment la faillite militaire avait pu advenir. Mais la conquête de l’Ouest par les colons se poursuivit avec plus d’acharnement encore.
En Israël aussi, d’innombrables voix appellent déjà à la constitution de « commissions d’enquête » pour punir les coupables de l’incroyable « fiasco sécuritaire » du 7 octobre 2023. À la télévision, sur les ondes des chaînes de radio, dans la presse, élus du peuple et experts en tout genre multiplient les diatribes et les conseils aux décideurs. L’un avertit : pour que cela ne se renouvelle pas, il faudra tuer à Gaza « des milliers de personnes ». Un autre assure qu’il faut « nettoyer Gaza sans faire de prisonniers ». Un autre encore explique que, tant que les Palestiniens resteront là, aucune solution n’interviendra. Comprendre : il faudra bien finir par les expulser. Un ex-numéro deux de l’état-major israélien, Dan Harel, s’exclame sur le canal 13 de la télévision : « Désormais, soit on y va, soit on n’a plus rien à faire ici ». Bref l’exposition de la défaite suscite essentiellement des sentiments de revanche, de vengeance. La musique est connue : Israël a toujours été trop gentil avec les Palestiniens. Quant à la stupéfaction qui saisit la quasi-totalité des citoyens, elle est la même que celle qui s’était emparée des Américains après Little Big Horn : mais qui aurait imaginé que ces sauvages, ces incultes, soient capables de nous berner à ce point !
Il est encore trop tôt pour tirer le bilan de ce qui est advenu le 7 octobre. Mais on peut résumer quelques constats.
Le fiasco des services de renseignement
Une opération de l’ampleur de celle lancée sous la houlette du Hamas ne peut se mener sans avoir été préparée depuis plusieurs mois — peut-être des années. Et des milliers de personnes, jeunes pour la plupart, y ont participé (plusieurs centaines de jeunes Palestiniens seraient déjà morts à ce jour dans les opérations menées hors de Gaza). Or, visiblement, ni le Shin Bet ni le renseignement militaire n’avaient jamais soupçonné leur existence. « Au moment de vérité, nous ne savions rien », écrit Amos Harel, le correspondant militaire du quotidien Haaretz depuis 26 ans.
Rien, ni les capacités pourtant célèbres en termes de cybercontrôle de la population palestinienne (le Shin Bet sait quotidiennement quel café ou quel thé ont bu les dirigeants du Hamas au petit déjeuner), ni les « murs de protection » érigés par Israël pour enfermer les Palestiniens — dans une prison à ciel ouvert à Gaza ou dans des ghettos surveillés derrière des checkpoints en Cisjordanie —, ni les « collabos » implantés dans les organisations et regroupements politiques palestiniens de tout ordre, ni enfin la supériorité militaire incommensurable de l’armée israélienne n’ont permis de déceler ne serait-ce que le germe de ce qui allait advenir ce 7 octobre. Pour mémoire, la veille, Israël avait commémoré le 50e anniversaire du déclenchement de la guerre d’octobre 1973 par l’Égypte et la Syrie où, les trois premiers jours, l’armée israélienne, totalement surprise, avait été sur le recul.
Les Israéliens se focalisent aujourd’hui sur le fiasco des services de renseignement, comme ils l’ont fait en 1973. Ce fiasco est indéniable. Mais il n’est pas que « technique », ou « opérationnel ». Il est d’abord politique et même culturel. Dans le communiqué qu’il a lu au démarrage de l’offensive palestinienne, Mohamed Deïf, le chef des brigades Ezzedine Al-Qassam, la branche armée du Hamas, l’a dit sans ambiguïté. En bref : l’occupation des territoires palestiniens empire de jour en jour. Le nombre des Palestiniens tués quasi quotidiennement par l’armée ou les colons augmente sans cesse. Les conditions d’incarcération des prisonniers politiques palestiniens ont été lourdement aggravées par le nouveau ministre israélien de la police, le kahaniste Itamar Ben-Gvir. Les négociations sur un « échange humanitaire » entre le Hamas et Israël — c’est-à-dire sur un échange de prisonniers palestiniens et de soldats israéliens — sont au point mort. Comme l’affirme le chef de l’aile militaire du Hamas :
L’occupation doit être éradiquée. (…) Le temps où ils agissaient en toute impunité est révolu
L’impasse du projet d’entente avec l’Arabie saoudite
Il y a encore quelques jours, après ses rencontres aux États-Unis avec le président américain Joe Biden et Mohamed Ben Salman (MBS), le prince héritier saoudien, Benyamin Nétanyahou et ses services péroraient, martelant qu’une entente israélo-saoudienne était devenue une certitude. C’était sinon une affaire de jours, du moins de quelques mois. MBS confirmait à moitié, assurant que « Jérusalem et Riyad se rapprochent chaque jour ». Les mots ne coûtent rien. Nétanyahou présentait sa visite aux États-Unis comme le plus grand succès de sa carrière politique. Les Palestiniens ? Ils ne sont pas conviés à la table. Leur destin sera réglé à trois, entre Washington, Riyad et Jérusalem. On leur donnera des sous, et ils devront s’en contenter. Que pourraient-ils faire d’autre ?
Ce projet ubuesque assis sur la conviction que la « question palestinienne » est désormais derrière nous a aujourd’hui le bec dans l’eau. Le message lancé par le Hamas et ses forces le 7 octobre est limpide : Israël, les États-Unis et l’Arabie peuvent concocter tous les projets qu’ils veulent, rien ne se fera sans tenir compte des revendications palestiniennes. Ou, plus simplement, sans tenir compte de l’existence des Palestiniens. Certes ils sont extrêmement affaiblis, politiquement, mais aussi socialement, et l’opération « déluge d’Al-Aqsa », comme l’ont nommée pompeusement les brigades Ezzedine Al-Qassam, ne contribuera pas à modifier de manière consistante cet état des choses. Elle pourrait même l’aggraver.
D’ores et déjà, la frange ouvertement fasciste du gouvernement israélien, celle incarnée par les ministres Ben-Gvir et Bezalel Smotrich a le vent en poupe pour prendre au plus tôt des décisions beaucoup plus radicales contre les Palestiniens. Mais le 7 octobre a montré aux Israéliens qu’ils ne se déferont pas aisément de leurs encombrants « autochtones ». Et que la plus grande des adversités ne parvient pas à les faire capituler.
Quels lendemains ?
L’attaque du Hamas montre que les murs les plus hauts et les plus blindés restent friables. Mais on doit s’attendre dans un premier temps à une riposte d’une intensité peut-être encore jamais vue du côté de l’armée israélienne. Comme on le sait, après l’échec de l’opération militaire au Liban en 2006 (la « guerre des 33 jours »), l’armée israélienne a adopté la « doctrine Dahiya », qui veut que la destruction massive des infrastructures et de l’habitat en zones civiles constitue une stratégie de combat privilégiée pour imposer sa « dissuasion ». L’armée israélienne, dans ses nombreuses offensives militaires précédentes sur Gaza, avait déjà frappé chaque fois massivement les civils palestiniens. Là, Israël va, du moins dans un premier temps, bénéficier d’un soutien américano-européen (qui a déjà commencé). Et les images des corps de civils israéliens froidement assassinés chez eux par les forces du Hamas ne vont pas aider à modifier ce soutien.
On ne peut pas exclure une extension de la guerre à d’autres fronts. Le plus difficile pour Israël serait un soulèvement palestinien en Cisjordanie. Jusqu’ici, on ne le voit pas percer. Mais rien ne dit qu’il n’adviendra pas. De même, le Hezbollah pourrait pour la première fois s’engager dans un conflit qui ne le touche pas directement. Sa capacité de nuisance, surtout dans une guerre de missiles, est certaine. Sa dimension réelle et la capacité israélienne à y répondre sont moins connues. Mais « on peut supposer que le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a aujourd’hui le doigt sur la gâchette »
Et les dirigeants israéliens ont déjà lancé des signaux vers l’Iran pour que le Hezbollah se tienne à l’écart. Mais tous les Israéliens craignent l’ouverture d’un « front Nord ». La mémoire des attaques inattendue aux missiles du mouvement libanais sur le nord d’Israël en 2006 reste vive. Et les militaires savent que malgré les bombardements systématiques en Syrie des convois iraniens fournissant le Hezbollah en armes, ce dernier a très fortement accru et amélioré son arsenal de missiles.
La question des prisonniers et des otages
Enfin, on ne peut exclure une opération israélienne de réoccupation territoriale de la bande de Gaza, ou de certaines parties de l’enclave côtière — bien qu’elle suscite beaucoup de réticences du côté de l’état-major israélien. Cependant, les appels à la vengeance entendus de toutes parts en Israël se heurteront vite à quelques obstacles. Le soutien occidental pourrait vite s’effriter si, cette fois, les images des conséquences des bombardements israéliens sur la population civile de Gaza sont à nouveau insoutenables, comme cela est advenu lors des affrontements du printemps 2021. Et le Hamas aurait capturé, cette fois, une centaine d’Israéliens, à la fois des militaires et des civils. Quelle que soit l’étendue de la réaction israélienne sur Gaza, Israël sera confronté à un dilemme beaucoup plus important que celui qui existait avant le 6 octobre 2023. Le prix politique pour obtenir la libération de cent prisonniers n’est pas le même que celui d’une seule personne.
Aujourd’hui, la rage et la vexation dues à son propre aveuglement l’emportent du côté israélien. Le général Giora Eiland, un militaire pourtant jugé pondéré, s’exclame :
Il faut les enfermer [les Palestiniens], il faut qu’ils n’aient accès ni à l’eau ni à la nourriture, jusqu’à ce qu’ils nous restituent nos otages !
Cependant, il est à craindre que, pour Israël, les choses soient moins simples à l’avenir. Dimanche 8 octobre au matin, sur la chaîne de télévision N12, un débat oppose divers interlocuteurs. La tension est palpable. La plupart des intervenants appellent à prendre immédiatement les mesures les plus drastiques qui soient. Puis le débat se focalise sur les otages : faut-il les sauver ou les sacrifier ? Une journaliste, Dafna Liel, s’inquiète : « Dans le cabinet de sécurité, il y a le même débat, note-t-elle. Smotrich et Ben Gvir poussent à raser Gaza, et tant pis pour les otages ». Le général Amos Gilad, ex-chef des renseignements israéliens, s’exaspère et clame :
[Ces gens] n’ont jamais combattu. Ils sont les responsables de nos échecs. Gaza détenait un otage, Gilad Shalit. Tsahal l’a-t-il libéré ? Le Shin Bet l’a-t-il trouvé ? Non. Pourtant il était détenu à 5 kilomètres d’une de nos casernes. Mais il a fallu négocier pour le libérer. Alors maintenant qu’il y a des dizaines et des dizaines d’otages, bien sûr que nous allons négocier ! Et nous n’allons pas réoccuper Gaza.
Un discours qui se veut rationnel et reste peu audible en Israël aujourd’hui. Mais un débat qui montre aussi la profondeur du désarroi qui s’est emparé des Israéliens.
Sylvain Cypel
Source : Orientxxi.info
C’était il y aura bientôt 150 ans. Ce 25 juin 1876, une coalition de guerriers sioux et cheyennes avec à leur tête les chefs tribaux Sitting Bull et Crazy Horse parvient à leurrer le 7e régiment de cavalerie de l’armée américaine pour le diriger vers une cuvette nommé Little Big Horn, dans l’état du Montana, au Nord-Ouest des États-Unis. La troupe était emmenée par le lieutenant-colonel George Armstrong Custer, notoirement connu pour son racisme colonial exacerbé à l’égard de ceux qu’il appelait improprement les « Indiens » — c’est-à-dire les populations indigènes. Custer y perdit la vie, et avec lui 40 % de ses hommes, sans compter les blessés.
Une victoire des « indigènes »
Ce fut l’une des rarissimes « victoires » que sont parvenus à remporter les indigènes lors de la « conquête de l’Ouest » menée contre eux par le gouvernement américain et qui s’accompagnait d’une dépossession systématique de leurs terres et propriétés. Une dépossession destinée à regrouper ces derniers dans des « réserves » — le terme « bantoustan » n’avait pas encore été inventé. Custer, gonflé de certitudes, acquis à l’idée que les « Indiens » n’étaient que des barbares incapables, des êtres inférieurs, s’engouffra dans la cuvette. Il fut surpris par l’organisation des guerriers sioux et cheyennes, l’armement dont ils disposaient, leur préparation au combat, leur mobilité. La bataille ne dura que 36 heures, mais la défaite ponctuelle laissa les Américains pantois, quasi ahuris.
Cette défaite a marqué profondément la culture américaine. On ne compte plus les romans, les pièces de théâtre, les films consacrés à cet événement. Pendant 100 ans (de 1876 à 1976), Custer incarna le héros américain face à l’autochtone barbare, l’adepte du scalp. Mais depuis le film Little Big Man (1976) et d’autres films et ouvrages, renversement total : le chef indigène est devenu dans la culture américaine le héros défendant sa juste cause. Toutefois, la victoire des autochtones à Little Big Horn ne modifia rien du devenir que les colons européens leur promettaient. Le rapport global des forces leur était par trop défavorable. Le gouvernement américain et son armée mirent en place moult « commissions d’enquête » pour tenter de comprendre comment la faillite militaire avait pu advenir. Mais la conquête de l’Ouest par les colons se poursuivit avec plus d’acharnement encore.
En Israël aussi, d’innombrables voix appellent déjà à la constitution de « commissions d’enquête » pour punir les coupables de l’incroyable « fiasco sécuritaire » du 7 octobre 2023. À la télévision, sur les ondes des chaînes de radio, dans la presse, élus du peuple et experts en tout genre multiplient les diatribes et les conseils aux décideurs. L’un avertit : pour que cela ne se renouvelle pas, il faudra tuer à Gaza « des milliers de personnes ». Un autre assure qu’il faut « nettoyer Gaza sans faire de prisonniers ». Un autre encore explique que, tant que les Palestiniens resteront là, aucune solution n’interviendra. Comprendre : il faudra bien finir par les expulser. Un ex-numéro deux de l’état-major israélien, Dan Harel, s’exclame sur le canal 13 de la télévision : « Désormais, soit on y va, soit on n’a plus rien à faire ici ». Bref l’exposition de la défaite suscite essentiellement des sentiments de revanche, de vengeance. La musique est connue : Israël a toujours été trop gentil avec les Palestiniens. Quant à la stupéfaction qui saisit la quasi-totalité des citoyens, elle est la même que celle qui s’était emparée des Américains après Little Big Horn : mais qui aurait imaginé que ces sauvages, ces incultes, soient capables de nous berner à ce point !
Il est encore trop tôt pour tirer le bilan de ce qui est advenu le 7 octobre. Mais on peut résumer quelques constats.
Le fiasco des services de renseignement
Une opération de l’ampleur de celle lancée sous la houlette du Hamas ne peut se mener sans avoir été préparée depuis plusieurs mois — peut-être des années. Et des milliers de personnes, jeunes pour la plupart, y ont participé (plusieurs centaines de jeunes Palestiniens seraient déjà morts à ce jour dans les opérations menées hors de Gaza). Or, visiblement, ni le Shin Bet ni le renseignement militaire n’avaient jamais soupçonné leur existence. « Au moment de vérité, nous ne savions rien », écrit Amos Harel, le correspondant militaire du quotidien Haaretz depuis 26 ans.
Rien, ni les capacités pourtant célèbres en termes de cybercontrôle de la population palestinienne (le Shin Bet sait quotidiennement quel café ou quel thé ont bu les dirigeants du Hamas au petit déjeuner), ni les « murs de protection » érigés par Israël pour enfermer les Palestiniens — dans une prison à ciel ouvert à Gaza ou dans des ghettos surveillés derrière des checkpoints en Cisjordanie —, ni les « collabos » implantés dans les organisations et regroupements politiques palestiniens de tout ordre, ni enfin la supériorité militaire incommensurable de l’armée israélienne n’ont permis de déceler ne serait-ce que le germe de ce qui allait advenir ce 7 octobre. Pour mémoire, la veille, Israël avait commémoré le 50e anniversaire du déclenchement de la guerre d’octobre 1973 par l’Égypte et la Syrie où, les trois premiers jours, l’armée israélienne, totalement surprise, avait été sur le recul.
Les Israéliens se focalisent aujourd’hui sur le fiasco des services de renseignement, comme ils l’ont fait en 1973. Ce fiasco est indéniable. Mais il n’est pas que « technique », ou « opérationnel ». Il est d’abord politique et même culturel. Dans le communiqué qu’il a lu au démarrage de l’offensive palestinienne, Mohamed Deïf, le chef des brigades Ezzedine Al-Qassam, la branche armée du Hamas, l’a dit sans ambiguïté. En bref : l’occupation des territoires palestiniens empire de jour en jour. Le nombre des Palestiniens tués quasi quotidiennement par l’armée ou les colons augmente sans cesse. Les conditions d’incarcération des prisonniers politiques palestiniens ont été lourdement aggravées par le nouveau ministre israélien de la police, le kahaniste Itamar Ben-Gvir. Les négociations sur un « échange humanitaire » entre le Hamas et Israël — c’est-à-dire sur un échange de prisonniers palestiniens et de soldats israéliens — sont au point mort. Comme l’affirme le chef de l’aile militaire du Hamas :
L’occupation doit être éradiquée. (…) Le temps où ils agissaient en toute impunité est révolu
L’impasse du projet d’entente avec l’Arabie saoudite
Il y a encore quelques jours, après ses rencontres aux États-Unis avec le président américain Joe Biden et Mohamed Ben Salman (MBS), le prince héritier saoudien, Benyamin Nétanyahou et ses services péroraient, martelant qu’une entente israélo-saoudienne était devenue une certitude. C’était sinon une affaire de jours, du moins de quelques mois. MBS confirmait à moitié, assurant que « Jérusalem et Riyad se rapprochent chaque jour ». Les mots ne coûtent rien. Nétanyahou présentait sa visite aux États-Unis comme le plus grand succès de sa carrière politique. Les Palestiniens ? Ils ne sont pas conviés à la table. Leur destin sera réglé à trois, entre Washington, Riyad et Jérusalem. On leur donnera des sous, et ils devront s’en contenter. Que pourraient-ils faire d’autre ?
Ce projet ubuesque assis sur la conviction que la « question palestinienne » est désormais derrière nous a aujourd’hui le bec dans l’eau. Le message lancé par le Hamas et ses forces le 7 octobre est limpide : Israël, les États-Unis et l’Arabie peuvent concocter tous les projets qu’ils veulent, rien ne se fera sans tenir compte des revendications palestiniennes. Ou, plus simplement, sans tenir compte de l’existence des Palestiniens. Certes ils sont extrêmement affaiblis, politiquement, mais aussi socialement, et l’opération « déluge d’Al-Aqsa », comme l’ont nommée pompeusement les brigades Ezzedine Al-Qassam, ne contribuera pas à modifier de manière consistante cet état des choses. Elle pourrait même l’aggraver.
D’ores et déjà, la frange ouvertement fasciste du gouvernement israélien, celle incarnée par les ministres Ben-Gvir et Bezalel Smotrich a le vent en poupe pour prendre au plus tôt des décisions beaucoup plus radicales contre les Palestiniens. Mais le 7 octobre a montré aux Israéliens qu’ils ne se déferont pas aisément de leurs encombrants « autochtones ». Et que la plus grande des adversités ne parvient pas à les faire capituler.
Quels lendemains ?
L’attaque du Hamas montre que les murs les plus hauts et les plus blindés restent friables. Mais on doit s’attendre dans un premier temps à une riposte d’une intensité peut-être encore jamais vue du côté de l’armée israélienne. Comme on le sait, après l’échec de l’opération militaire au Liban en 2006 (la « guerre des 33 jours »), l’armée israélienne a adopté la « doctrine Dahiya », qui veut que la destruction massive des infrastructures et de l’habitat en zones civiles constitue une stratégie de combat privilégiée pour imposer sa « dissuasion ». L’armée israélienne, dans ses nombreuses offensives militaires précédentes sur Gaza, avait déjà frappé chaque fois massivement les civils palestiniens. Là, Israël va, du moins dans un premier temps, bénéficier d’un soutien américano-européen (qui a déjà commencé). Et les images des corps de civils israéliens froidement assassinés chez eux par les forces du Hamas ne vont pas aider à modifier ce soutien.
On ne peut pas exclure une extension de la guerre à d’autres fronts. Le plus difficile pour Israël serait un soulèvement palestinien en Cisjordanie. Jusqu’ici, on ne le voit pas percer. Mais rien ne dit qu’il n’adviendra pas. De même, le Hezbollah pourrait pour la première fois s’engager dans un conflit qui ne le touche pas directement. Sa capacité de nuisance, surtout dans une guerre de missiles, est certaine. Sa dimension réelle et la capacité israélienne à y répondre sont moins connues. Mais « on peut supposer que le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a aujourd’hui le doigt sur la gâchette »
Et les dirigeants israéliens ont déjà lancé des signaux vers l’Iran pour que le Hezbollah se tienne à l’écart. Mais tous les Israéliens craignent l’ouverture d’un « front Nord ». La mémoire des attaques inattendue aux missiles du mouvement libanais sur le nord d’Israël en 2006 reste vive. Et les militaires savent que malgré les bombardements systématiques en Syrie des convois iraniens fournissant le Hezbollah en armes, ce dernier a très fortement accru et amélioré son arsenal de missiles.
La question des prisonniers et des otages
Enfin, on ne peut exclure une opération israélienne de réoccupation territoriale de la bande de Gaza, ou de certaines parties de l’enclave côtière — bien qu’elle suscite beaucoup de réticences du côté de l’état-major israélien. Cependant, les appels à la vengeance entendus de toutes parts en Israël se heurteront vite à quelques obstacles. Le soutien occidental pourrait vite s’effriter si, cette fois, les images des conséquences des bombardements israéliens sur la population civile de Gaza sont à nouveau insoutenables, comme cela est advenu lors des affrontements du printemps 2021. Et le Hamas aurait capturé, cette fois, une centaine d’Israéliens, à la fois des militaires et des civils. Quelle que soit l’étendue de la réaction israélienne sur Gaza, Israël sera confronté à un dilemme beaucoup plus important que celui qui existait avant le 6 octobre 2023. Le prix politique pour obtenir la libération de cent prisonniers n’est pas le même que celui d’une seule personne.
Aujourd’hui, la rage et la vexation dues à son propre aveuglement l’emportent du côté israélien. Le général Giora Eiland, un militaire pourtant jugé pondéré, s’exclame :
Il faut les enfermer [les Palestiniens], il faut qu’ils n’aient accès ni à l’eau ni à la nourriture, jusqu’à ce qu’ils nous restituent nos otages !
Cependant, il est à craindre que, pour Israël, les choses soient moins simples à l’avenir. Dimanche 8 octobre au matin, sur la chaîne de télévision N12, un débat oppose divers interlocuteurs. La tension est palpable. La plupart des intervenants appellent à prendre immédiatement les mesures les plus drastiques qui soient. Puis le débat se focalise sur les otages : faut-il les sauver ou les sacrifier ? Une journaliste, Dafna Liel, s’inquiète : « Dans le cabinet de sécurité, il y a le même débat, note-t-elle. Smotrich et Ben Gvir poussent à raser Gaza, et tant pis pour les otages ». Le général Amos Gilad, ex-chef des renseignements israéliens, s’exaspère et clame :
[Ces gens] n’ont jamais combattu. Ils sont les responsables de nos échecs. Gaza détenait un otage, Gilad Shalit. Tsahal l’a-t-il libéré ? Le Shin Bet l’a-t-il trouvé ? Non. Pourtant il était détenu à 5 kilomètres d’une de nos casernes. Mais il a fallu négocier pour le libérer. Alors maintenant qu’il y a des dizaines et des dizaines d’otages, bien sûr que nous allons négocier ! Et nous n’allons pas réoccuper Gaza.
Un discours qui se veut rationnel et reste peu audible en Israël aujourd’hui. Mais un débat qui montre aussi la profondeur du désarroi qui s’est emparé des Israéliens.
Sylvain Cypel
Source : Orientxxi.info
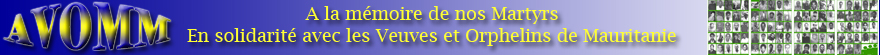
 Actualités
Actualités





















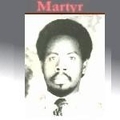
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)