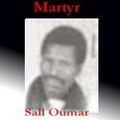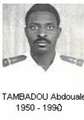Citer Fidel Castro parmi les plus grosses fortunes de la planète relève de l’offense suprême. Forbes, bimensuel américain des milieux d’affaires l’a osé, et cela participe d’un combat politique.
Jusqu’à 2003, le magazine américain attribuait systématiquement à Fidel Alejandro Castro Ruiz, comme fortune personnelle, 10 % du Produit national brut de Cuba. À partir de 2004, la progression fulgurante de la richesse du lider maximo, de 150 millions de dollars à 550 millions en 2005 puis 900 millions cette année, suggère que Fidel Castro est le chef d’Etat le plus corrompu, sinon l’un des meilleurs gestionnaires du globe.
Fidel Castro n’est cependant pas le premier leader révolutionnaire du sud à être accusé de corruption. Pour ceux-là, le fait de s’enrichir au pouvoir tire à conséquence : ils sont des imposteurs au regard de leur engagement idéologique. Pourtant, l’essentiel des chefs d’Etat progressistes qui ont émergé en même temps que le chef d’Etat cubain dans la seconde moitié des années 1950 ont pu convaincre après leur chute ou leur mort, qu’ils étaient incorruptibles : Nasser, Kwamé Nkrumah, Ben Bella, Modibo Keïta, Sékou Touré et même Moctar Ould Daddah n’avaient pas de fortune planquée en Suisse. Mieux, s’agissant de l’ancien président tanzanien, Julius Nyerere, le parti a même dû ouvrir une souscription pour lui construire une maison après son retrait du pouvoir.
La seconde génération de révolutionnaires aussi a su tirer son épingle du jeu, assez délicat du reste, de l’exercice du pouvoir d’Etat sans trop se compromettre. Ainsi, le Flight captain, John Jerry Rawlings, au Ghana, et les sandinistes au Nicaragua ont-ils pu quitter le pouvoir sans craindre des poursuites pour indélicatesse financière. Au Burkina Faso, le contentieux entre le défunt président du Faso Thomas Sankara et ses successeurs porta sur quelque 83 millions, reliquat d’un don d’une centaine de millions de l’ancien président ivoirien Félix Houphouët que les chefs historiques avaient convenu de ne pas verser dans le budget et de l’utiliser comme fonds secrets. La somme fut retrouvée intacte.
Ce n’est pas tant le cas des alliés de l’Occident pour lesquels l’opinion n’a pas besoin que survienne une alternance gouvernementale pour apprendre de scandaleuses fuites de capitaux, partie des prêts ou de l’aide au développement, si ce n’est des bénéfices des productions minières, agricoles ou pétrolières. Les théoriciens de la corruption graduelle comme moyen de redistribution des richesses et de stabilisation sociale étaient Félix Houphouët-Boigny et Mobutu Sese Seko, moins discrets, qui en avaient fixé les règles pour la petite bourgeoisie : «Si vous désirez voler, volez un peu et intelligemment, d’une jolie manière. Si vous volez tant que vous deveniez riche en une seule nuit, on vous attrapera… »
Leur époque est quand même révolue. L’argument de rigueur qui fondait la politique des Etats-Unis et de ses alliés à l’époque de la guerre froide était d’empêcher les ressources de l’Afrique de tomber entre des mains hostiles. Maintenant, c’est l’Afrique du Sud qui est le pays-phare du continent même si l’on oublie que sa démocratie, qui fait référence aujourd’hui, est le fruit d’une lutte opiniâtre de la majorité noire avec comme avant-garde l’African National Congress (ANC), allié au Parti communiste sud-africain et soutenu principalement et jusqu’au bout par une Cuba socialiste.
Fidel Castro lui-même n’est plus que le vestige d’un passé glorieux. Il reste personnellement vulnérable face aux critiques dont il est la cible alors que Cuba est en train de rompre son isolement politique et économique avec de nouveaux dirigeants latino-américains qui réinventent à chaque élection, de Hugo Chavez, au Venezuela, à Evo Morales, en Bolivie, en passant par Lula, au Brésil, l’anti-américanisme militant. Mais les règles qui régissent ce processus ne semblent pas devoir se complaire de la faconde intarissable d’un leader au pouvoir depuis plus de 47 ans. Lequel polémique pendant 3 heures pour réfuter des accusations de richesse alors que les principaux dirigeants du Parti communiste chinois s’en accommodent pourvu que leur pays impose peu à peu son hégémonie sur un marché mondial qui ne fut jamais régi que par le mode d’échange capitaliste même au bon vieux temps des blocs.
La guerre du « Capital »
Il reste que rien n’est plus injuste que cette calomnie à l’endroit de ce fils de la grande bourgeoisie terrienne qui, dans la foulée de la révolution victorieuse, nationalisa plusieurs milliers d’hectares de sa famille. La confiscation du domaine agricole des Castro Ruiz ne se passa d’ailleurs pas sans heurts : Madame Maria Mediadora, la mère du Premier ministre cubain déclara que nul ne lui prendrait ses terres. Ramon Castro, le frère aîné, se chargea de la convaincre de rendre son fusil. Faute de cette fortune qui eût été colossale dans un environnement politique capitaliste, Forbes lui attribue le bénéfice de quelques entreprises d’Etat.
C’est de bonne guerre. Dans les pays d’option révolutionnaire, les entreprises d’Etat ou sociétés nationales sont les piliers sur lesquels les dirigeants comptent édifier l’Etat socialiste. Kwame Nkrumah le soutenait encore devant l’Assemblée nationale ghanéenne un an avant sa destitution. En 1966, une commission nommée pour faire la recherche sur ses biens trouvera qu’il possédait en espèces et en biens divers l’équivalent de 2 322 009 livres Sterling. Mais il s’avéra vite que les propriétés et les sommes ainsi recensées n’ont jamais été à son usage personnel. Comme c’est le cas pour Fidel Castro qui revendique seulement un salaire mensuel de 40 dollars. Ces accusations de corruption ont donc le même fondement idéologique du Ghana à Cuba.
Fidel Castro a avoué, un certain jour, ne pas être venu à bout du « Capital », le fameux classique de Karl Marx, qu’il avait acheté en 1948, lors d’un voyage à New York. Or, la question de la révolution telle que l’abordent Karl Marx et Friedrich Engels, comme solution de la crise du capitalisme avancé dans les pays industrialisés d’Europe, ne concorde pas avec la situation de Cuba. Lénine avait trouvé une voie originale pour la Russie, un raccourci violent et meurtrier, avec une pression terrible sur le marché libre et la terre. Il eut d’ailleurs besoin, dès 1921, d’un répit avec la Nouvelle politique économique (NEP) après la sanglante répression des marins et ouvriers insurgés de Cronstadt. Alors, l’hypothèse que la Révolution bolchevique de 1917 n’était que la révolution bourgeoise la plus sanglante de l’histoire pouvait être retenue par les révolutionnaires les moins dogmatiques.
La tâche de Fidel Castro et de ses compagnons n’en serait que plus ardue encore. Il leur faut, comme d’autres dirigeants révolutionnaires du tiers-monde, réaliser un projet de société « socialiste » dans laquelle, après la nationalisation d’un secteur privé majoritairement étranger, domine un capitalisme d’Etat embryonnaire. Mais la société cubaine reste économiquement arriérée et il faut que la direction politique y joue le rôle dévolu aux investisseurs privés, aux capitalistes, car la planification du développement économique ne peut être prise en charge que par l’Etat à travers des sociétés nationales pour éviter la mainmise du capitalisme international.
L’exception cubaine
Cette politique a conduit à une impasse partout où elle a été appliquée dès lors que la détérioration des termes de l’échange n’a pas permis aux pays sous-développés de trouver dans le surplus des transactions commerciales internationales les investissements nécessaires à l’industrialisation. L’expérience de Cuba reste donc exceptionnelle dans l’histoire des révolutions non seulement par sa résistance au blocus économique et aux pressions militaires de la superpuissance hégémonique mais aussi par sa vitalité et sa capacité de riposte sur son territoire et partout ailleurs sur les théâtres d’opération contre l’impérialisme, le colonialisme, le sionisme et l’apartheid.
Quelques similitudes existaient entre Cuba sous Fidel Castro et le Ghana de Kwame Nkrumah qui tiennent des obligations internationalistes que requiert leur option socialiste. Pour voler au secours de la Guinée indépendante boycottée par la France, Nkrumah débloque dix millions de Livres Sterling et l’aide qu’il accordera aux différents mouvements de libération atteindra, à sa chute, le quart des réserves monétaires du pays à l’indépendance. Son bureau des Affaires africaines distribue sans compter l’argent aux combattants de la liberté et aux révolutionnaires africains pour leurs activités subversives contre les régimes néo-coloniaux.
Cuba sera autrement plus prodigue sur ce chapitre de la solidarité, de la fraternité et du désintéressement et Fidel Castro, moins prolixe pour une fois sur la question, « Un seul chiffre… » déclare-t-il lors de la conférence de presse qui clôture le sommet ibéro-américain de Porto en octobre 1998. « Ces trente dernières années, environ un demi-million de Cubains ont participé à des missions internationalistes qui pouvaient se prolonger parfois deux ans ou plus, en Afrique ou dans d’autres parties du monde, de façon absolument bénévole, dans les endroits les plus difficiles. Comment obtient-on cela, sinon à partir de valeurs, de conscience inculquées au peuple ? »
Il est étonnant que les différentes expéditions de la coopération militaire cubaine, des maquis d’Afrique et d’Amérique Latine aux plaines de Cuito Cuinavale, en passant par les hauteurs du Golan, n’aient pas eu sur l’économie de l’île, sous embargo, le ressac néfaste que connaîtront les Etats-Unis après le Vietnam sinon l’Irak de Saddam Hussein après sa guerre contre l’Iran. Le secret de cette vitalité tient-il dans la botte secrète du gouvernement cubain qui avait créé au sein du ministère cubain de l’Intérieur un département de la Monnaie convertible, lequel avait reçu mandat des autorités cubaines de contourner l’embargo américain pour trouver des devises ?
Ce département doté d’une section opérationnelle a certainement permis de mener à bien les missions internationalistes. La plus fameuse de celles-ci reste l’engagement progressif de 300 000 combattants des Forces armées cubaines aux côtés des Forces armées populaires d’Angola dès la proclamation de l’indépendance pour bloquer l’avancée des troupes sud-africaines et contenir leurs offensives répétées sur des années. Quand l’Union soviétique, qui assurait la logistique, s’est disloquée, près de 50 000 Cubains se trouvaient dans les plaines de l’Afrique australe devant les chars sud-africains.
Il fallait les nourrir et les apprêter au combat. Le général Arnaldo Ochoa réussit la prouesse de bloquer les Sud-africains dans une bataille décisive à Cuito Cunavale, la plus grande bataille de chars de l’histoire dit-on. Mais, surtout, la plus grande défaite de l’armée du pays de l’apartheid. Les Etats-Unis, prenant acte du nouveau cours des événements, organisèrent le retrait de toutes les forces étrangères de la Zone. L’indépendance de la Namibie fut ainsi acquise et, de surcroît, le démantèlement de l’apartheid.
Quand le 14 juin 1989, une note d’information des Forces armées révolutionnaires publiée dans Gramma annonce l’arrestation du général Arnaldo Ochoa « pour actes graves de corruption et usage malhonnête de ressources financières », les Etats-Unis menaçaient depuis le début de l’année de faire des révélations sur l’implication de Cuba dans le trafic international de drogue. Le procès du général cubain et ses co-accusés mettra à jour 17 opérations de livraison de drogue colombienne aux Etats-Unis, la rencontre entre Pablo Escobar et Arnaldo Ochoa et les 20 000 dollars au compte de ce dernier dans une banque à Panama.
Malgré l’intervention des dirigeants sandinistes qui justifiaient la totalité de la somme par l’achat d’armes pour leur combat auquel Arnaldo Ochoa avait participé comme instructeur sur le front sud, notamment et leur opposition à une éventuelle peine de mort, les quatre principaux accusés furent fusillés. Témoignant que ceux-ci n’étaient convaincus d’aucun acte de trahison envers la révolution, les autorités cubaines n’en fustigèrent pas moins la conduite du groupe d’officiers du ministère des Forces armées et du ministère de l’Intérieur qui avaient mis en cause la sécurité et le prestige de Cuba. En effet, la coopération de services d’un Etat révolutionnaire avec des narcotrafiquants est moralement inadmissible et politiquement inacceptable.
Dans son récent ouvrage, « la politique étrangère des Etats-Unis », Henry Kissinger reconnaît que les pays d’Amérique latine trouvent que c’est une hypocrisie de leur part de vouloir mener la guerre à la drogue à l’étranger plutôt que de lutter contre l’accroissement de leur consommation intérieure. Qu’importe pour Cuba qui avait fixé la limite que la morale révolutionnaire ne permet pas de franchir, notamment quelques dizaines de milliers de dollars de provenance douteuse dans une banque étrangère. Et le magazine bimestriel Forbes voudrait que Fidel Castro, le lider maximo, la référence suprême de la révolution cubaine eût 900 millions de dollars quelque part, dans une introuvable banque étrangère ?
MOUSSA PAYE
Jusqu’à 2003, le magazine américain attribuait systématiquement à Fidel Alejandro Castro Ruiz, comme fortune personnelle, 10 % du Produit national brut de Cuba. À partir de 2004, la progression fulgurante de la richesse du lider maximo, de 150 millions de dollars à 550 millions en 2005 puis 900 millions cette année, suggère que Fidel Castro est le chef d’Etat le plus corrompu, sinon l’un des meilleurs gestionnaires du globe.
Fidel Castro n’est cependant pas le premier leader révolutionnaire du sud à être accusé de corruption. Pour ceux-là, le fait de s’enrichir au pouvoir tire à conséquence : ils sont des imposteurs au regard de leur engagement idéologique. Pourtant, l’essentiel des chefs d’Etat progressistes qui ont émergé en même temps que le chef d’Etat cubain dans la seconde moitié des années 1950 ont pu convaincre après leur chute ou leur mort, qu’ils étaient incorruptibles : Nasser, Kwamé Nkrumah, Ben Bella, Modibo Keïta, Sékou Touré et même Moctar Ould Daddah n’avaient pas de fortune planquée en Suisse. Mieux, s’agissant de l’ancien président tanzanien, Julius Nyerere, le parti a même dû ouvrir une souscription pour lui construire une maison après son retrait du pouvoir.
La seconde génération de révolutionnaires aussi a su tirer son épingle du jeu, assez délicat du reste, de l’exercice du pouvoir d’Etat sans trop se compromettre. Ainsi, le Flight captain, John Jerry Rawlings, au Ghana, et les sandinistes au Nicaragua ont-ils pu quitter le pouvoir sans craindre des poursuites pour indélicatesse financière. Au Burkina Faso, le contentieux entre le défunt président du Faso Thomas Sankara et ses successeurs porta sur quelque 83 millions, reliquat d’un don d’une centaine de millions de l’ancien président ivoirien Félix Houphouët que les chefs historiques avaient convenu de ne pas verser dans le budget et de l’utiliser comme fonds secrets. La somme fut retrouvée intacte.
Ce n’est pas tant le cas des alliés de l’Occident pour lesquels l’opinion n’a pas besoin que survienne une alternance gouvernementale pour apprendre de scandaleuses fuites de capitaux, partie des prêts ou de l’aide au développement, si ce n’est des bénéfices des productions minières, agricoles ou pétrolières. Les théoriciens de la corruption graduelle comme moyen de redistribution des richesses et de stabilisation sociale étaient Félix Houphouët-Boigny et Mobutu Sese Seko, moins discrets, qui en avaient fixé les règles pour la petite bourgeoisie : «Si vous désirez voler, volez un peu et intelligemment, d’une jolie manière. Si vous volez tant que vous deveniez riche en une seule nuit, on vous attrapera… »
Leur époque est quand même révolue. L’argument de rigueur qui fondait la politique des Etats-Unis et de ses alliés à l’époque de la guerre froide était d’empêcher les ressources de l’Afrique de tomber entre des mains hostiles. Maintenant, c’est l’Afrique du Sud qui est le pays-phare du continent même si l’on oublie que sa démocratie, qui fait référence aujourd’hui, est le fruit d’une lutte opiniâtre de la majorité noire avec comme avant-garde l’African National Congress (ANC), allié au Parti communiste sud-africain et soutenu principalement et jusqu’au bout par une Cuba socialiste.
Fidel Castro lui-même n’est plus que le vestige d’un passé glorieux. Il reste personnellement vulnérable face aux critiques dont il est la cible alors que Cuba est en train de rompre son isolement politique et économique avec de nouveaux dirigeants latino-américains qui réinventent à chaque élection, de Hugo Chavez, au Venezuela, à Evo Morales, en Bolivie, en passant par Lula, au Brésil, l’anti-américanisme militant. Mais les règles qui régissent ce processus ne semblent pas devoir se complaire de la faconde intarissable d’un leader au pouvoir depuis plus de 47 ans. Lequel polémique pendant 3 heures pour réfuter des accusations de richesse alors que les principaux dirigeants du Parti communiste chinois s’en accommodent pourvu que leur pays impose peu à peu son hégémonie sur un marché mondial qui ne fut jamais régi que par le mode d’échange capitaliste même au bon vieux temps des blocs.
La guerre du « Capital »
Il reste que rien n’est plus injuste que cette calomnie à l’endroit de ce fils de la grande bourgeoisie terrienne qui, dans la foulée de la révolution victorieuse, nationalisa plusieurs milliers d’hectares de sa famille. La confiscation du domaine agricole des Castro Ruiz ne se passa d’ailleurs pas sans heurts : Madame Maria Mediadora, la mère du Premier ministre cubain déclara que nul ne lui prendrait ses terres. Ramon Castro, le frère aîné, se chargea de la convaincre de rendre son fusil. Faute de cette fortune qui eût été colossale dans un environnement politique capitaliste, Forbes lui attribue le bénéfice de quelques entreprises d’Etat.
C’est de bonne guerre. Dans les pays d’option révolutionnaire, les entreprises d’Etat ou sociétés nationales sont les piliers sur lesquels les dirigeants comptent édifier l’Etat socialiste. Kwame Nkrumah le soutenait encore devant l’Assemblée nationale ghanéenne un an avant sa destitution. En 1966, une commission nommée pour faire la recherche sur ses biens trouvera qu’il possédait en espèces et en biens divers l’équivalent de 2 322 009 livres Sterling. Mais il s’avéra vite que les propriétés et les sommes ainsi recensées n’ont jamais été à son usage personnel. Comme c’est le cas pour Fidel Castro qui revendique seulement un salaire mensuel de 40 dollars. Ces accusations de corruption ont donc le même fondement idéologique du Ghana à Cuba.
Fidel Castro a avoué, un certain jour, ne pas être venu à bout du « Capital », le fameux classique de Karl Marx, qu’il avait acheté en 1948, lors d’un voyage à New York. Or, la question de la révolution telle que l’abordent Karl Marx et Friedrich Engels, comme solution de la crise du capitalisme avancé dans les pays industrialisés d’Europe, ne concorde pas avec la situation de Cuba. Lénine avait trouvé une voie originale pour la Russie, un raccourci violent et meurtrier, avec une pression terrible sur le marché libre et la terre. Il eut d’ailleurs besoin, dès 1921, d’un répit avec la Nouvelle politique économique (NEP) après la sanglante répression des marins et ouvriers insurgés de Cronstadt. Alors, l’hypothèse que la Révolution bolchevique de 1917 n’était que la révolution bourgeoise la plus sanglante de l’histoire pouvait être retenue par les révolutionnaires les moins dogmatiques.
La tâche de Fidel Castro et de ses compagnons n’en serait que plus ardue encore. Il leur faut, comme d’autres dirigeants révolutionnaires du tiers-monde, réaliser un projet de société « socialiste » dans laquelle, après la nationalisation d’un secteur privé majoritairement étranger, domine un capitalisme d’Etat embryonnaire. Mais la société cubaine reste économiquement arriérée et il faut que la direction politique y joue le rôle dévolu aux investisseurs privés, aux capitalistes, car la planification du développement économique ne peut être prise en charge que par l’Etat à travers des sociétés nationales pour éviter la mainmise du capitalisme international.
L’exception cubaine
Cette politique a conduit à une impasse partout où elle a été appliquée dès lors que la détérioration des termes de l’échange n’a pas permis aux pays sous-développés de trouver dans le surplus des transactions commerciales internationales les investissements nécessaires à l’industrialisation. L’expérience de Cuba reste donc exceptionnelle dans l’histoire des révolutions non seulement par sa résistance au blocus économique et aux pressions militaires de la superpuissance hégémonique mais aussi par sa vitalité et sa capacité de riposte sur son territoire et partout ailleurs sur les théâtres d’opération contre l’impérialisme, le colonialisme, le sionisme et l’apartheid.
Quelques similitudes existaient entre Cuba sous Fidel Castro et le Ghana de Kwame Nkrumah qui tiennent des obligations internationalistes que requiert leur option socialiste. Pour voler au secours de la Guinée indépendante boycottée par la France, Nkrumah débloque dix millions de Livres Sterling et l’aide qu’il accordera aux différents mouvements de libération atteindra, à sa chute, le quart des réserves monétaires du pays à l’indépendance. Son bureau des Affaires africaines distribue sans compter l’argent aux combattants de la liberté et aux révolutionnaires africains pour leurs activités subversives contre les régimes néo-coloniaux.
Cuba sera autrement plus prodigue sur ce chapitre de la solidarité, de la fraternité et du désintéressement et Fidel Castro, moins prolixe pour une fois sur la question, « Un seul chiffre… » déclare-t-il lors de la conférence de presse qui clôture le sommet ibéro-américain de Porto en octobre 1998. « Ces trente dernières années, environ un demi-million de Cubains ont participé à des missions internationalistes qui pouvaient se prolonger parfois deux ans ou plus, en Afrique ou dans d’autres parties du monde, de façon absolument bénévole, dans les endroits les plus difficiles. Comment obtient-on cela, sinon à partir de valeurs, de conscience inculquées au peuple ? »
Il est étonnant que les différentes expéditions de la coopération militaire cubaine, des maquis d’Afrique et d’Amérique Latine aux plaines de Cuito Cuinavale, en passant par les hauteurs du Golan, n’aient pas eu sur l’économie de l’île, sous embargo, le ressac néfaste que connaîtront les Etats-Unis après le Vietnam sinon l’Irak de Saddam Hussein après sa guerre contre l’Iran. Le secret de cette vitalité tient-il dans la botte secrète du gouvernement cubain qui avait créé au sein du ministère cubain de l’Intérieur un département de la Monnaie convertible, lequel avait reçu mandat des autorités cubaines de contourner l’embargo américain pour trouver des devises ?
Ce département doté d’une section opérationnelle a certainement permis de mener à bien les missions internationalistes. La plus fameuse de celles-ci reste l’engagement progressif de 300 000 combattants des Forces armées cubaines aux côtés des Forces armées populaires d’Angola dès la proclamation de l’indépendance pour bloquer l’avancée des troupes sud-africaines et contenir leurs offensives répétées sur des années. Quand l’Union soviétique, qui assurait la logistique, s’est disloquée, près de 50 000 Cubains se trouvaient dans les plaines de l’Afrique australe devant les chars sud-africains.
Il fallait les nourrir et les apprêter au combat. Le général Arnaldo Ochoa réussit la prouesse de bloquer les Sud-africains dans une bataille décisive à Cuito Cunavale, la plus grande bataille de chars de l’histoire dit-on. Mais, surtout, la plus grande défaite de l’armée du pays de l’apartheid. Les Etats-Unis, prenant acte du nouveau cours des événements, organisèrent le retrait de toutes les forces étrangères de la Zone. L’indépendance de la Namibie fut ainsi acquise et, de surcroît, le démantèlement de l’apartheid.
Quand le 14 juin 1989, une note d’information des Forces armées révolutionnaires publiée dans Gramma annonce l’arrestation du général Arnaldo Ochoa « pour actes graves de corruption et usage malhonnête de ressources financières », les Etats-Unis menaçaient depuis le début de l’année de faire des révélations sur l’implication de Cuba dans le trafic international de drogue. Le procès du général cubain et ses co-accusés mettra à jour 17 opérations de livraison de drogue colombienne aux Etats-Unis, la rencontre entre Pablo Escobar et Arnaldo Ochoa et les 20 000 dollars au compte de ce dernier dans une banque à Panama.
Malgré l’intervention des dirigeants sandinistes qui justifiaient la totalité de la somme par l’achat d’armes pour leur combat auquel Arnaldo Ochoa avait participé comme instructeur sur le front sud, notamment et leur opposition à une éventuelle peine de mort, les quatre principaux accusés furent fusillés. Témoignant que ceux-ci n’étaient convaincus d’aucun acte de trahison envers la révolution, les autorités cubaines n’en fustigèrent pas moins la conduite du groupe d’officiers du ministère des Forces armées et du ministère de l’Intérieur qui avaient mis en cause la sécurité et le prestige de Cuba. En effet, la coopération de services d’un Etat révolutionnaire avec des narcotrafiquants est moralement inadmissible et politiquement inacceptable.
Dans son récent ouvrage, « la politique étrangère des Etats-Unis », Henry Kissinger reconnaît que les pays d’Amérique latine trouvent que c’est une hypocrisie de leur part de vouloir mener la guerre à la drogue à l’étranger plutôt que de lutter contre l’accroissement de leur consommation intérieure. Qu’importe pour Cuba qui avait fixé la limite que la morale révolutionnaire ne permet pas de franchir, notamment quelques dizaines de milliers de dollars de provenance douteuse dans une banque étrangère. Et le magazine bimestriel Forbes voudrait que Fidel Castro, le lider maximo, la référence suprême de la révolution cubaine eût 900 millions de dollars quelque part, dans une introuvable banque étrangère ?
MOUSSA PAYE
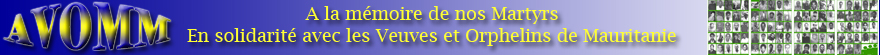
 Actualités
Actualités



















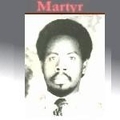
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)