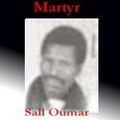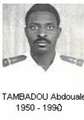Il pleut. Une pluie drue, froide. Le camp de réfugiés de Jalozai est noyé dans la boue.
Israrulah tient un parapluie au-dessus de sa tête. Enveloppé dans une couverture de laine, il surveille son minuscule commerce. Il vend des bonbons, des biscuits et quelques babioles.
Il vit à Jalozai depuis 25 ans. Il a fui son pays, l’Afghanistan, lorsque les Soviétiques l’ont envahi. Il avait 18 ans. Aujourd’hui, il en a 43. C’est ici, dans ce gigantesque camp de 10 kilomètres carrés, qu’il s’est marié et a eu ses 10 enfants.
Dans deux mois, le gouvernement pakistanais rasera le camp. Environ 20 000 réfugiés sont déjà partis. Il en reste 80 000, les plus vulnérables. Même si le tiers du camp a été détruit, les Afghans s’accrochent. Ce n’est pas la première fois que le Pakistan essaie de fermer Jalozai.
C’est le plus gros camp du pays. Il est situé à moins de 100 kilomètres de la frontière afghane. Le gouvernement pense qu’il est infiltré par les talibans et Al-Qaeda. La police n’y met jamais les pieds. Il est gardé par une milice locale et il est géré par les réfugiés. Les Pakistanais ne sont pas les bienvenus.
Poches de misère
Le Pakistan est une poudrière. Les groupes islamistes fleurissent, Al-Qaeda y a installé son quartier général et les talibans l’utilisent comme base arrière dans leur guerre contre l’OTAN en Afghanistan. En prime, il accueille un million de réfugiés afghans entassés depuis des années dans des camps, la plupart collés sur la frontière. Le Pakistan veut se débarrasser de ces poches de misère.
En juillet, il a réussi à fermer Kacha Gari, planté au cœur de Peshawar. On aperçoit d’ailleurs ses ruines en allant au centre-ville. Elles s’étalent, figées, le long d’une route principale. Kacha Gari existait depuis le début des années 80. Trente ans de misère rayés à coups de bulldozer.
Cette année, le gouvernement s’attaque à Jalozai.
Ce camp est une ville dans une ville avec son bazar, sa trentaine d’écoles, ses 70 mosquées et ses maisons en terre battue. Jalozai n’est pas une prison, les réfugiés peuvent circuler librement. Certains vont à Peshawar, située à une trentaine de kilomètres, pour essayer de dénicher du travail.
Les gens comme Israrulah se sont patiemment tricoté une vie au fil des années. Une vie de misère, mais une vie. Leur vie.
Selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (UNHCR), 70 % des Afghans qui vivent dans les camps pakistanais n’ont aucun revenu et 90 %, aucune qualification. Et la moitié de ceux qui travaillent ne trouvent que des petits boulots de misère.
Un oranger sous la pluie
Israrulah se débrouille avec son commerce. Il vit dans une maison dissimulée au fond d’une ruelle. Un oranger fleurit au milieu de la cour noyée sous la pluie. Israrulah appelle sa femme. Les enfants déboulent en courant, surexcités. Shams, 20 ans, arrive d’un pas souple. Il se présente avec un large sourire, main tendue. Il parle un peu anglais.
Shams est le neveu d’Israrulah. Au total, 30 personnes vivent dans la maison : oncles, tantes, frères, sœurs, cousins, cousines. Shams est né à Jalozai. Le camp est son unique patrie.
Il est attaché à Jalozai même si la vie est difficile. Et elle l’est de plus en plus depuis que le gouvernement pakistanais a commencé à le démanteler. La vie dans le camp est devenue périlleuse. Le soir, personne ne sort. Le jour, le moindre déplacement est hasardeux.
« On risque de me voler tout ce que j’ai dans les poches », dit Israrulah.
« Jalozai est très dangereux », affirme de son côté le vice-commissaire pakistanais responsable des camps, M. Faridullah. Il ne veut pas que les journalistes étrangers s’y aventurent à cause des risques de kidnapping.
« Le camp va fermer, il y a beaucoup de tensions », ajoute-t-il.
À travers la pluie et les maisons abandonnées, le camp a un air de fin du monde. Il est pratiquement désert. Quelques femmes, couvertes de voiles noirs de la tête aux pieds, marchent tête baissée, des hommes pressent le pas en jetant des regards hostiles, des chiens trottent entre les ruines.
« On devait raser Jalozai à l’automne 2007, mais l’hiver était proche et les gens n’avaient aucune place où aller, explique Rabia Ali, porte-parole de l’UNHCR. On a donc décidé d’attendre au printemps. »
Sauf qu’aujourd’hui, ils n’ont toujours pas de place où se réfugier.
Michèle Ouimet
Source: cyberpresse
(M)
Israrulah tient un parapluie au-dessus de sa tête. Enveloppé dans une couverture de laine, il surveille son minuscule commerce. Il vend des bonbons, des biscuits et quelques babioles.
Il vit à Jalozai depuis 25 ans. Il a fui son pays, l’Afghanistan, lorsque les Soviétiques l’ont envahi. Il avait 18 ans. Aujourd’hui, il en a 43. C’est ici, dans ce gigantesque camp de 10 kilomètres carrés, qu’il s’est marié et a eu ses 10 enfants.
Dans deux mois, le gouvernement pakistanais rasera le camp. Environ 20 000 réfugiés sont déjà partis. Il en reste 80 000, les plus vulnérables. Même si le tiers du camp a été détruit, les Afghans s’accrochent. Ce n’est pas la première fois que le Pakistan essaie de fermer Jalozai.
C’est le plus gros camp du pays. Il est situé à moins de 100 kilomètres de la frontière afghane. Le gouvernement pense qu’il est infiltré par les talibans et Al-Qaeda. La police n’y met jamais les pieds. Il est gardé par une milice locale et il est géré par les réfugiés. Les Pakistanais ne sont pas les bienvenus.
Poches de misère
Le Pakistan est une poudrière. Les groupes islamistes fleurissent, Al-Qaeda y a installé son quartier général et les talibans l’utilisent comme base arrière dans leur guerre contre l’OTAN en Afghanistan. En prime, il accueille un million de réfugiés afghans entassés depuis des années dans des camps, la plupart collés sur la frontière. Le Pakistan veut se débarrasser de ces poches de misère.
En juillet, il a réussi à fermer Kacha Gari, planté au cœur de Peshawar. On aperçoit d’ailleurs ses ruines en allant au centre-ville. Elles s’étalent, figées, le long d’une route principale. Kacha Gari existait depuis le début des années 80. Trente ans de misère rayés à coups de bulldozer.
Cette année, le gouvernement s’attaque à Jalozai.
Ce camp est une ville dans une ville avec son bazar, sa trentaine d’écoles, ses 70 mosquées et ses maisons en terre battue. Jalozai n’est pas une prison, les réfugiés peuvent circuler librement. Certains vont à Peshawar, située à une trentaine de kilomètres, pour essayer de dénicher du travail.
Les gens comme Israrulah se sont patiemment tricoté une vie au fil des années. Une vie de misère, mais une vie. Leur vie.
Selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (UNHCR), 70 % des Afghans qui vivent dans les camps pakistanais n’ont aucun revenu et 90 %, aucune qualification. Et la moitié de ceux qui travaillent ne trouvent que des petits boulots de misère.
Un oranger sous la pluie
Israrulah se débrouille avec son commerce. Il vit dans une maison dissimulée au fond d’une ruelle. Un oranger fleurit au milieu de la cour noyée sous la pluie. Israrulah appelle sa femme. Les enfants déboulent en courant, surexcités. Shams, 20 ans, arrive d’un pas souple. Il se présente avec un large sourire, main tendue. Il parle un peu anglais.
Shams est le neveu d’Israrulah. Au total, 30 personnes vivent dans la maison : oncles, tantes, frères, sœurs, cousins, cousines. Shams est né à Jalozai. Le camp est son unique patrie.
Il est attaché à Jalozai même si la vie est difficile. Et elle l’est de plus en plus depuis que le gouvernement pakistanais a commencé à le démanteler. La vie dans le camp est devenue périlleuse. Le soir, personne ne sort. Le jour, le moindre déplacement est hasardeux.
« On risque de me voler tout ce que j’ai dans les poches », dit Israrulah.
« Jalozai est très dangereux », affirme de son côté le vice-commissaire pakistanais responsable des camps, M. Faridullah. Il ne veut pas que les journalistes étrangers s’y aventurent à cause des risques de kidnapping.
« Le camp va fermer, il y a beaucoup de tensions », ajoute-t-il.
À travers la pluie et les maisons abandonnées, le camp a un air de fin du monde. Il est pratiquement désert. Quelques femmes, couvertes de voiles noirs de la tête aux pieds, marchent tête baissée, des hommes pressent le pas en jetant des regards hostiles, des chiens trottent entre les ruines.
« On devait raser Jalozai à l’automne 2007, mais l’hiver était proche et les gens n’avaient aucune place où aller, explique Rabia Ali, porte-parole de l’UNHCR. On a donc décidé d’attendre au printemps. »
Sauf qu’aujourd’hui, ils n’ont toujours pas de place où se réfugier.
Michèle Ouimet
Source: cyberpresse
(M)
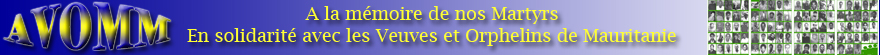
 Actualités
Actualités



















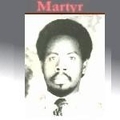
![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)